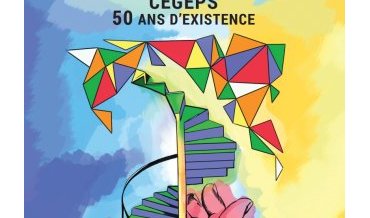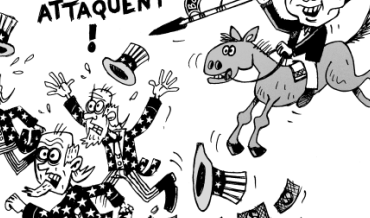Mouvements autochtones contemporains en Amérique latine
La question des alliances
Dossier : Nouvelles résistances, nouvelles voies d’émancipation
En ce qui concerne les mouvements autochtones d’Amérique latine, depuis deux décennies, les dynamiques nationales ont pris le pas sur les tendances globales qui avaient caractérisé la période précédente, marquée par les contre-célébrations du cinquième centenaire de la « découverte » (sic) de l’Amérique ; pour la première fois, des représentants des peuples des hauts plateaux purent échanger avec ceux de la forêt amazonienne ou de la prairie canadienne. La question des alliances politiques s’est progressivement imposée comme nous le verrons dans ce survol de la situation en Bolivie.
Collas, cambas et cocaleros : comment dépasser les contradictions
La Bolivie est le seul pays d’Amérique latine où une majorité de la population se réclame d’une ascendante autochtone : quatre millions d’Aymaras et de Quechuas partagent l’identité colla [1], tandis que des dizaines de groupes cambas sont éparpillés dans les forêts et les savanes de l’est (les Guaranis étant les plus nombreux et les mieux organisés).
En 1952, la réforme agraire décrétée par le Mouvement national révolutionnaire (MNR) répartit les terres des grands domaines entre des dizaines de milliers de paysans amérindiens. Cependant, ces mesures n’entraînèrent pas le développement économique souhaité. Il s’ensuivit une alternance de régimes démocratiques fragiles et de dictatures militaires, régulièrement contestées par un puissant mouvement populaire. La situation économique générale ne cessa de se dégrader avec le déclin des mines d’étain et le pays connut une inflation galopante.
En 1985, le MNR revint au pouvoir, cette fois avec un programme néolibéral. Il privatisa et ferma les mines, liquidant pratiquement le mouvement ouvrier. Une grave crise agricole toucha les hautes terres. Les anciens mineurs et les paysans ruinés émigrèrent massivement vers les basses terres de l’est. Face à la poussée migratoire, les Guaranis s’allièrent à d’autres groupes pour former la Confédération autochtone de l’Est bolivien (CIDOB). Une autre organisation, le Mouvement
révolutionnaire Tupac Katari (MRTK), surtout présent chez les jeunes Aymaras, sera récupérée par les partis traditionnels ; un de ses dirigeants, Victor Hugo Cárdenas, devint même vice-président dans les années 1990. La production croissante de cocaïne dans les vallées est alors tolérée par les États-Unis, car elle permet au pays d’éviter la faillite.
Avec la stabilisation économique, dans les années 1990, sous Sánchez de Lozada, le pays devint un laboratoire d’essai pour les politiques néolibérales : multiculturalisme et décentralisation administrative étaient à l’ordre du jour.
Les « trois guerres »
• La « guerre de la coca » (1985-1990)
Face à l’ordre donné par l’administration Reagan de détruire les plantations de coca, les cocaleros de la vallée du Chapare s’organisent et résistent. Un leader surgit : Evo Morales. Victorieux, ils obtiennent le droit pour chaque famille de cultiver un qato (1 600 m2) de cette culture traditionnelle de la région. Dans les années 1990, les cocaleros se rapprochent de la CIDOB, qui leur explique le sens de sa lutte pour le territoire. Le même rapprochement a lieu avec la Confédération syndicale unique des travailleurs de la campagne de Bolivie (CSUTCB), organisation paysanne que dirige Felipe Quispe, un Aymara, ancien du MRTK. Les cocaleros « s’amérindianisent » et les autochtones se familiarisent en retour avec les luttes paysannes. De leur alliance naîtra le Mouvement au socialisme (MAS).
• La « guerre de l’eau » à Cochabamba (1999-2000)
Le gouvernement décide d’y privatiser l’eau. Devant les tarifs qui triplent, les usagères et usagers, regroupés dans le Front pour la défense de l’eau et de la vie, organisent une riposte vigoureuse, avec l’aide des cocaleros. Le MAS acquiert de l’expérience en milieu populaire urbain.
• La « guerre du gaz » à La Paz (2003)
Le président Gonzalo Sánchez de Lozada annonce qu’on va exploiter les gisements de gaz de l’est du pays… et exporter le gaz liquéfié aux États-Unis, en passant par le Chili. Les protestations sont violemment réprimées par la police, ce qui ne fait que les amplifier : le président démissionne et le gouvernement intérimaire organise des élections pour 2006.
Le gouvernement du MAS
Le MAS gagne ces élections. Il faudra trois ans de débats, souvent houleux, pour adopter la nouvelle constitution qui recherche un équilibre entre un centralisme politique et un double niveau d’autonomie : celle des peuples autochtones, d’une part, celle des régions, d’autre part.
La nationalisation partielle (51 %) des entreprises pétrolières et gazières, dans un contexte de prix élevés (jusqu’à l’été 2014), a assuré à l’État des revenus considérables. Ils ont été investis dans l’amélioration des services publics et des infrastructures et partagés avec les administrations locales.
Concernant les autonomies autochtones, si le principe est clair, la mise en œuvre s’est avérée compliquée. En plus du long processus bureaucratique requis, les conceptions varient d’un groupe à l’autre. Sur le haut plateau, Quechuas et Aymaras sont souvent satisfaits d’une autonomie municipale. Dans les basses terres de l’est, certains se plaignent : « À quoi servent les autonomies si on n’a rien récupéré de nos territoires ? On nous donne ce qui reste… »
De nouveaux clivages entre les Autochtones des basses terres et le nouveau pouvoir à La Paz sont apparus avec le projet de construction d’une route qui relierait Cochabamba au département amazonien de Beni. Elle doit traverser une vaste forêt, le Territoire autochtone Parc Naturel Isiboro Sécure (TIPNIS), où se trouvent 64 communautés qui appartiennent à trois groupes amérindiens. Après avoir réprimé durement, en septembre 2012, une marche de protestation des villageois·es, le gouvernement central finit par céder et retire son projet de route. Quand « leur » gouvernement refuse de les entendre, les organisations amérindiennes utilisent ainsi les mêmes outils de lutte (blocus, marches sur la capitale) que face au régime précédent.
Un bilan contrasté
À plusieurs égards, l’expérience bolivienne s’avère positive. Après l’échec du MRTK, qui mobilisait selon des lignes ethniques, le mouvement autochtone bolivien a développé une stratégie d’alliances qui ont permis la convergence de la CIDOB (peuples amérindiens des basses terres) et de la CSUTCB (paysans aymaras et quechuas du haut plateau) avec la paysannerie pluriethnique des planteurs de coca et les habitants des quartiers pauvres des villes. Au-delà du rapprochement avec des groupes aux intérêts similaires, les revendications autochtones étaient intégrées au mouvement plus général comme lors de la « guerre de l’eau » et de la « guerre du gaz ».
Quand le MAS est passé de l’opposition à l’exercice du pouvoir, l’équilibre entre les intérêts des divers secteurs est devenu plus difficile à maintenir, comme l’a montré le conflit du TIPNIS. Face à la mobilisation des Autochtones de la forêt, auxquels s’étaient jointes des organisations aymaras du haut plateau, le gouvernement d’Evo Morales a dû céder. Bien que les canaux de ce pouvoir soient encore largement informels, ce qui laisse la porte ouverte à l’arbitraire, il se dégage de l’examen de ce premier gouvernement autochtone une image très différente de celle du « totalitarisme de gauche » brandie par certains. Toutefois, un de ses défis sera de trouver assez rapidement une alternative à la politique « extractive » qui laisse l’État et la population bolivienne à la merci des fluctuations des prix des matières premières.
[1] À l’arrivée des Espagnols, l’ouest et le centre de la Bolivie actuelle formaient le Kollasuyo, la région sud de l’Empire inca. Les peuples des basses terres de l’est étaient autonomes.