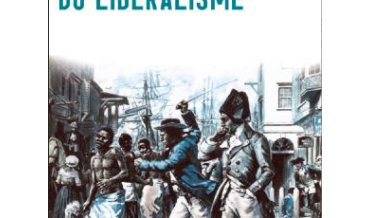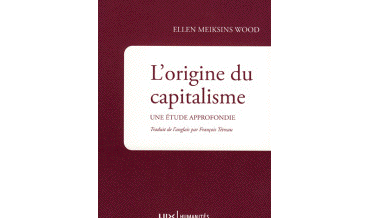Dossier : Les classes dominantes au Québec
Le capital canadien en perspective
La bourgeoisie canadienne se constitue peu à peu au rythme de l’essor industriel et de sa propre émancipation de l’Empire britannique. L’accumulation primitive chez cette classe émergente se réalise surtout à travers le commerce, les produits de base (céréales, bois) et les activités de fabrication traditionnelles. Mais l’impulsion déterminante vient avec la construction des canaux et surtout des chemins de fer, au XIXe siècle. Ces initiatives permettent de structurer un espace transcontinental et de créer un marché intérieur favorisant le développement du capital canadien.
L’émergence d’un nouvel acteur
Tout en demeurant solide dans certains secteurs, la position relative du capital canadien tend à s’effriter pendant une bonne partie du XXe siècle. Très tôt, le capital américain se précipite sur les ressources naturelles, tandis que les filiales d’entreprises manufacturières s’installent sur le marché canadien afin de contourner les barrières tarifaires. À la fin des années 1960, les non-résidants contrôlent 61 % de la production manufacturière et plus des trois quarts de la production énergétique et minière. Au total, le degré de contrôle étranger au Canada atteint 36 % de tout le capital non financier [1].
Plusieurs initiatives structurantes sont alors prises qui vont dans le sens à la fois d’une plus grande intégration continentale, mais aussi de l’élargissement de l’espace de manœuvre du capital canadien : construction de la voie maritime du Saint-Laurent (1958), facilitant l’accès au cœur du continent ; établissement de la ligne Borden (1963), afin d’alimenter l’industrie pétrochimique ontarienne avec le pétrole de l’ouest ; Pacte de l’automobile (1965), qui organise un partage de la production avec les États-Unis. Des politiques plus musclées sont mises en œuvre sous le gouvernement Trudeau : création de l’Agence de tamisage des investissements étrangers (1974), Programme énergétique national et création de Petro-Canada (1980). Graduellement, la part du contrôle étranger reflue à 23 %.
Dans les secteurs de pointe, largement militarisés, le capital canadien ne parvient pas à concurrencer les grandes puissances, comme l’illustre l’échec de l’Avro Arrow (1959). Parallèlement, la construction navale amorce un déclin irréversible. On se replie alors sur la sous-traitance, les joint ventures ou des stratégies de niche. À la longue, cette approche s’avérera fructueuse et permettra de développer des créneaux d’excellence : satellites, systèmes de communication, simulateurs de vol, avionnerie, BlackBerry, etc.
Le virage économique néolibéral
Le virage néolibéral des années 1980 fournit les conditions d’un nouvel élan, notamment grâce aux accords de libre-échange canado-américain (1989) et nord-américain (aléna, 1994) qui ouvrent davantage l’accès au marché américain. Plusieurs accords de libre-échange bilatéraux suivront. En moins d’une décennie, la valeur du commerce avec les États-Unis triplera.
Historiquement, c’est en bonne partie dans la finance que le capital canadien s’épanouit. Le virage néolibéral apportera un nouveau souffle, entre autres en permettant la fusion des opérations bancaires, d’assurance et de courtage. Les banques profiteront de l’endettement croissant des gouvernements grâce à leur rôle d’intermédiaire pour les placements de capitaux étrangers. Le refus du gouvernement canadien de permettre les fusions des grandes banques canadiennes, à la fin des années 1990, poussera celles-ci à étendre davantage leurs activités à l’étranger. Le processus de globalisation en cours favorise aussi l’expansion internationale des banques, particulièrement dans les paradis fiscaux qui servent de relais pour des investissements en franchise d’impôts dans des pays tiers. La financiarisation croissante de l’économie à compter des années 1980 consacre le statut hégémonique de cette fraction du capital canadien, centrée surtout à Toronto.
Sorties indemnes de la crise financière de 2008 et bien nanties, les banques canadiennes multiplient les acquisitions, surtout aux États-Unis où elles profitent de la vulnérabilité de leurs rivales. Même Desjardins s’y met, en faisant l’acquisition de Western Financial Group, un assureur de l’Ouest canadien.
Par ailleurs, avec l’irruption des pays émergents, les ressources énergétiques et les matières premières sont redevenues fort convoitées. Les capitaux affluent et des batailles féroces se livrent pour le contrôle des entreprises. Pour le seul mois de janvier 2011, les fusions et acquisitions au Canada s’élèvent à 16,4 milliards de dollars. Certaines entreprises canadiennes s’en trouvent fortement valorisées, comme Barrick Gold, numéro un mondial dans l’extraction de l’or, ou les pétrolières de l’Alberta. Mais le capital canadien perd aussi du terrain au profit d’investisseurs étrangers qui renforcent leur emprise sur des entreprises comme Inco, Falconbridge ou Alcan. Il parvient néanmoins à défendre certains bastions, comme l’illustre le blocage par le gouvernement canadien de la tentative de prise de contrôle de Potash Corp.
Le capital québécois
Plus modeste, la bourgeoisie québécoise se développe en fonction du marché local et sans apport de capitaux étrangers, coincée entre le capital anglo-américain et l’Église catholique réfractaire au « matérialisme ». Une certaine accumulation provient aussi des communautés issues de l’immigration, notamment les Juifs, par exemple Steinberg, ou les Italiens dans la construction. C’est seulement avec l’émergence de l’État moderne du Québec, lors de la Révolution tranquille des années 1960, que se structure un capital plus spécifiquement québécois, appelé familièrement Québec Inc. Celui-ci met en rapport, à travers des interrelations personnelles ou institutionnelles, toute une variété d’entreprises industrielles ou financières, de coopératives, de sociétés d’État et même de sociétés financières parasyndicales.
Avec le temps, plusieurs des entreprises fondées au Québec ont grossi et le marché local est devenu trop exigu. Certaines d’entre elles, comme SNC-Lavallin, Bombardier, Québécor ou le Cirque du Soleil, sont présentes partout dans le monde. Aujourd’hui, c’est notamment dans les réseaux de distribution que les capitaux québécois prennent de l’expansion à l’extérieur, par exemple les quincailleries Rona, les pharmacies Jean-Coutu, les dépanneurs Couche-Tard.
Et maintenant ?
Les entreprises inscrivent désormais leurs opérations dans l’environnement économique globalisé. Pensons par exemple à Gildan, le plus gros fabricant de T-shirt au monde, avec ses maquilladoras répandues partout en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Ces entreprises ne dépendent plus autant qu’auparavant du soutien de l’État québécois. Elles attendent plutôt des gouvernements, fédéral ou québécois, qu’ils instaurent et assurent de bonnes conditions d’affaires dans les marchés où elles ont pris pied. En conséquence, la trame d’intérêts convergents tissée entre certains capitaux québécois et l’État québécois se relâche et s’effiloche peu à peu.
Dans l’environnement néolibéral et globalisé actuel, le capital canadien, tout comme le capital québécois, semblent avoir trouvé des modes d’insertion, d’association et d’intégration avec le capital étranger qui leur laissent assez d’espace pour poursuivre leur expansion.
[1] Lucie Laliberté, La mondialisation et le bilan des investissements internationaux du Canada, Statistique Canada, 1993.