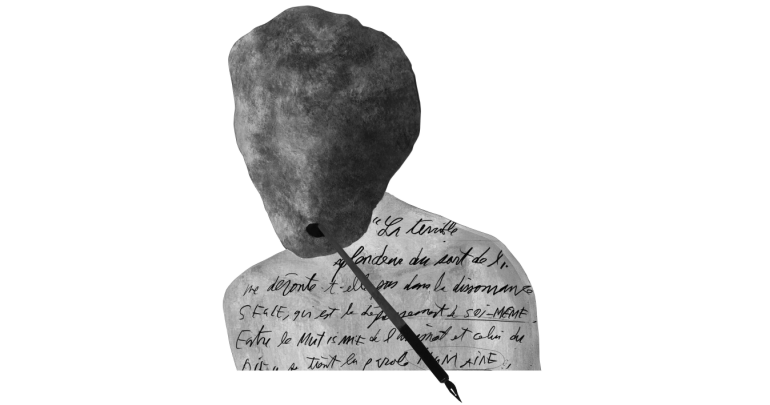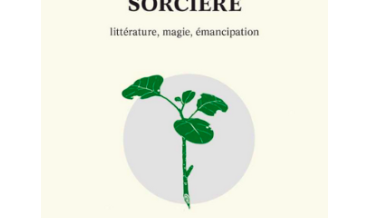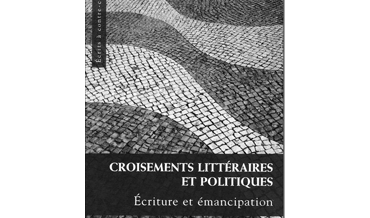Présentation du dossier du no. 41
Littérature - Fuite et résistance
, ,
C’est un lieu commun qui a un certain chic : la littérature ne sert à rien. Il faut reconnaître, cependant, que les marchands de papier et d’idées pratiques aiment bien présenter le livre comme un outil indispensable pour vous bricoler une morale ajustable, voire une culture bien-pensante qui vous permettra de briller dans les salons, les départements de littérature et les aéroports jusqu’à la prochaine rentrée. C’est très exactement ce qu’une auteure comme Annie Le Brun appelait il y a quelques années déjà « l’inanité de la littérature » : son enlisement dans le commerce et la professionnalisation de l’écriture, que ce soit pour ne rien dire, joliment ou savamment, ou pour dire des choses formellement déroutantes, mais sans conséquence. Selon l’essayiste, ce qui se donne ainsi pour de la littérature est aux antipodes d’une invention verbale qui répond d’abord à un besoin vital d’oxygène, capable d’entraîner l’auteur et son lecteur à l’écart de l’uniformisation, à l’écart des idéologies, quelles qu’elles soient.
Avec les extrémismes qui éclatent au XXe siècle, la question des finalités de la littérature s’est montrée plus que pressante : certains y répondirent par une quête esthétique supposément épurée, d’autres refusèrent de séparer la forme d’un discernement éthique et d’une quête de connaissance. Dans sa version la plus militante, cette conception plaide sinon pour l’engagement social du moins pour une politique de la littérature. Il s’agirait, sinon de changer le monde, du moins de résister à l’infamie qui se donne pour nécessité : « Je ne faisais qu’obéir aux ordres », répétait innocemment Eichmann à son procès. C’est un exemple aux conséquences extrêmes certes, mais le réflexe n’est pas si éloigné de la servilité volontaire devant les mots d’ordre qu’on nous assène aujourd’hui : soyez compétitifs, performez, vendez-vous, assouplissez-vous, exotisez-vous, etc.
Or, contrairement à ce qu’on dit souvent, la littérature s’accommode plus facilement des mots d’ordre qu’elle ne les refuse. Alors comment la littérature réagit-elle aujourd’hui à ce totalitarisme de moins en moins soft ? Ose-t-elle se mettre à l’épreuve et trouver des expressions neuves là où on les attend le moins ? Résiste-t-elle aux nouveaux asservissements ou les dissimule-t-elle dans des esthétiques séduisantes ? Questions qui reviennent à demander : pourquoi et comment écrire ?
Les réponses à ces questions ne sont pas univoques, quoiqu’il y ait un principe qu’à peu près tout le monde défendrait aujourd’hui : échapper aux endoctrinements et aux conformismes. Oui, mais encore ?
Nous avons posé ces questions à des gens qui s’occupent de littérature (des écrivains, des professeurs de littérature et un lecteur-activiste), qui nous sont proches et qui semblent les placer au cœur de leurs préoccupations. Il faut aussi préciser qu’on leur imposait une contrainte d’espace importante. Cette économie de mots n’est pas idéale, mais elle permet d’explorer plusieurs facettes de la question : la sempiternelle et incontournable question de l’engagement et de la portée politique de la littérature (Alain Farah), l’absence de recettes pour pervertir le consensus social (Catherine Mavrikakis), la revanche de la littérature sur les nouvelles technologies (Mathieu Arsenault), l’attrait de l’exotisme dans le roman québécois actuel (Michel Trépanier), mais aussi le besoin d’engagement et d’action qu’on retrouve entre autres dans les derniers romans de Francine Noël (Michel Nareau), l’anticipation sociale dans la science-fiction (Christian Brouillard et J.P. April), le théâtre de combat s’inspirant, entre autres, de la forme documentaire (Claude Vaillancourt), les combats fêlés de la poésie (Jonathan Lemay et Danny Plourde), l’apolitisme de la BD québécoise, plutôt fascinée par l’autofiction, ses prouesses esthétiques et narratives (Sylvain Lemay), et l’urgence de forcer les ghettos culturels et les chapelles cultivées grâce à la bibliothèque à vélo (Ramon Vitesse). Enfin, en plein cœur de ce dossier, Jacques Pelletier et Yvon Rivard se penchent sur l’œuvre du grand écrivain autrichien Hermann Broch, qui a produit une des œuvres les plus significatives du XXe siècle, comme romancier et comme théoricien du totalitarisme et des liens entre éthiques et esthétiques.
Le dénominateur commun de tous ces textes : un questionnement sur la place de la critique sociale et du politique dans la littérature, qui se veut une invitation à lire les textes, à les faire dialoguer entre eux et avec le monde.