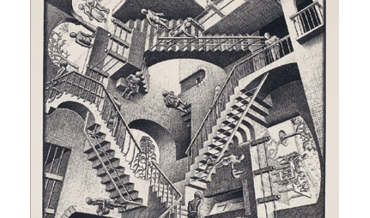Sous la loupe
« Y’a qu’à » - La CAQ et l’éducation
Peut-être y a-t-il, médiatiquement et politiquement, de salutaires insignifiances, une stratégie visant à ne rien dire de trop marqué, pleine de sous-entendus, qui permettrait d’éviter les vagues et les critiques, tout en fédérant peurs, espoirs et ressentiments de tous poils, par-delà les contradictions. Ainsi en irait-il de la Coalition avenir Québec (CAQ). L’inexistence de ce parti dans la vie des idées au Québec et l’insipidité de son discours ont pour effet que l’intellectuel·le lambda, quel que soit son penchant idéologique, n’a sans doute pas consacré plus de quinze minutes de sa vie à réfléchir à la CAQ, à cette possibilité jadis improbable : un gouvernement Legault.
On pourrait peut-être trouver dans cette indifférence, cette répulsion, un réflexe de classe ou d’universitaire valorisant les échafaudages argumentatifs et s’opposant rituellement à toute invocation du « gros bon sens ». Pourquoi, en effet, s’abaisserait-on à affronter les idées de « mononc’ » associées à ce parti ? Sans compter que l’on ferait les gorges chaudes envers les « vendeurs de chars » qu’incarneraient ses député·e·s et sympathisant·e·s ! Se défaire de ce réflexe permettrait pourtant dans bien des cas de découvrir des formes de rationalité pratique, concrète, informant les revendications se réclamant du « bon sens ». On ne trouve pas dans cette logique que des généralisations hâtives, échafaudées sur un seul événement grossièrement interprété ; elle ne marque pas nécessairement la fin de toute analyse, le refus d’argumenter davantage ; elle exprime aussi, parfois, la condensation d’expériences répétées.
Par ailleurs, comment ne pas reconnaître que face à l’État, à ses instances multiples, à sa puissance, à l’enchevêtrement de règles et de formulaires qu’il édicte, nous éprouvons sans doute tous des pulsions de « gros bon sens » à la Legault ? Je sais, pour ma part, qu’en matière d’éducation, j’ai éprouvé certaines des indignations que porte la CAQ et qui lui tiennent lieu d’analyse politique. Douloureuse confession : j’ai été un quasi caquiste.
Le ministère, les commissions scolaires et moi
Il est sans doute dans l’ordre des choses que, pour expliquer ces éruptions de fièvre, je m’exprime à la première personne, car c’est comme cela, le plus souvent, que s’expose le gros bon sens. La toute première concrétisation du ministère de l’Éducation dans ma vie, la première fois où j’ai pu prendre conscience de son existence en tant qu’appareil, incarnation froide de l’État pouvant intervenir dans mon existence quotidienne, ce fut comme incitatif au mariage. À la fin des années 1990, en effet, nombre d’étudiant·e·s contractaient un mariage de connivence, entre ami·e·s, afin de déjouer les règles d’attribution des prêts et bourses. Le Ministère, c’était alors pour moi son bras bancaire, un organisme de mesquine générosité aux règles abstruses. Je connaissais une poussée d’anxiété chaque fois que je devais ouvrir une enveloppe venue de la rue de la Chevrotière, craignant que le Ministère, cette année-là, me donne un peu moins de bourses, pas du tout peut-être, seulement des prêts, alourdissant ainsi ma dette étudiante. Combien d’appels placés « en attente » au Ministère, de vaines tentatives pour parler à un responsable ? Inapte alors à m’emparer de la littérature pour mieux comprendre le réel, pensant encore qu’on n’y trouvait qu’affects purs, qu’imagination sans frein, je n’ai pas su voir dans le Ministère une des formes contemporaines du « château » de Kafka.

Bien des années plus tard, ce fut au tour des commissions scolaires d’envahir mes préoccupations. Jusque-là, je ne les avais perçues que par la figure sagace et bienveillante d’un ami de mes parents, M. Reid, le commissaire responsable de l’école de mon village d’enfance, lequel avait longtemps cherché à faire construire un gymnase, avait obtenu une décision favorable puis était mort avant que la construction ne s’achève. Aussi bien que le mariage pour les bourses et les impossibles appels au Ministère, cela aurait pu être une leçon quant à l’inertie des structures d’un côté, quant à la mesquinerie des « pense-petit » de l’autre.
La commission scolaire des récentes années, ce fut la CSDM, que j’ai appris à connaître de l’intérieur, hélas, pendant cinq longues années faites d’innombrables réunions, de blocages, de revirements et autres affres bureaucratiques causées par la démolition puis la reconstruction d’une école primaire. J’ai alors découvert, dans un mélange d’amertume et de tristesse politique, comment les individus responsables de cette étrange institution, la commission scolaire, pouvaient être secrets, maniganceux, méfiants envers tous leurs interlocuteurs·trices et dans certains cas d’une décourageante étroitesse d’esprit. Il était tentant, quand il fallait s’escrimer une fois de plus contre les faux-fuyants de tel responsable des immeubles, de telle chargée de projet, de céder à une simplissime colère et d’endosser la « solution miracle » que défendait alors la CAQ : abolissez-moi ça, les commissions scolaires ! Faites un grand ménage là-dedans ! Cependant, tout au long de cette aventure, j’avais aussi constaté que les lambeaux de démocratie scolaire donnaient malgré tout un certain pouvoir aux parents, que les questions au conseil des commissaires poussaient la CSDM à s’expliquer davantage, à impliquer les parents, à agir même, alors que le Ministère, lui, apparaissait hors de notre portée, demeurait totalement, résolument insensible aux revendications des parents. Abolissez-moi ça, le Ministère ? Brassez-moi ça comme Barrette l’a fait avec le système de santé (c’est un caquiste vire-capot, après tout) ? Serait-ce cela, ultimement, les idées de la CAQ, en matière d’éducation, un radical simplisme niant la complexité des problèmes ? Une pensée « y’a qu’à » faisant fi de l’analyse pour lancer en deux, trois coups de cuillère à pot une solution facile pour chaque problème difficile ?
Y a-t-il un.e intellectuel.le à la CAQ ?
L’inappétence de l’intellectuel·le lambda envers la CAQ tient aussi, possiblement, à l’absence d’intellectuel·le·s caquistes, catégorie qui paraît presque un oxymore. Ce n’est guère mieux, il faut le dire, dans les partis libéraux provincial et fédéral, lesquels furent des lieux de disgrâce, pour ne pas dire de déchéance, pour les intellectuel·le·s, dans les dernières années comme l’illustrent les Blais, Dion, Ignatieff, Reid, etc. Le Parti québécois (PQ), de son côté, a toujours été un lieu d’engagement pour les intellectuel·le·s, organe de leurs espoirs et désillusions, mais il est à son étiage historique, loin du foisonnement des années 1970. Inversement, on reproche plutôt à Québec solidaire (QS) d’attirer trop d’intellectuel·le·s, comme si cela constituait une grave menace pour notre système politique. Des avocat·e·s, des piliers de chambre de commerce, des « décideurs locaux », c’est tellement plus rassurant ! Toujours est-il que la CAQ semble ne pas même avoir de compagnons de route, dans les médias, les revues intellectuelles, les réseaux collégial et universitaire. Elle compte bien quelques alliés objectifs du côté des chroniqueurs·euses déçu·e·s du PQ, crispé·e·s dans leur obsessive hantise de QS et opposé·e·s, par nationalisme fervent ou velléitaire, selon les cas, au Parti libéral du Québec.
Ce serait sans doute dépeindre Jean-François Roberge dans un rôle qui n’est pas le sien que de le propulser « intellectuel de la CAQ ». Il faut néanmoins reconnaître qu’en publiant ses idées sur le système scolaire québécois (Et si on réinventait l’école ? Chroniques d’un prof idéaliste, Québec Amérique, 2016), il a cherché à aller plus loin que les deux ou trois pages du programme du parti ou que ses interventions en chambre (on peut d’ailleurs observer que les propositions de la CAQ, en éducation, viennent pour la plupart de cet ouvrage, signe de l’importance de Roberge, à cet égard). Je me suis donc attaqué à son ouvrage, question de voir ce qui risque de nous attendre, s’il devenait ministre de l’Éducation.
Je redoutais l’épreuve de cette lecture, aussi bien pour les idées que je pensais y découvrir, que pour la manière de les défendre ou pour sa forme. Or, je fus surpris, à plusieurs reprises. On y trouve en effet un très net plaidoyer en faveur des cours de culture générale, de la poésie, du théâtre (mais pas de la philosophie), la valorisation claire des cégeps, un brin de sociologie de l’éducation, la promotion du militantisme étudiant, une défense claire de la langue française, des citations de Steiner, Senghor, Hugo, Bourgault, Rand, Franklin et Bachelard (ceci dans un très grand éclectisme, qui révèle à la fois le goût des « grandes phrases » et le caractère parfois ornemental des citations). À travers tout cela, on ne peut que reconnaître une nette passion pour l’enseignement, une admiration profonde pour les figures d’enseignants ayant marqué ses études puis sa propre carrière dans une école primaire (il a été prof pendant 17 ans, l’auteur le souligne à plusieurs reprises, pour bien marquer sa légitimité). Osons le mot : on trouve dans ce livre quelques véritables inflexions humanistes. Au point où on se demande si c’est bien un caquiste qui a écrit cet ouvrage.
Humaniste, peut-être, mais idéaliste, non, du moins pas dans le sens d’une explication du monde centrée sur les choses de l’esprit, sur la force des idées, par opposition au matérialisme, ni même dans celui d’une proposition à tendance utopique. Car il n’y a guère d’utopie ni même de projet global cohérent dans son livre, mais une série de mesures aussi éclectiques que les citations, parmi lesquelles émergent quelques idées phares, quelques obsessions comme l’abolition des commissions scolaires et la création d’un ordre professionnel des enseignant·e·s. De même, on découvre assez vite que c’est bel et bien un caquiste qui a rédigé cet essai quand on voit que, systématiquement, c’est l’économie, le marché du travail, le montant des salaires, et ainsi de suite, qui constituent dans la plupart des chapitres la dimension majeure de l’analyse, le véritable terrain où l’on quitte les bons sentiments et l’humanisme affiché dans les premiers paragraphes, pour en venir aux visées ultimes du système d’éducation. Ainsi, pour bien faire comprendre ce qu’est un directeur d’école, Roberge le compare à un président d’entreprise, de même que pour faire entrevoir l’importance de la culture générale, il indique que celle-ci « peut faire la différence au moment du recrutement d’un candidat pour le nouvel emploi ». Pour défendre la mobilité étudiante (c’est-à-dire financer le déplacement des étudiant·e·s des grandes villes vers les cégeps en difficulté), il en souligne les retombées économiques. Pour expliquer l’opposition des syndicats à la création d’un ordre des enseignant·e·s, il mise sur leur crainte de devoir diminuer le montant des cotisations. Pour montrer qu’on peut aisément transformer le système public, il fait des écoles privées le modèle par excellence d’efficience. Le grand argument, qui sous-tend ses analyses et ses positions, c’est l’entrée nécessaire du Québec dans l’économie du savoir (forte originalité ici, comme on le voit). Tant et si bien que l’ensemble du système d’éducation devient dans son esprit une grande « chaîne de montage ».
Il y a ainsi dans cet ouvrage des tiraillements majeurs entre des propos associés à une vision progressiste de l’éducation – « L’éducation constitue la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale » –, des arguments associés à une vision humaniste (susceptible d’être élitiste aussi bien qu’émancipatrice), et une logique économique de rentabilité, d’espèces sonnantes et trébuchantes, plutôt que de bien public. Comme on se doute bien que seule la troisième de ces perspectives traverse l’ensemble des dirigeant·e·s de la CAQ, on peut aisément imaginer que l’humaniste à éclipses en Jean-François Roberge se sentira très seul, au gouvernement, et que le Ministère de l’Éducation sous sa direction risque fort d’être mené par l’esprit des chambres de commerce davantage que par une pédagogie libératrice. Pour défendre la culture générale, la capacité des élèves à connaître le monde ainsi qu’eux-mêmes et elles-mêmes, grâce à la maîtrise de la langue, de l’histoire et des sciences, Roberge aurait besoin de groupes alliés chérissant eux aussi ces objectifs, alliés qui sont pour la plupart extérieurs à son parti, quand ils ne sont pas, carrément, des adversaires. Au premier plan desquels : les syndicats, bête noire des caquistes et populistes de droite.
Roberge, le ministère et les commissions scolaires
Dans ce qu’il estime avec emphase être une « réinvention » de l’école, Roberge passe allégrement des remarques sur le système d’éducation à la dénonciation du « système », de façon aussi négative et globale qu’un collégien découvrant la lourdeur des structures sociales. Étrangement, dans ses propos, le ministère de l’Éducation n’existe pratiquement pas. Quand il peste contre un « système hautement hiérarchisé et ridiculement bureaucratisé », il pense uniquement aux commissions scolaires, comme si ces dernières n’étaient pas, pour une bonne part, des sous-traitants de la bureaucratie venue d’en haut, contraintes par d’innombrables règles, exigences et redditions de compte de la part du Ministère. Cela révèle l’étroitesse du champ d’observation de son livre, qui laisse dans l’ombre de très nombreux facteurs, en plus d’épouser, idéologiquement et narrativement, le point de vue de l’individu se heurtant aux structures étatiques et canalisant sa rage devant certaines absurdités sur le premier fonctionnaire ou le premier palier administratif venu. Ce n’est pas tant l’État qui obsède les caquistes (sauf pour les monomaniaques venus de l’Institut économique de Montréal) que ses instances locales et intermédiaires.
Pour Roberge, la solution est simple : il suffit de remplacer les commissions scolaires par des « centres régionaux » au service des écoles et d’envoyer l’argent directement à ces dernières. Tout cela, bien sûr, permettrait « d’importantes économies ». Que les commissions scolaires soient aussi un (très imparfait) niveau de démocratie locale permettant aux parents d’avoir leur mot à dire (et ce, de façon plus globale que strictement locale, dépassant l’unique préoccupation centrée sur « mon enfant », « mon école »), cela n’entre pas dans son analyse. Quand on constate, par ailleurs, les effets néfastes de la réforme Barrette sur le système de santé, la perte du (faible) pouvoir d’intervention des usagers·ères et des travailleurs·euses, au profit d’une forte centralisation, on peut craindre le pire à cet égard. Chercher à stabiliser les équipes-écoles, leur conférer plus d’autonomie, ce sont là des objectifs intéressants, mais l’abolition des commissions scolaires a toute l’apparence d’une fausse bonne idée [1]. De plus, la lutte contre la bureaucratie, autre justification de cette mesure, n’aurait sans doute pas les effets escomptés. Des décennies de néolibéralisme ont en effet engendré toujours plus de bureaucratie (et de coûts), du fait des contraignantes redditions de compte, sources de montagnes de rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels, alouette, que personne ne lit jamais vraiment.
De même, la proposition de Roberge et de la CAQ sur l’instauration « nécessaire » d’un ordre des enseignant·e·s paraît sans commune mesure, compte tenu des chambardements probables que cela provoquera, avec le problème identifié : il y a de mauvais·es enseignant·e·s dans le réseau et il est trop difficile de les congédier, même quand ils ou elles sont alcooliques (tel est le cas concret mentionné par Roberge pour illustrer son propos). De son aveu même, il n’y aurait pas plus de 1 % de profs vraiment incompétent·e·s. Vite, créons un ordre professionnel, bousculons les structures et la vie des 99 % de bon·ne·s profs pour taper sur la tête de ces 1 % ! Le déséquilibre entre le problème et la solution est tel qu’on se doute bien qu’il s’agit essentiellement d’un moyen de contourner les syndicats, d’imposer par le biais d’une instance « neutre » devant protéger le « public » des mesures disciplinaires contre les enseignant·e·s, cela en déresponsabilisant l’État, qui n’aurait pas à négocier d’éventuels mécanismes d’évaluation des enseignant·e·s.
Combinée à la proposition sur les commissions scolaires, l’idée d’un ordre des enseignant·e·s fait planer le spectre de conflits très vifs et douloureux, dans le monde de l’éducation, dans les prochaines années, advenant la victoire de la CAQ. Après les années d’austérité libérale, ces potentielles crises que provoquerait la CAQ plongeraient les réseaux primaire et secondaire dans une spirale descendante, une démobilisation et une déstructuration néfastes.
Quant à l’enseignement postsecondaire, si on excepte quelques remarques sur la culture générale et la mobilité étudiante, les réseaux collégial et universitaire n’intéressent pas Roberge, ni la CAQ, dirait-on, qui ne formule aucune proposition à leur sujet. C’est déjà cela, penseront les profs de cégeps, échaudé·e·s par les idées antérieures de Legault sur l’abolition des cégeps. Mieux vaut pas d’idée que des idées simplistes et dangereuses. On a d’ailleurs peu porté attention à la convergence entre les discours de la CAQ et de la Fédération des cégeps, favorisée par les accointances entre les cégeps des régions et l’entrepreneuriat local, assises de la CAQ.

Elles sont toujours simples, les solutions, chez Roberge, ce qui est le signe le plus clair qu’il est fondamentalement caquiste. Il soulève bien ici et là quelques considérations pertinentes, mais ce ne sont jamais de vraies objections qui mènent à des nuances. Chaque chapitre suit le même moule : une anecdote personnelle permet de concrétiser le sujet, puis, une fois le problème rapidement identifié, une solution est rapidement avancée, car la démonstration ne se fatigue jamais à aligner beaucoup d’arguments, encore moins à répondre à des contre-arguments probables. Il y a bel et bien chez lui une logique du « y’a qu’à » dont le simplisme affaiblit fortement une pensée qui pourrait être plus riche si elle allait jusqu’au bout de son éclectisme pour le maîtriser, si elle osait affronter la complexité du réel, l’enchevêtrement des causes multiples. Mais, justement, la sacralisation du « gros bon sens » régnant à la CAQ, la proximité idéologique et rhétorique avec les chroniqueurs et animateurs de radio acharnés à étouffer toute possibilité de nuances sous un tombereau d’affirmations subjectives, l’intériorisation d’un point de vue profondément petit-bourgeois empêchent tout développement en ce sens de la pensée de Roberge (et de la CAQ). N’oublions pas, par ailleurs, que son livre visait moins à développer une pensée qu’à « vendre » les idées du parti sur l’éducation, en leur donnant un peu de profondeur. Un peu, mais surtout pas trop : dans sa construction même, son texte laisse entrevoir le cynisme probable d’un politicien roublard qui ne voudrait surtout pas écrire comme un intellectuel. Bien que les idées sur les commissions scolaires et l’ordre des enseignant·e·s soient, sous plusieurs aspects, fondamentalement mauvaises, en plus d’annoncer des crises inutiles, elles me font moins peur que la perspective d’un gouvernement idéologiquement simpliste, peuplé de politicien·ne·s fièr·e·s de n’avoir pas « trop » réfléchi aux problèmes à résoudre.
On aura beau citer Bachelard ou prétexter de son amour pour Baudelaire, gouverner sur la base de telles idées préconçues ne peut que diminuer le potentiel émancipateur de l’éducation, favoriser le privé et mutiler la culture.