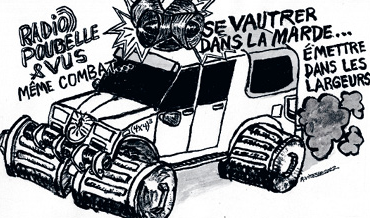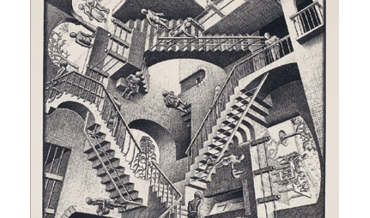Politique
D’un « bon gouvernement » provincialiste à l’autre
L’arrivée à la tête du Parti québécois en 2012 d’un affairiste conservateur et autoritaire doublé d’un souverainiste résolu, Pierre-Karl Péladeau, illustre bien les tensions principales qui divisent cette formation depuis sa fondation : l’indépendance, le social, le pluralisme et la démocratie.
Ces tensions engendrent de multiples positions difficiles à concilier, qui vont de l’indépendance à l’autonomie forte ; de la social-démocratie à l’économisme néolibéral ; de la reconnaissance de la diversité culturelle à la promotion d’un nationalisme unitaire ; enfin, de la centralisation des pouvoirs autour du chef à la démocratisation du parti et de la société.
Un appareil de pouvoir qui peine à se renouveler
Sous René Lévesque, au début des années 1980, le Parti québécois (PQ) a pris plusieurs des traits qui sont encore les siens : ceux d’un appareil électoral qui vise d’abord à former le gouvernement et dont le chef jouit d’une autonomie importante par rapport à sa base militante. Cet appareil promeut un affairisme néolibéral teinté d’une sensibilité sociale et tend à voir la société québécoise comme un binôme composé d’un « Nous » francophone et des « Autres » appelés à s’intégrer à une culture majoritaire vaguement définie. Enfin, lorsqu’il jouit d’une position de force, le PQ promeut la réalisation d’un projet de confédération (et non d’indépendance) avec le Canada, appelé « souveraineté-association ». Le reste du temps, il se réfugie dans le fédéralisme du « beau risque » ou de la « gouvernance souverainiste », justifiés comme un repli stratégique.
Lévesque disait dans ses mémoires que le PQ était probablement le parti d’une génération. Cette génération est celle des baby-boomers, qui ont connu l’époque de la discrimination sociopolitique systémique envers les francophones et l’effervescence de la Révolution tranquille. Issu de ce contexte, le PQ semble y être englué et peine à renouveler son discours, ses pratiques et ses dirigeant·e·s ; il ne parvient donc pas à attirer les jeunes. La sonnette d’alarme avait déjà été déclenchée (et non entendue) en 2004 par trois de ses jeunes députés surnommés « les trois mousquetaires ». Ceux-ci avaient parcouru le Québec cette année-là pour découvrir une jeunesse davantage interpellée par les questions environnementales et sociales qu’identitaires et souverainistes.
Placé devant l’alternative de renouveler la génération de sa chefferie – et de rejeter le conservatisme identitaire – avec Alexandre Cloutier, Martine Ouellet ou Paul Saint-Pierre Plamondon ou de maintenir au pouvoir la gérontocratie boomers avec Jean-François Lisée, les militant·e·s péquistes (dont la moyenne d’âge est de 60 ans [1]), ont opté pour la continuité. Et peut-être pour un éventuel naufrage.
On se rappelle que l’auteur du livre Nous (Boréal, 2007) a damé le pion de Cloutier en critiquant son ouverture culturelle, qui ferait le jeu de l’islam politique radical. Lisée proposait aussi d’exclure la burka et le niqab de l’espace public ainsi qu’une deuxième version de la Charte de la laïcité aux relents islamophobes, reprenant ainsi le flambeau de l’aile conservatrice identitaire du PQ, particulièrement dominante depuis la chefferie de Pauline Marois. On se rappellera aussi que Lisée a été publiquement adoubé dans les pages du Devoir par un éminent membre de cette aile, le sociologue Jacques Beauchemin [2]. S’agit-il de conviction, d’opportunisme ou d’un mélange des deux de la part du nouveau chef, lui qui avait marqué publiquement sa dissidence de la Charte des valeurs du gouvernement Marois ? On pourrait aussi y voir la contrepartie nécessaire à la mise en sourdine de la souveraineté, pour ainsi apaiser les critiques de sa base et donner une unité symbolique au PQ. Enfin, que ce soit sous Marois, Péladeau et maintenant Lisée, la stratégie est la même : reconquérir le vote nationaliste conservateur caquiste.
Une gauche efficace et attrape-tout
Sur la question nationale, Lisée reprend la rengaine du « bon gouvernement » et du report aux calendes grecques d’un référendum sur la souveraineté, dont la mise sur pied dépend de « conditions gagnantes » et de la volonté du chef. Il serait l’alternative de gauche à la machine libérale, mais une « gauche efficace » qui allie libre marché et mesures d’aide individuelle pour assurer l’égalité des chances.
Là où Lisée pourrait courtiser un électorat plus jeune et progressiste concerne les enjeux environnementaux (rejet de l’oléoduc Énergie Est), démocratiques (réforme du mode de scrutin) et sociales (abandon de la politique d’austérité). On peut toutefois sérieusement douter des possibilités de coopération avec Option nationale (avec la mise en veilleuse du projet souverainiste) et Québec solidaire (après le virage conservateur identitaire).
Une petite leçon d’histoire s’impose ici. Le Parti québécois est né de l’alliance de deux organisations. Au centre, le Mouvement souveraineté-association, dirigé par Lévesque, était composé de technocrates keynésiens déçus par la tiédeur nationaliste de Jean Lesage après 1964. À droite, le Ralliement national, mené par le créditiste Gilles Grégoire, se composait de nationalistes chrétiens et conservateurs. À gauche, le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), jugé trop radical, avait été exclu initialement du PQ qui cherchait à paraître crédible dans le but de faire des gains électoraux rapides. Les membres du RIN se s’abordèrent pour adhérer au PQ et l’influencer de l’intérieur. Le conflit a été constant avec les dirigeants péquistes qui, pragmatiques, se sont appuyés sur l’aile droite pour mieux contrôler cette aile gauche (dite participationniste), qui rejette la mise en sourdine des questions sociales, indépendantiste et démocratique.
Le virage néolibéral et autoritaire du PQ en 1981, sous Lévesque, a mené à l’exil de son aile gauche et à la chute drastique de ses membres. Le parti de masse est ainsi devenu un appareil de pouvoir dégarni. L’ère Jacques Parizeau, marquée par l’indépendantisme et la social-démocratie, n’a été qu’un intermède. Les années Lucien Bouchard, avec ses conditions gagnantes et son déficit zéro, s’inscrivent davantage en continuité pour ce parti de pouvoir de centre droit.
Ainsi, Lisée offre du pareil au même, mais dans un emballage différent, car il est un redoutable orateur, si on le compare à ses prédécesseur·e·s ou à Philippe Couillard et François Legault. Il faut toutefois souligner l’impossibilité de séduire un électorat dont les allégeances idéologiques iraient du fédéralisme droitiste (Coalition Avenir Québec) à l’indépendantisme progressiste (Québec solidaire et Option nationale).
Si le PQ a opté pour la continuité et un accès rapide au pouvoir avec Lisée, l’absence d’alliance avec les onistes et les solidaires risque de le ramener à la réalité du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, qui produit de fortes distorsions électorales. De plus, les caquistes n’ont pas encore répondu au sifflet à chien identitaire. Le risque est donc grand de décevoir tout le monde, de laisser la mainmise du pouvoir au corrompu Parti libéral du Québec et de continuer à s’aliéner le vote croissant des Néo-Québécois·e·s.
[1] Frank Desoer, « Quelle cure de jeunesse pour le PQ ? », ICI Radio-Canada.ca, 30 septembre 2016.
[2] Jacques Beauchemin, « Pourquoi j’appuie Jean-François Lisée », Le Devoir, 12 septembre 2016.