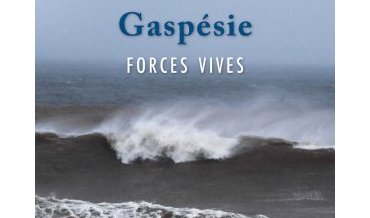Culture
Survivre à Steve Jobs et à Occupy 2.0
Qui n’a pas flairé l’odeur de sainteté au décès de Steve Jobs ? Des gens recueillis devant les boutiques d’Apple, iMachin sur le cœur, relayant sur le Web 2.0 la mort du Bienheureux. « Il a non seulement changé nos vies, il a changé le monde », ânonnaient des chefs d’État. Le très branché président des USA, Barak Obama, sauveur du système technofinancier qui cherche à asservir la totalité de l’humain et du monde à ses desseins, a repris gracieusement le slogan d’Apple pour remercier Jobs : « Think different. » Ça sonne bien, la propagande progressiste est fondée sur ce slogan.
Alors, Jobs est le messie de quelle religion ? On aurait beau crier « Pas moi ! », y échappe-t-on ? Tout le monde heureusement ne partage pas le même optimisme, mais aux yeux du progressiste intégriste, le pessimisme est déjà un péché. Cette technolâtrie ne se réduit pas à une affaire de design industriel ni de marque : les machines sont faites pour fonctionner et réaliser leur plein potentiel, écrivaient Günther Anders et Jacques Ellul il y a déjà cinquante ans. Changer le monde au nom de quoi ? Dans l’intérêt de qui et avec quelles conséquences ? Et dans quelle mesure le Web 2.0 confère-t-il une portée révolutionnaire à l’indignation ? Voici quelques intuitions pessimistes nourries d’heureuses lectures.
La religion du progrès
Jean-Claude Michéa, connu pour ses ouvrages sur la common decency de George Orwell et ses critiques radicales du libéralisme, a brièvement commenté le deuil techno de Jobs lors d’une entrevue à France Culture, alors qu’il venait présenter son dernier ouvrage, Le mythe d’Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès (Climats, 2011). Ce phénomène de masse illustre l’idée de la religion du progrès. Orphée ayant transgressé l’interdit de ne pas se retourner en revenant des Enfers avec Eurydice, il la perd à jamais. Michéa fait du mythe la métaphore du progressisme : le culte de la nouveauté – dogme de la modernité – interdit de se tourner sur le passé. Cet interdit fonctionne de pair avec ce que le philosophe désigne comme la pierre angulaire du libéralisme, le principe de neutralité axiologique : exit le bien et le mal, seul compte l’intérêt bien compris. Or, selon Michéa, le sens du passé est « ce qui permet à chacun (individu ou peuple) de s’inscrire dans une continuité historique et dans une somme de filiations et de fidélités (héritage qui devra, naturellement, être assumé de façon chaque fois singulière) et d’échapper ainsi à l’illusion adolescente d’un recommencement absolu ou aux mythologies parallèles – à la fois religieuses et cartésiennes – de l’île déserte et de l’an 01. »
Selon Michéa, Jobs réunit donc les deux facettes du libéralisme : l’entrepreneur ingénieux et le poète d’entreprise (design et marketing), c’est-à-dire le libéral de droite et de gauche. Jobs accomplit ainsi la définition de Dominique Strauss-Kahn du socialisme : « L’avenir, l’espoir et l’innovation ».
La thèse de Michéa est que la conception progressiste du socialisme, qui est apparue avec l’affaire Dreyfus, s’est développée au détriment des mouvements ouvriers et anarcho-syndicalistes du XIXe siècle. En sacralisant le progrès – la croyance en un sens de l’histoire –, cette gauche moderniste, qui fédère libéraux, républicains et socialistes, rompt avec la critique radicale menée par ces mouvements populaires de l’individualisme induit par l’économie politique anglaise, c’est-à-dire le capitalisme théorisé par Adam Smith. Dès lors, la gauche libérale et branchée poursuit ni plus ni moins les mêmes objectifs que la droite (d’où l’alternance électorale), se faisant même l’avant-garde des nouveaux modes de vie fondés sur toujours plus d’individualisme. On absolutise le déracinement et la déterritorialisation, le multiculturalisme, la destruction des liens sociaux traditionnels, on prône la souplesse, vénère les nouvelles technologies et la société en réseaux. C’est aussi ce que Michéa appelle la gauche kérosène, friande d’exotisme et de nomadisme bon chic bon genre qui, avec une connexion Internet, se trouve chez elle partout dans le monde sans être nulle part engagée, sauf par ses intérêts, aussi chimériques soient-ils, dont celui de jouir sans entraves.
Décroissance conviviale
Cette critique de la croissance illimitée, Michéa n’est pas le seul à la faire. Des auteurs se concentrent sur la technique, mais tous parviennent à des constats similaires. Serge Latouche, dans son ouvrage en hommage à Jacques Ellul, La Mégamachine (2004), attire aussi l’attention sur la destruction du politique, du lien social, du travail, sur le déracinement, l’uniformisation, les catastrophes sociales et écologiques. Dans son maître ouvrage, L’obsolescence de l’homme (1956), Anders ne disait pas autre chose en montrant que la technologie rend l’homme superflu. Dans ses travaux sur la société technicienne, Ellul remarque que l’homme est nuisible pour l’efficacité de la machine. Ces auteurs, accusés d’être réactionnaire, calviniste, luddite, technophobe et beauf ont dit, chacun à leur manière que, pour survivre – s’il n’est pas déjà trop tard –, l’humain doit renverser le pouvoir de la machine. Ellul prône de penser globalement et d’agir localement, Latouche théorise une décroissance conviviale, Michéa une société décente dégagée des visées du capitalisme.
Occupy 2.0
Les techniques, telle l’informatique, peuvent-elles contribuer à cette décroissance conviviale ? J’opte avec Latouche pour le principe de prudence. Des collectifs offrant une technologie indépendante des monopoles, et qui sont, surtout, préoccupés d’organisations locales, sont des initiatives heureuses. Mais on peut craindre que le mouvement des Indignés, par exemple, soit de courte portée révolutionnaire si c’est le Web, le virtuel, qui devient le (non)lieu du refus du technocapitalisme. Séduisante utopie eugénique d’une cybercitoyenneté et glissement de sens inquiétant : « la proposition » substitue le Web à la révolution. Le danger c’est de croire qu’avant soi, qu’avant et par-delà Occupy 2.0, il n’y avait, il n’y a rien : pas d’indignés, pas de révoltes contre le capitalisme, pas de société décente, pas de luttes enracinées dans des lieux concrets et défendant la dignité. Ce serait alors, comme l’écrit Michéa, céder à l’illusion adolescente d’un recommencement absolu. Ce qui non seulement confirmerait le totalitarisme de la Mégamachine, mais le renforcerait.