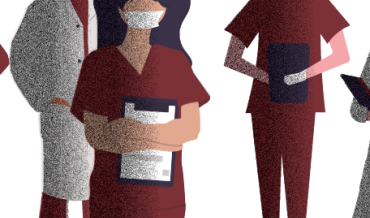Dossier : Quel avenir pour le travail ?
La gestionnite aiguë en éducation
L’éducation primaire et secondaire va mal : nous le voyons avec la pénurie de main-d’œuvre, le manque de ressources matérielles telles que les livres ou autres instruments d’apprentissage, ou encore l’état de nombreux bâtiments scolaires… Les méthodes de gestion actuelles, qui relèvent davantage de l’entreprise privée que du service public, sont à revoir afin de garantir une éducation qui soit émancipatrice, tant pour les enseignant·e·s que pour les élèves.
Avec la pénurie actuelle d’enseignant·e·s, les commissions scolaires rivalisent entre elles pour recruter une main-d’œuvre de plus en plus rare sur les bancs des universités. C’est la logique de la culture d’entreprise qui prévaut : les commissions scolaires font de la publicité et vantent leurs spécificités. Dans les limites du possible (considérant qu’elles ne peuvent donner d’argent supplémentaire), elles offrent également certains avantages aux candidat·e·s potentiel·le·s.
La logique entrepreneuriale existait avant la pénurie d’enseignant·e·s : le système d’éducation public est, depuis plusieurs décennies, en compétition avec les écoles privées. Le secteur public tente alors de redorer son blason en multipliant les écoles à vocation particulière et en contrant la migration des élèves vers le secteur privé.
Cette culture d’entreprise peut réussir à générer une fierté de travailler pour une organisation donnée, que ce soit parce qu’elle nous traite bien ou parce que les conditions de travail sont agréables. Cela a toutefois des effets négatifs au sein des organisations, dont la volonté de taire ses problèmes et ses travers afin de maintenir sa compétitivité face à la concurrence.
La performance et ses exigences ne peuvent donc se vivre qu’à travers une forme de culture du silence. J’illustrerai cette situation en prenant des exemples tirés du milieu de l’éducation, mais cela rejoint assurément ce que plusieurs travailleuses et travailleurs vivent dans d’autres domaines.
Un mal insidieux
Pour analyser les services rendus par les secteurs public et parapublic, les dirigeants ont imposés diverses méthodes de gestion axées sur les résultats. En enseignement primaire et secondaire, elles s’incarnent dans les projets éducatifs et les plans de réussite élaborés pour une période de trois ans.
Le Plan d’engagement vers la réussite éducative (PEVR) vise à faire un état des lieux de la situation de l’école afin de fixer des objectifs d’amélioration portant sur un aspect donné. L’équipe d’enseignant·e·s établit sa priorité en matière de réussite (par exemple, la littératie), puis elle énonce les moyens de stimuler cette priorité et détermine des cibles chiffrées à atteindre. Ces résultats sont ensuite communiqués à la commission scolaire à laquelle l’établissement est rattaché.
Plusieurs enseignant·e·s se montrent très sceptiques. Comment peut-on quantifier la réussite ? Est-ce possible de maintenir une mesure stable pendant trois ans ? Peut-on exclure le contexte socio-économique des enfants ? À une époque où le clientélisme est de mise dans le milieu scolaire, il est paradoxal d’établir des cibles et des objectifs de réussite en se souciant de manière complètement factice des spécificités du milieu.
Les enseignant·e·s subiront alors une pression – concrète ou sous-entendue – afin de modifier les notes pour « atteindre les objectifs » fixés par le plan de réussite. Cette façon de faire transforme aussi le rapport que le corps enseignant entretient avec la direction, qui se rapproche ainsi davantage du père Fouettard que de l’aide pédagogique espérée.
Chaque école doit produire un PEVR, mais les établissements ne peuvent se consulter entre eux pour savoir si leurs défis sont similaires, notamment d’un point de vue socio-économique, et ce, même s’ils sont situés dans le même quartier. Les écoles se retrouvent donc isolées et, par conséquent, fragilisées.
Je me demande d’ailleurs souvent ce qu’on doit réussir, au juste, comme enseignant·e·s. Donner des bonnes notes aux élèves ? Leur permettre d’accéder à des jobs payantes ? Acquérir de bons comportements ? Apprendre à vivre en société ? Certains de ces éléments me semblent difficilement mesurables. Il serait en outre très étrange de devoir comptabiliser avec précision le fait qu’un élève n’a pas poussé sa camarade à la récréation, ou de sortir une règle pour apprendre à vivre en société. Parce que l’éducation ne se réduit surtout pas à ce qui est objectivement mesurable ou quantifiable, n’en déplaise aux partisan·e·s de la gestionnite aiguë.