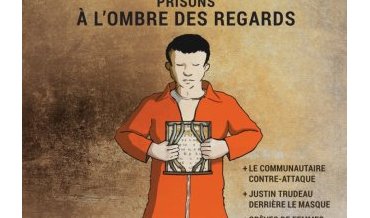Imaginez !
Allen - Farrow et la culture... du viol
Une autre gardienne d’enfants a dit à la police et juré en Cour que ce jour-là, elle a vu Allen la tête posée sur les genoux de Dylan, son visage tourné vers le corps de l’enfant, pendant que Dylan, assise sur le divan, « fixait la télévision d’un regard absent ». – Maureen Orth, Vanity Fair
La scène
Quand j’ai lu la lettre de Dylan Farrow parue en février dernier dans le New York Times, j’ai revu, en imagination, la scène qui ouvre le film de Robin Aubert À l’origine d’un cri. Cette scène, magistrale, ne montre rien sinon des poissons nageant dans un aquarium. Ce qu’il y a, toutefois, c’est du son : le bruit des vêtements qui s’ouvrent, le froissement des gestes, la voix du petit enfant, ses mots, ses gémissements. Puis, soudain, on n’entend plus rien, rien d’autre que des sons qui nous disent qu’il s’est tu. Qu’il ne peut plus parler parce qu’à ce moment-là, un crime est en train d’être commis – il est en train d’être violé.
Cette scène de Robin Aubert est insupportable à regarder parce que le cinéaste nous place, nous le public, dans la position de l’enfant. C’est l’enfant qui regarde les poissons nager, et on se fait violer avec lui. Une scène qui rappelle celle d’Anne-Claire Poirier dans Mourir à tue-tête, où la caméra occupe la place de la jeune infirmière en train de se faire violer. N’est-ce pas ce que Dylan Farrow demande à son tour dans sa lettre ? « Alors, écrit-elle, imaginez votre fille de sept ans qui se fait amener dans un grenier par Woody Allen. Imaginez que toute sa vie, elle aura la nausée à la seule mention de son nom. Imaginez un monde où on célèbre son bourreau. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Et maintenant, pouvez-vous dire quel est votre film préféré de Woody Allen ? »
On ne fera sans doute jamais la lumière sur cette histoire. Le temps est passé, le crime allégué n’a pas fait l’objet de poursuite au moment des faits, les représentants des deux camps accumulent les preuves dans une sorte de procès sur la place publique. Mais ce qui reste de tout ça (contrairement aux cas de Bertrand Cantat, jugé coupable, ou de Roman Polanski, qui a lui-même avoué son crime), c’est le doute. La lettre de Dylan Farrow dit : cet homme, que vous croyez innocent, est peut-être coupable. C’est ce « peut-être » qu’elle met en avant, un « peut-être » qui est une supposition, une chose qu’elle nous enjoint à concevoir comme possible... « Imaginez, dit-elle, imaginez »...
Voir la culture du viol
Et que doit-on imaginer, si on est prêt à entendre ce « peut-être », sinon la possibilité d’une culture où le viol est banalisé ? Une culture qui conçoit les femmes comme des biens à consommer ; un environnement social, médiatique qui banalise les violences sexuelles, voire les accepte ou les encourage ; qui accuse les femmes d’en être responsables et disculpe les hommes ; qui affirme qu’autant d’hommes que de femmes en sont victimes ; que les femmes mentent ou y prennent plaisir. Une culture qui affirme que le viol est dans la nature et refuse de se pencher sur la notion, justement, de culture du viol. Cette culture, c’est celle de millions de téléspectateurs assis devant les Oscars. C’est le monde de la publicité où les femmes sont non seulement dénudées, mais amalgamées à des objets, réifiées pour vendre des choses. Et plus on chosifie un être humain, comme le souligne la spécialiste des médias Jean Kilbourne, plus on se donne le droit de le violenter. De ça, l’histoire aura donné trop de preuves...
Cette culture, donc, est celle qui permet de ne pas entendre le « peut-être » énoncé par Dylan Farrow, parce qu’on préfère croire ceux qui détiennent le gros bâton du pouvoir (avec l’attirail légal et médiatique qui vient avec) plutôt que celles qui choisissent de les dénoncer. Toutes les raisons sont bonnes pour qu’elles se taisent. Car qui, au final, acceptera même de mettre en doute la parole de celui – célèbre ou non, d’ailleurs – qui jure qu’il n’a rien fait ? Parce qu’en vérité, comme l’écrit l’auteure Virginie Despentes dans King Kong Théorie : « Il n’y a vraiment que les psychopathes graves, violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tessons de bouteilles, ou pédophiles s’attaquant aux petites filles qu’on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol. Ce qu’ils pratiquent, c’est toujours autre chose. »
Les violeurs ordinaires sont à l’image des tueurs en série, ces tueurs dont les téléséries sont truffées, nos écrans (et la publicité) accumulant les corps de femmes violées, brutalisées, assassinées (ce que l’actrice Helen Mirren a récemment pointé dans The Guardian), alors qu’on cherche sans cesse le visage des responsables. Qu’on pense aussi à un documentaire comme The Invisible War, qui décrit le pacte de silence entourant le harcèlement et l’agression sexuels dans l’armée américaine. Là encore, tout est fait pour qu’on ne sache pas qui a commis les actes. Dans un système où la justice se fait à l’intérieur même du système (et où les détenteurs du pouvoir ont donc une sorte d’immunité), les femmes sont encouragées à douter de ce qu’elles ont vécu, comme si on les avait mystérieusement violées, dans une reconduction du mythe de l’Immaculée Conception. Un double message, donc : les hommes sont tous des violeurs, et en même temps, aucun ne l’est. Ainsi, le récit de Dylan Farrow concerne bien plus que le monde des gens riches et célèbres. Ce qu’elle pointe, c’est une culture qui sous-tend, permet et encourage l’invisibilité et le mutisme, chez les victimes autant que chez les agresseurs ou leurs témoins. Qu’on repense au long-métrage The Accused et qu’on remplace les clients du bar par les vedettes de Hollywood... Ou mieux encore : qu’on s’assoit, nous, avec eux.
« Ainsi, le récit de Dylan Farrow concerne bien plus que le monde des gens riches et célèbres. Ce qu’elle pointe, c’est une culture qui sous-tend, permet et encourage l’invisibilité et le mutisme, chez les victimes autant que chez les agresseurs ou leurs témoins. »
L’imagination est politique
Je ne sais pas si on doit séparer l’homme et l’œuvre, rejeter l’œuvre parce que l’homme a été accusé ou trouvé coupable de crime. Je ne sais si on peut tout mélanger : la pensée (celle, antisémite, d’un Louis-Ferdinand Céline, par exemple) et les actes, les gestes de violence posés dans la réalité. Mais ce que je sais, c’est qu’il faut parler, qu’il faut mettre ces choses sur la place publique pour pouvoir y réfléchir. Pour qu’on soit forcé d’y penser.
Ce que je sais, c’est que je veux avoir le droit de ne pas acheter de billets pour le prochain spectacle de Bertrand Cantat, ou au contraire d’en acheter un pour pouvoir aller le huer. Je veux avoir la possibilité d’écrire un texte en réaction aux accusations de Dylan Farrow envers Woody Allen pour qu’on n’oublie pas ses mots et qu’on essaie, plutôt, de les penser. Parce qu’au bout du compte, non seulement il faut sortir du silence, mais il faut être capable d’imaginer. Notre imagination doit être confrontée à des scènes d’abus de pouvoir si on veut, un jour, les voir cesser. On parle sans cesse de viol, d’inceste, mais est-ce qu’on sait vraiment ce que ça veut dire ? Comme le demande l’écrivaine Christine Angot : est-ce qu’on sait comment ça se compose, comment ça se décompose, comment ça se suit, comment ça s’entraîne… ?
C’est à cet effort-là d’imagination que nous convie Dylan Farrow, nous invitant à regarder la scène, politique, d’un autre cinéma…