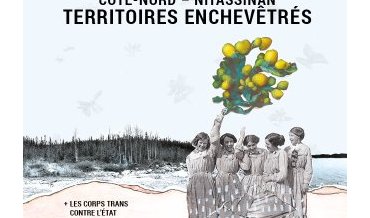Venezuela
Trois mois de sanglantes protestations
International
Depuis février 2014, le Venezuela est le théâtre de violents affrontements entre des manifestant·e·s anti-régime et les forces répressives qui ont déjà coûté la vie à 42 personnes, fait plus de 800 blessés et conduit à la détention de plus de 2 500 personnes en trois mois. Un an après la mort du charismatique président vénézuélien Hugo Chávez, le pays s’enlise dans une crise économique, sociale et politique dont son successeur, Nicolás Maduro, ne semble pas en mesure de sortir. Impasse entretenue également par une opposition ayant opté pour une voie insurrectionnelle qu’elle ne semble pas plus capable de mener jusqu’au bout. Y a-t-il des pistes d’avenir ?
Au début de l’année, il ne s’agissait que de petites manifestations éparses, organisées via les réseaux sociaux liés à l’opposition, dénonçant l’insécurité, l’inflation et les pénuries. Pourtant, après l’arrestation, le 6 février, de trois étudiants de l’Université catholique de Táchira (État à l’extrême ouest du pays, à 800 km de Caracas), une plus grande part du mouvement étudiant et de la société civile se joint à la journée nationale de manifestations du 12 février convoquée par les figures les plus radicales de l’opposition : Antonio Ledezma, María Corina Machado et Leopoldo López. Depuis, les manifestations et affrontements sont quasi quotidiens.
Paradoxalement, la répression abusive d’une manifestation étudiante servira à légitimer et à massifier la convocation à un mouvement de protestation qui, au départ, était loin de faire l’unanimité, même dans les rangs de l’opposition. Henrique Capriles, – ancien candidat présidentiel en 2013 [1] et, jusqu’alors, leader incontesté de l’opposition –, était contre ces manifestations, préférant la dénonciation institutionnelle et la négociation avec le gouvernement à une politique de la rue. Pourtant, face à l’intensification de la répression et à sa perte accélérée de popularité, Capriles a dû ajuster sa stratégie et reprendre un discours plus antagonique vis-à-vis du gouvernement.
Un piège manichéen, source de l’impasse politique
Le Venezuela se trouve ainsi, encore une fois, embourbé dans un piège manichéen entretenu par la dynamique de l’affrontement entre, d’un côté, un gouvernement accusant les manifestations de « conspiration putschiste », « terroriste » ou « nazi-fasciste », fomentée et subventionnée par l’impérialisme et, de l’autre, l’opposition traitant le régime de totalitarisme ou de dictature castro-communiste avec laquelle aucune négociation ne saurait être envisageable. Bien qu’aucun de ces dénigrements croisés ne corresponde à la réalité, en s’intéressant à leurs fondements historiques, on peut tenter de cerner les enjeux qu’ils cachent ou déforment.
Ainsi, lorsque le gouvernement parle de « conspiration putschiste », il renvoie directement à la tentative de coup d’État du 11 avril 2002, à laquelle ont d’ailleurs participé les actuels leaders de l’opposition. Il existe effectivement plusieurs parallèles entre les deux situations. Ce putsch avorté – qui avait chassé Chávez du pouvoir pendant 48 h – est survenu après qu’une manifestation massive de l’opposition se soit soldée par la mort de 19 personnes. Ces assassinats ont d’abord été attribués à la répression exercée par le régime, notamment en fonction d’un montage médiatique montrant des chavistes tirant des coups de feu puis des images de morts et de blessés du côté des manifestant·e·s. Il s’est ensuite avéré que les chavistes en question ne tiraient pas sur la foule, mais sur des francs-tireurs postés sur les toits des édifices.
C’est sur la base de cette participation complice des médias privés à une tentative de coup d’État que le gouvernement de Chávez a retiré les permis de diffusion aux chaînes de radio et de télévision qui auraient participé à cette conspiration. Sur le même modèle, Maduro continue la « guerre médiatique », en menaçant d’expulser CNN du Venezuela et en poursuivant le harcèlement des journalistes d’opposition (eux-mêmes tendancieux dans leurs propos, il faut l’avouer). Toutefois, alors que Chávez a sévi plusieurs années après les faits et sur la base de certaines évidences, Maduro, lui, accuse de putschiste et de fasciste n’importe quelle position critique vis-à-vis de son gouvernement, versant ainsi dans la criminalisation de l’action collective et la banalisation de l’état d’exception.
Cette « suspension » non officielle du droit se constate entre autres par l’arrestation, le 18 février, du principal leader des manifestations Leopoldo López, sous des charges, entre autres, d’incitation à la délinquance et à l’émeute, d’incendie criminel d’un bâtiment public, d’homicide et de terrorisme. Ces deux dernières charges ont finalement été retirées de l’acte d’accusation, mais López se trouve encore détenu dans la prison militaire de Ramo Verde, en attendant un procès constamment reporté, dans le but apparent de le réduire au silence. Les deux autres instigateurs des manifestations (Ledezma et Machado) sont quant à eux sous de constantes menaces de procès ou d’arrestations.
Pourtant, aussi exécrable que soit l’attitude répressive du gouvernement Maduro, cela ne fait pas de lui un « régime totalitaire castro-communiste ». Hélas, le versant autoritaire des gouvernements « représentatifs » se vérifie trop souvent ailleurs. Sans aller plus loin qu’ici même au Québec, la « loi d’exception » (spéciale) numéro 12 a suspendu une série de garanties constitutionnelles, criminalisé l’action collective et rendu responsables les associations étudiantes (politiques ou syndicales) pour les conséquences des manifestations auxquelles elles participeraient. De la même manière, le gouvernement Maduro rend criminellement responsable Leopoldo López des incendies, exactions et morts survenus lors des manifestations et considère les manifestations « sans itinéraire » comme un délit, en les associant à la violence.
#LaSalida [La Sortie]
Bien que le nombre d’incarcérés et que la gravité des accusations soient autrement plus sévères au Venezuela qu’au Québec, il faut également mettre en perspective les prétentions explicitement insurrectionnelles des manifestations. Convoquées dès le départ sous le mot-clic #LaSalida sur Twitter, ces manifestations sont marquées à la base par l’objectif d’un renversement (c’est-à-dire La Sortie) du gouvernement, considéré comme une dictature malgré son élection en avril 2013 et sa confirmation aux municipales en décembre. L’opposition avait d’ailleurs donné à ces élections municipales un caractère « plébiscitaire », devant servir à montrer l’ampleur du rejet populaire du gouvernement. Pourtant, le Parti socialiste unitaire du Venezuela (PSUV) a obtenu 240 des 337 mairies alors que l’opposition n’en a gagné que 75 – augmentant toutefois son poids dans des villes d’importance. Devant l’échec de la voie électorale, l’équilibre des forces au sein de l’opposition bascule du côté de sa frange la plus radicale, posant la révolte populaire comme moyen de « sortie » du régime.
Disputant au chavisme le discours révolutionnaire et patriotique, l’imaginaire politique porté par les manifestant·e·s s’identifie aux Indigné·e·s d’Europe, au Printemps arabe, au mouvement #YoSoy132 du Mexique [2], mais surtout au mouvement de la place Maïdan à Kiev qui est parvenu à destituer le président Ianoukovitch, en même temps que se déroulait le mouvement protestataire vénézuélien. Pourtant, les manifestations vénézuéliennes ne sont pas parvenues à atteindre l’ampleur des mouvements auxquels elles s’identifient. De même, contrairement aux grandes marches de 2002 (avant et après la tentative de coup d’État) qui dépassaient largement la centaine de milliers de manifestants, l’actuel mouvement atteint rarement la dizaine de milliers. Les actions se caractérisent davantage par leur quotidienneté, leur étalement dans plusieurs villes du territoire et leur radicalité.
Impasse du dialogue pour une « sortie » de crise pactisée
Le 14 mai dernier, à peine un mois après l’ouverture d’un « dialogue national », sous l’égide du Vatican et de l’UNASUR (Union des nations sud-américaines), l’opposition a quitté la table des négociations, invoquant la mauvaise foi du gouvernement qui aurait augmenté l’intensité de la répression depuis l’enclenchement du processus de dialogue. Ayant misé sur l’essoufflement et l’isolement des manifestations les plus radicales, le gouvernement n’est certainement pas pressé de conclure un quelconque accord. C’est pourquoi il rétorque que ce sont les exigences de l’opposition qui sont exagérées et qu’il ne saurait être question de mettre en péril le droit, la démocratie et la révolution en amnistiant des criminels (prisonniers politiques) ou en donnant du pouvoir de décision à des représentants non élus (l’opposition) pour qu’ils appliquent des mesures néolibérales ramenant le pays 15 ans en arrière.
Dans cette lutte entre deux positions irréconciliables, les principales perdantes sont la population, la démocratie et la politique. Les problèmes relatifs à l’insécurité, à l’inflation, aux pénuries et au respect des principes et institutions démocratiques n’arrivent jamais à être abordés, car les deux camps considèrent leur adversaire comme un mal politique avec lequel on ne peut rien négocier, mais qu’on doit seulement éradiquer ou faire tomber. Il s’agit pourtant de problèmes qui requièrent des diagnostics nuancés et des solutions impliquant l’ensemble des acteurs.
L’insécurité, par exemple, a atteint des niveaux faramineux et inquiète l’ensemble de la population. Les méthodes « participatives » et « intégrales » mises de l’avant par le gouvernement ont de toute évidence échoué, avec un taux d’homicides de 55 morts violentes par 100 000 habitants en 2012. Par contre, une politique répressive de type « tolérance zéro », comme semble le suggérer l’opposition, ferait énormément de « victimes collatérales » chez les jeunes des quartiers populaires. Pour aborder cette délicate question, il faudrait pouvoir le faire en incorporant un grand spectre de positions concernées.
De même pour le problème de l’inflation et des pénuries, dans un pays bénéficiant d’une manne pétrolière. Le contrôle strict du marché des devises par l’État visait à éviter la fuite de capitaux après la défaite de la grève insurrectionnelle de 2002-03. Ce contrôle est contre-productif aujourd’hui, mais il faudrait une solution plus juste que celle de l’opposition qui propose de légaliser la fuite des capitaux.
Dans tous les cas, la solution qui permettrait d’aborder au mieux l’ensemble des problèmes du Venezuela résiderait dans un respect mutuel des principes démocratiques, cessant de voir dans l’adversaire politique un ennemi à abattre.
[1] Ayant presque réussi l’exploit de battre Maduro avec 49,1 % des votes (7 363 980) contre 50,6 % pour Maduro (7 587 579).
[2] Le mouvement #YoSoy132 dénonce la « manipulation de masse » engendrée par la collusion entre le pouvoir politique et les grands conglomérats médiatiques, et réclamant un vote « libre, raisonné et informé ».