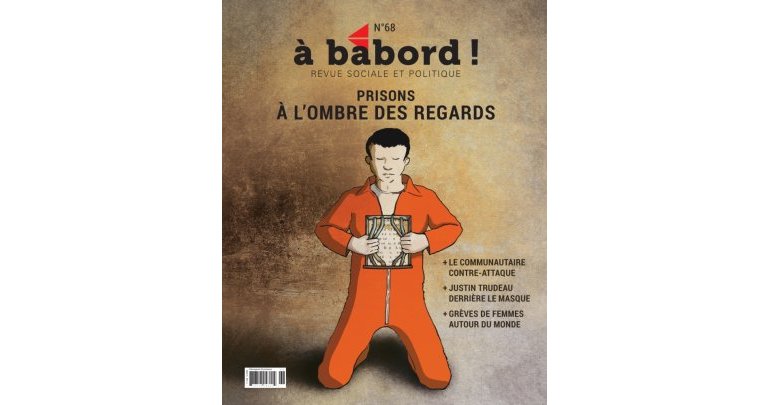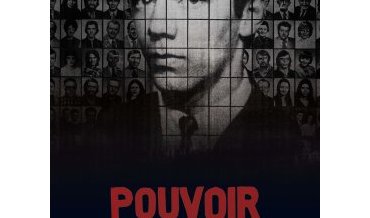Chronique Travail
À quand un vrai droit à la déconnexion ?
La réforme du Code du travail français – adoptée sous le bâillon en 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017 – propose, dans l’extrême majorité des cas, des mesures en défaveur des travailleurs·euses prenant la forme, par exemple, d’une simplification des conditions nécessaires au congédiement ou d’une augmentation du nombre hebdomadaire d’heures de travail.
Certaines des nouvelles dispositions adoptées ont du potentiel, mais le gouvernement n’a pas su – voulu – prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient correctement applicables. Prenons l’exemple du droit à la déconnexion.
Une surconnexion qui rend malade
Le développement des nouvelles technologies est de plus en plus rapide. De très nombreux travailleurs et travailleuses sont équipés d’outils numériques. Lors de leur apparition, ces outils permettaient une plus grande flexibilité du travail, notamment la possibilité de télétravailler. Aujourd’hui, les ordinateurs portables, les téléphones intelligents et autres tablettes sont entrés au bureau, mais aussi au domicile des travailleurs·euses, allant jusqu’à les suivre sur les pistes de ski ou à la plage… Bref, ils envahissent de plus en plus la sphère de la vie personnelle.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer l’incapacité des travailleurs·euses à « décrocher » : une hiérarchie tyrannique, la crainte d’être mal vu auprès de ses collègues, le désir d« performance, l’envie de demeurer un bon soldat… tout simplement être incapable d’éteindre son téléphone intelligent en dehors des heures de travail.
Non seulement la surconnexion s’immisce insidieusement dans la conciliation travail-famille ou travail-vie personnelle, mais elle rend malade. Il s’agit là d’une réalité implacable. Plusieurs études sur la santé et la sécurité au travail font état du lien entre l’usage abusif des nouvelles technologies et la dégradation de l’état de santé. Tout cela a un coût financier, mais aussi un coût social très élevé. Certaines personnes deviennent ainsi à bout de force et sont victimes d’épuisement professionnel, alors que d’autres en viennent à poser le geste fatal, parfois sur leur lieu de travail, en identifiant clairement leur emploi comme cause de leur suicide dans les messages qu’ils et elles laissent derrière eux.
La surconnexion est un dérapage de l’organisation du travail causé par les outils numériques : la personne épuisée est loin d’être la seule responsable de son état. Ainsi, la déconnexion ne doit pas relever de décisions prises isolément, mais de concertations et d’actions collectives.
Déconnexion à la française
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les discussions autour d’un droit à la déconnexion ne datent pas d’aujourd’hui : des chercheurs français en parlaient déjà dans les années 1970 et 1980. La loi El Khomri (du nom de la ministre du Travail en France) vise « l’adaptation du droit du travail français à l’ère du numérique ». De quoi parle-t-on exactement ? Aucun indice ou presque dans la loi !
Selon le nouveau Code du travail, l’encadrement de l’utilisation des outils numériques doit « assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ». Ces dispositions doivent être négociées par les parties syndicale et patronale, au sein de l’entreprise. Le fait que le droit à la déconnexion fasse l’objet d’une négociation collective obligatoire constitue un point positif. Effectivement, dans la mesure où les modalités d’application de cette mesure vont être décidées collectivement, il y a plus de chance qu’elles soient respectées.
Là où le bât blesse, c’est qu’en l’absence d’accord entre les parties, le choix ultime revient à l’employeur ! Il va ainsi décider seul du contenu de ces modalités au moyen d’une « charte », après avoir recueilli le simple avis, non contraignant bien entendu, des représentant·e·s des travailleurs·euses. Comment peut-on sérieusement parler de négociation obligatoire lorsque l’employeur peut refuser de signer un accord et, après coup, formuler lui-même les conditions d’application de « sa » charte ? En outre, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de la loi. Il s’agit d’une loi sans mordant, dont les chances d’effectivité laissent fortement à désirer.
Le législateur aurait dû prévoir des définitions claires de modalités d’application du droit à la déconnexion telle qu’une trêve de courriels au cours des fins de semaine, par exemple.
Quid du contrôle de l’application de ce droit ? Il y a trop peu de commissaires du travail disponibles pour enquêter sur le bon usage des outils numériques. Le contrôle virtuel ne serait pas trop difficile à mettre en œuvre, mais de quel personnel dispose-t-on pour l’effectuer ?
Des mesures de déconnexion existent déjà dans certaines entreprises : France Telecom (devenue Orange en 2013) a mis sur pied une sorte de droit à la déconnexion il y a quelques années déjà. Celui-ci a été mis en place après une vague de suicides sur les lieux de travail, précisément en raison des conditions de travail qui y avaient cours. En Allemagne, Volkswagen débranche les serveurs de courriels entre 18h et 7h le lendemain matin ainsi que les fins de semaine.
Déconnexion québécoise ?
Au Québec, l’entreprise Normandin-Beaudry, un bureau d’actuariat, est devenue en 2016 l’un des premiers employeurs à adopter des mesures de déconnexion. Les effets positifs se font déjà ressentir : les travailleuses et travailleurs sont plus reposés, moins stressés, plus performants. La direction doit donner l’exemple : ses représentant·e·s ne doivent pas envoyer de courriels le soir et les fins de semaine afin que les salarié·e·s ne se sentent pas obligés d’y répondre, ce qui reviendrait à travailler pendant leur temps libre.
Si une telle mesure devait être généralisée chez nous, il faudrait une intervention législative évitant de nombreux écueils, notamment ceux évoqués ici. D’emblée, il serait indispensable de garantir l’obligation de négocier collectivement les modalités d’application du droit à la déconnexion. Pour ce faire, il faudrait intégrer le thème de la déconnexion dans les conventions collectives lors de la signature d’une première convention ou lors de son renouvellement. En cas de désaccord entre les parties patronale et syndicale, il conviendrait de recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage de différends. De plus, il faudrait absolument prévoir des modalités claires relatives à l’usage des appareils numériques pendant certaines périodes ainsi que des définitions permettant de distinguer le temps de travail et le temps de repos. Il existe de nombreuses zones grises actuellement, le temps de disponibilité des travailleurs·euses par exemple.
Le sujet est donc délicat. Peut-être y aurait-il lieu d’adopter la proposition figurant au PACT (voir encadré), à savoir distinguer purement et simplement le temps de travail du temps libre. Nous aurions une définition binaire, simple à évaluer, qui permettrait peut-être de contourner le problème du temps de disponibilité au travail. Si les travailleurs·euses ne peuvent pas vaquer à leurs occupations personnelles, ils et elles travaillent, point. Il va sans dire que ce sujet commande une réflexion plus fine.
La généralisation du droit à la déconnexion serait très bénéfique pour les travailleuses et travailleurs attachés à leur cellulaire, tant pour leur santé psychologique que physique. Aussi, par cette mesure, peut-être pourrions-nous dépasser la symbolique conciliation travail-famille, qui demeure fondamentale, pour viser quelque chose de plus ambitieux permettant la conciliation temps de travail et temps libre. D’une part, le droit à la déconnexion rendrait le travail plus humain en permettant de connaître son réel emploi du temps, d’autre part il répondrait au besoin social d’un temps libre collectif.