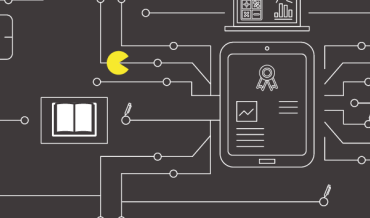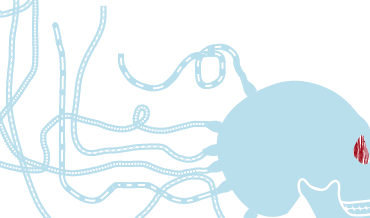Éducation
Tableaux interactifs, iPad et autres passions technophiles
En novembre 2012, le gouvernement Marois a annoncé qu’il mettait fin au programme d’achat de tableaux blancs interactifs (TBI) qui avait été lancé l’année précédente par le gouvernement Charest. Cet ambitieux programme, au parfum de scandale et de favoritisme (le fournisseur quasi unique de tous les TBI était Smart Technologies, dont le lobbyiste est un ancien membre du cabinet Charest), prévoyait, sur cinq ans, l’achat de plus de 40 000 de ces tableaux, à un coût estimé de… 240 millions $ !
Dans un milieu qui, non sans raison, crie constamment au manque de ressources, l’importance de cette somme en avait fait tiquer plus d’un. D’autant que le simple bon sens permettait d’affirmer que ces appareils, si (et c’est un gros si…) ils peuvent aider à faire apprendre, ne le pourront qu’à la condition que des sommes conséquentes soient dépensées pour former les futurs utilisateurs. Cela aussi, cette fois encore, a fait défaut.
Le « pathos de la nouveauté » technologique
Quoi qu’il en soit, l’abandon du programme est peut-être encore moins intrigant que son lancement. La recherche crédible, en effet, ne permettait pas et ne permet toujours pas d’affirmer que de tels outils sont globalement bénéfiques pour l’apprentissage, et que cet investissement, important, soit en lui-même une bonne idée pour le primaire ou le secondaire. Et cette conclusion vaut en gros pour toutes les nouvelles technologies, qui, en soi, ne sont pas des panacées et qui peuvent ou non être utiles pour apprendre – selon le contenu qu’elles permettent de présenter et les caractéristiques des élèves concernés.
Pour ce qui est du niveau universitaire, au même moment où on annonçait la fin du programme d’achat des TBI, une étude financée en partie par la Conférence des recteurs et des principaux du Québec (CREPUQ) concluait que les étudiantes et étudiants universitaires préfèrent les méthodes d’enseignement traditionnel et s’enthousiasment moins pour les nouvelles technologies éducationnelles que leurs enseignantEs. Un des responsables de l’étude se disait étonné que « les nouveaux outils d’apprentissage, ce n’est pas ce que les étudiants demandent en priorité. Ce qu’ils veulent, ce sont des professeurs inspirants et stimulants intellectuellement. » Cet étonnement étonne…
Devant la technophilie galopante qui frappe tant de gens en éducation (une de ses dernières manifestations est l’engouement pour les iPad), on est irrésistiblement tenté de convoquer Hannah Arendt qui appelait « pathos de la nouveauté » cette maladie affligeant une école empressée de s’ouvrir au monde et à ce qui s’y propose inlassablement comme nouveau et amélioré, au mépris de l’idée que l’école est là pour préserver, conserver et transmettre, et que pour cela elle doit rester largement insensible aux chants des sirènes de la nouveauté, fut-elle high-tech. En somme, le pathos de la nouveauté technologique n’est que la dernière version du pathos de la nouveauté, et il ne vaut sans doute guère mieux que le précédent.
Le moment me semble bien choisi pour rappeler quelques vérités élémentaires que nous apprennent les sciences cognitives à propos des nouvelles technologies en éducation. Elles ne feront pas de vous d’irrémédiables technophobes – et je n’en suis moi-même pas un, loin de là –, mais elles instillent ce minimum de sain scepticisme qui, s’il était répandu, nous aurait peut-être évité la débâcle des TBI. Je me servirai pour ce qui suit d’un riche article de synthèse de Daniel T. Willingham, un auteur dont je ne saurais trop recommander la lecture sur ces questions [1].
Intérêt pour les NTIC et aptitude au mode multitâche
Pour commencer, c’est un fait indéniable que les plus jeunes utilisent beaucoup les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et sont à l’aise avec elles, en particulier pour travailler en mode multitâche : ils prennent leur courriel pendant qu’ils rédigent un texte sur leur portable en écoutant de la musique tout en lisant un texto qui vient de rentrer.
On voit parfois dans ces deux faits (forte utilisation des nouvelles technologies et habileté à pratiquer le mode multitâche) des arguments décisifs en faveur de l’introduction de ces nouvelles technologies à l’école. On dira alors que ne pas avoir recours aux NTIC et obliger à se concentrer sur une seule tâche semble la meilleure recette pour offrir à ces jeunes – eux qui, selon la doxa, apprennent sans doute différemment du fait de leurs pratiques – une école profondément ennuyante.
Mais c’est négliger deux choses.
C’est d’abord oublier ce fait capital que ce ne sont pas les technologies en soi qui stimulent l’intérêt, mais le contenu auquel il permet d’accéder. Comme le dit Willingham, un enfant qui ne pourrait utiliser son cellulaire que pour appeler sa mère ne le trouverait pas très intéressant.
À propos des TBI, justement, des études ont été menées, notamment en Grande-Bretagne où on en a acheté pour équiper toutes les écoles ou peu s’en faut. Ces études confirment pour l’essentiel que l’intérêt des enfants pour le TBI ne se traduit que très modestement – et encore : à condition que son utilisation soit réfléchie et préparée – en intérêt pour le contenu enseigné.
C’est là une conclusion qui n’est pas trop surprenante et n’importe qui, je pense, prendrait toujours Socrate pieds nus et ne disposant que de sa seule parole pour capter l’attention avant n’importe qui d’autre, équipé de toutes les nouvelles technologies qu’on voudra.
J’en viens à la deuxième idée, celle qui veut que le mode multitâche qu’ils pratiquent tant et pour lequel ils semblent si doués impliquerait que les plus jeunes générations vont trouver ennuyante une école qui n’invite pas à le pratiquer. Cette conclusion est encore une fois erronée et ne prend pas en compte ce qu’on sait désormais sur la pratique du multitâche.
Les plus jeunes sont en effet meilleurs que les personnes plus âgées pour le pratiquer : mais ils le sont indépendamment de leur pratique, ils le sont d’emblée, naturellement, sans doute parce que leur mémoire de travail, en vertu de leur âge, est meilleure. Des jeunes personnes qui ne touchent pas ou très peu aux NTIC sont en fait aussi bonnes pour le mode multitâche que d’autres qui le pratiquent sans cesse ! De plus, et de toute façon, le seul fait qu’ils soient bons à cette pratique n’implique pas que celle-ci doive être adoptée en éducation ou qu’elle soit judicieuse pour apprendre.
Or, une chose est désormais acquise par la recherche : ce n’est presque jamais une bonne idée que de faire plusieurs choses à la fois (comme parler au téléphone en conduisant) et de passer de la sorte d’une tâche à une autre. On est meilleur en se concentrant sur une tâche qu’en en faisant plusieurs à la fois. Cela est même vrai du simple fait de faire ses devoirs devant la télé : on les fait mieux si la télé est fermée (la musique – avec ou sans paroles, ce n’est pas clair – pourrait être une exception à cette règle…).
Plus étonnant encore, rapporte Willingham, on a montré en laboratoire que les jeunes adultes qui pratiquent beaucoup le mode multitâche sont moins bons dans les tâches cognitives que les autres, qui le pratiquent moins. Ce fait signifie sans doute non que la pratique du multitâche les a rendus moins bons, mais que les personnes qui sont moins bonnes à ces tâches cognitives sont plus enclines à papillonner et donc à pratiquer le mode multitâche.
[1] Daniel Willingham, « Have technology and multitasking rewired how student learn ? », American Educator, Summer 2010, pp. 23-28 et p. 42.