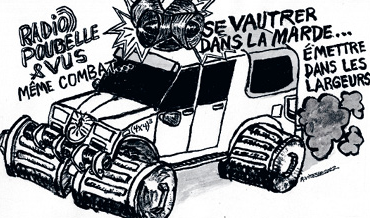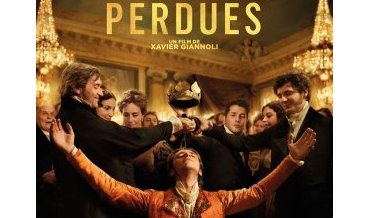Penser le journalisme dans un monde en crise
par Jean Pichette
Il faut prendre au sérieux la prétention des journalistes à se voir comme « chiens de garde de la démocratie » pour saisir l’ampleur des dérives actuelles de l’idéal moderne d’autonomie collective, classiquement entendu comme la capacité de la société de prendre en main son histoire. Appréhender le journalisme en le confrontant à sa doxa [1] permet alors de resituer la crise contemporaine du journalisme dans le miroir de la crise du politique. Cela ne fait bien sûr pas disparaître le problème extrêmement grave de la marchandisation de l’information, mais permet de le resituer dans une logique plus large, la désymbolisation du monde, qu’il faut comprendre pour saisir les enjeux fondamentaux à l’œuvre dans les transformations du journalisme et des médias. Du coup, les analyses centrant leurs critiques sur des considérations économiques montrent rapidement leurs limites, incapables qu’elles sont de penser la nécessité d’instituer un espace de représentation au sein de la société. La « radicalité » de certaines critiques peut dès lors être vue comme le complément innocent – l’allié « objectif » – d’une dynamique de destruction de toute médiation réfléchie au sein de la société.
Un espace public de débat
Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler le lien historique très étroit entre la démocratie et les médias, qui vont soutenir le développement d’un espace public permettant de débattre collectivement des enjeux sociopolitiques et des orientations normatives du monde. Le journalisme affleure ainsi en tant que médiation : il ne s’agit plus de faire entendre une parole de vérité émanant d’« en haut » mais de favoriser un débat entre citoyens « éclairés », aptes à déterminer les formes d’un monde qui n’apparaît donc plus comme quelque chose de donné mais plutôt à construire. Le journalisme est donc indissociable de la construction d’un espace politique dans lequel la société se dédouble, se distancie d’elle-même pour se représenter, se réfléchir – dans le double sens du terme : se donner une image d’elle-même, qui pourra lui apparaître comme un projet à réaliser, et se penser.
C’est là une dimension fondamentale – et fondatrice – du journalisme qu’il faut garder à l’esprit pour jauger la situation présente : le journalisme, comme le politique, se constitue dans un écart, une distance creusée au sein même de la société. Ce lieu de repli sur soi, cette mise à distance du monde, du dedans de celui-ci, portait bien sûr l’idéal d’un rapport réfléchi et critique à la réalité, que devait en quelque sorte incarner la figure du citoyen. Le journalisme permettait ainsi la mise en forme symbolique du conflit social : indissociable de l’idéal démocratique, il ouvrait à la parole la possibilité de construire pacifiquement, à travers le débat, une représentation différente du monde pouvant devenir moteur de transformation de la société. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que le journalisme – ni d’ailleurs le politique ou le projet éducatif moderne – a connu un âge d’or où il aurait été à la hauteur de cet idéal mais de rappeler que seule cette volonté d’instaurer une distance critique face à la réalité a permis à la pratique journalistique d’apparaître légitime dans le mouvement de constitution d’un espace public de débat. Que la pratique n’ait pas toujours été conforme à son idéal constitutif est une chose ; qu’elle renonce massivement à tout idéal pour devenir un simple exercice de communication parmi d’autres devrait toutefois suffire à nous convaincre qu’une mutation profonde du journalisme est en cours depuis peut-être déjà un siècle.
C’est sur cette toile de fond qu’il nous faut aujourd’hui penser le journalisme, alors que sont remises en question toutes les formes de médiation – y compris le politique – que la modernité avait jugé fondamentales pour la construction du monde. Nous vivons désormais dans un monde où tout écart est vu comme suspect et où la transparence apparaît comme la vertu cardinale favorisant un accès im-médiat, réputé « authentique », à la réalité. Le choix des mots n’est pas ici anodin : que peut en effet signifier le journalisme (ou, plus largement, les médias) dans un monde valorisant l’immédiateté – la négation des médiations ? Comment penser le travail journalistique dans un contexte social où les médiations apparaissent non pas constitutives de la réalité mais comme des obstacles voilant cette réalité, bloquant l’accès à son « essence » ?
La question qui se trouve ainsi posée est au fond très simple : les normes émergeant d’un espace public de réflexion font-elles partie de la réalité, qu’elles contribueraient ainsi à mettre en forme, ou lui sont-elles plutôt fondamentalement étrangères ? L’enjeu est loin d’être théorique : l’approfondissement du tout-à-l’économie ambiant – dans ses versions tant néolibérale que néomarxiste – requiert en effet la remise en cause de la légitimité de la médiation politique, avec les limites que celle-ci assigne nécessairement aux prétentions à l’autonomie et à la toute-puissance individuelles. Disons les choses autrement : l’économie se construit sur une conception individualiste de l’homme, réputé entrer dans un rapport à autrui sur une base fondamentalement intéressée. Dans cette optique, le symbolique, la culture, n’apparaissent plus comme des données fondatrices de l’expérience humaine. La société peut alors être réduite en un lieu où s’entrechoquent des atomes portant des intérêts spécifiques et pouvant éventuellement s’associer entre eux pour la défense de ces intérêts. Elle cesse donc de pouvoir être appréhendée comme un lieu – vivant – de culture capable de se réfléchir ; elle devient un objet analysable par une espèce de physique des rapports sociaux où, pourrait-on dire avec Marx, « le mort saisit le vif », dans la mesure où tend à n’être saisi comme « réel » que ce qui échappe à toute visée subjective, si ce n’est celle résultant de tendances statistiques. C’est ainsi que, par anthropomorphisme naïf – mais surtout ridicule – on peut prêter une intentionnalité au marché boursier alors même qu’on traite de plus en plus de gens comme de simples objets, malléables au point de pouvoir en disposer librement après usage, tels des déchets.
Crise de la représentation
La désymbolisation du monde évoquée plus haut trouve dans cette dynamique son point d’ancrage : la société étant désormais vue comme le produit empirique d’interactions entre atomes individuels, tout détour par la représentation paraît suspect, comme un voile jeté sur la réalité pour en cacher les aspects fondamentaux. On comprend dans cette optique que le journalisme devienne lui-même objet de suspicion, peu importe les modalités concrètes de son exercice : que peut en effet signifier le projet de représenter la réalité quand l’idée même de représentation s’apparente à un dessein de dissimulation, comme si les mots, loin d’être la chair du rapport humain au monde, pouvaient être réduits à de simples vecteurs de mensonge ? La crise du journalisme doit ainsi être inscrite dans le même horizon de pensée que celle d’autres types de représentation (littérature, théâtre, arts visuel, etc.) : toutes les formes de narration de la réalité, par lesquelles celle-ci se réfléchit, sont aujourd’hui sous la loupe du soupçon et participent de ce qu’on peut identifier comme une crise de la représentation. La difficulté de penser la représentation comme exigence d’une distance à soi de la société est perceptible, notamment, dans la réduction de l’idée même d’une crise de la représentation en un simple manque de représentativité de divers segments de la société au sein des institutions politiques. Le nombre de ces « bouts de réalité » étant multipliable à l’infini (femmes, homosexuels, patrons, handicapés, groupes ethniques, travailleurs, chômeurs, gens des régions, etc.), la sortie de cette crise passerait ainsi par la constitution d’une carte de la réalité à une échelle 1:1, comme la réalise le cartographe d’un texte de Borges, rendant du coup visibles tous les segments (réputés exister de façon autonome) de la réalité. On peut alors se demander, bien sûr, quel est l’intérêt d’avoir une représentation qui n’est en fait qu’une duplication de la réalité, réalité ainsi vidée de toute tension interne (entre ce qu’elle est et ce qu’elle pourrait être si on la voulait autrement). Mais n’est-ce pas là précisément le projet du journalisme contemporain : dresser un portrait empirique de la réalité par addition de bouts de réalité réputés indépendants entre eux, en s’abstenant, surtout, sauf à sombrer dans le crime de lèse-réalité qu’on appelle « idéologie », de faire des liens entre ces moments du réel ? Un scandale politique, ici ; une famine, là ; un meurtre sordide, ici ; une annonce d’investissement, là ; une grève d’athlètes professionnels, ici, etc.
L’effet le plus notable de ce rétrécissement de la distance entre la réalité et la représentation qu’on s’en fait est d’enfermer le réel dans ce qu’il est : l’espace public apparaît de moins en moins comme un lieu où pourrait légitimement être pensé le dépassement de ce qui est par la projection dans une altérité (un autre monde) qu’on estimerait souhaitable, sur la base de normes débattues collectivement. L’immédiateté, c’est la présentation du monde dans son « évidence » empirique, incontournable, inquestionnable : le monde étant ce qu’il est, il faudrait simplement s’y adapter, ainsi que le clament en chœur nos élites médiatico-politiques. Sur le plan journalistique, cette valorisation de l’immédiateté se traduit par l’affirmation d’une neutralité qui place en son centre l’idéal d’objectivité. Dès les années ‘20, le journaliste et sociologue américain Walter Lippmann appelait ainsi de ses vœux une professionnalisation du journalisme passant selon lui par l’adhésion stricte à l’idée d’objectivité, telle que promue par la connaissance scientifique. La complexification du monde, estimait-il, avait rendu caduc l’idéal du citoyen éclairé : le journaliste devait dès lors se mettre au service des experts, seuls aptes, à ses yeux, à gérer les problèmes sociaux. Invité à favoriser la professionnalisation (ou la technocratisation) du politique, le journaliste allait ainsi nourrir de facto la dépolitisation de l’espace public. Les problèmes sociopolitiques devant être pris en charge par les « experts », le débat public perdait en effet sa raison d’être : rien ne sert de débattre, de questionner les finalités d’une logique abandonnée à elle-même, il faut permettre à ceux qui savent de gérer la réalité. Cette « privatisation du public » – qui accorde à l’« expert » une place privilégiée dans l’espace public – allait très rapidement trouver son complément inverse dans la « publicisation du privé », permettant au journaliste de se sentir justifié d’amener dans l’arène publique des informations à caractère privé – potins et autres commérages – concernant des hommes et des femmes publics.
Ce brouillage entre le « public » et le « privé », au profit de la reconnaissance graduelle d’un espace de gestion unifié, indifférencié, achève de dissoudre l’idée d’une capacité collective de décider de l’orientation du monde et de mandater en ce sens une puissance publique légitime. Il nourrit au contraire un sentiment d’impuissance et de fatalité – « de toutes façons, les experts s’en occupent » – qui fait des citoyens de moins en moins des acteurs et de plus en plus de simples spectateurs, voire des consommateurs de spectacles, y compris du spectacle de leur propre vie. La démocratie comme autonomie collective, prise en charge collective du devenir du monde, se transforme alors en son exact inverse : une hétéronomie croissante, un abandon à toutes sortes de forces centrifuges auxquelles les individus sont sommés de s’adapter « librement », du moins avec les lambeaux de « liberté » qui leur restent. De plus en plus réduite au choix du consommateur, la liberté perd peu à peu toute résonance politique, avec la distance critique au réel que cela comportait. Aussi ne faut-il pas s’étonner que l’espace public s’apparente de plus en plus à un espace publicitaire et qu’il soit même reconnu comme tel par les acteurs médiatiques, dont Guy Crevier, éditeur de La Presse, qui écrivait ainsi, le 22 septembre dernier : « Curieux et ouverts sur le monde, les lecteurs de La Presse sont des consommateurs avertis dont le profil est recherché par les annonceurs qui reconnaissent la force de notre média en tant que véhicule publicitaire. »
Le journalisme comme narration du monde
S’il importe de dénoncer et de combattre l’emprise de la logique économique sur les médias et le travail journalistique, cela, pourtant, ne suffit pas. Il est non moins capital de penser les conditions du maintien d’un espace de représentation, seul capable de nourrir une distance critique au réel. Le défi peut ainsi s’énoncer simplement : comment peut-on penser le développement d’une pratique du journalisme qui soit à la hauteur de son idéal constitutif ? Comment peut-on favoriser la construction d’un espace de médiation qui assure une distance réfléchie face à la réalité, tout en permettant à tous – pas seulement aux « experts » – d’habiter cet espace de la pensée ? La critique de l’économie – fondamentale, je le répète – ne peut apporter aucune réponse à ces questions. Elle permet certes, en autant qu’elle daigne s’y consacrer, de poser à nouveaux frais la question de la représentation, dans la mesure où la logique économique en est précisément une d’abstraction des rapports sociaux, qui renvoie du coup ceux-ci dans l’indifférenciation (eu égard aux finalités) et l’invisibilité (toute orientation collective du monde, en rendant lisible le devenir, étant assimilée à une forme de totalitarisme). L’économie, autrement dit, tue la représentation. Dans La Rabbia, un film réalisé en 1963, Pier Paolo Pasolini affirmait ainsi : « Quand il ne restera plus rien du monde classique, quand tous les paysans et les artisans seront morts, quand l’industrie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation, alors notre histoire sera finie. » Il écrivait 12 ans plus tard, quelques mois avant sa mort, dans Lettres luthériennes : « Notre faute, en tant que pères, consisterait à croire que l’histoire n’est et ne saurait être que l’histoire bourgeoise. » C’est toujours l’écueil qui nous guette aujourd’hui, y compris dans la critique des médias et du journalisme. Car au fond, comment peut-on continuer à écrire collectivement l’histoire – ou ou maintenir la fiction dans la réalité, afin de garder l’histoire ouverte – si celle-ci est déjà inscrite dans la soi-disant naturalité du monde ? Pourquoi continuer à dire le monde si les mots lui sont fondamentalement étrangers ? Comment veiller à ce que les mots gardent un poids dans la réalité si celle-ci est réputée loger en deçà d’eux ? Aucune politique économique, fut-elle de gauche, ni aucune critique de l’économie ne peut nous aider à répondre à ces questions. Tant que la critique du journalisme ne placera pas ces questions au cœur de sa réflexion, elle épousera malgré elle l’histoire bourgeoise décriée par Pasolini, une histoire saturée du visible mais aveugle à ce qu’elle pourrait faire sourdre de l’invisible. Cette critique ne pourra ainsi, dans le meilleur des cas, que nous laisser suspendus dans le vide d’une absence de la représentation.
[1] La doxa est l’ensemble – plus ou moins homogène – d’opinions confuses, de préjugés populaires, de présuppositions généralement admises et évaluées positivement ou négativement, sur lesquelles se fonde toute forme de communication. [ndlr - Wikipedia]