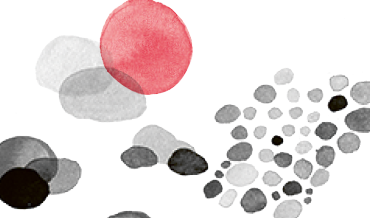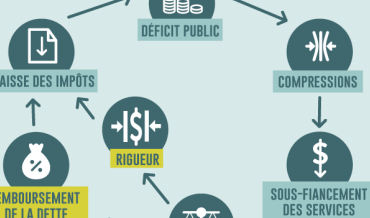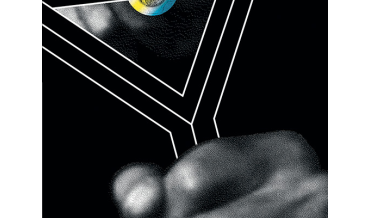Mémoire des luttes
Bataille autour du Code du travail en 1964-1965
,
Les années 1960 marquent une grande période d’expansion pour le mouvement syndical québécois. Durant cette décennie, le taux de syndicalisation bondit de 30 à 40 %. Les effectifs passent de 375 000 à 700 000 syndiqué·e·s. Cette progression est imputable, pour l’essentiel, à l’implantation du syndicalisme dans les services public et parapublic. La force de frappe du mouvement syndical se manifeste en 1964-1965 par la conquête de nouvelles lois du travail qui ont pour effet de reconnaître aux salarié·e·s des secteurs public et parapublic le droit de négociation et le droit de grève. Retour sur un événement historique dont on célébrera le cinquantième anniversaire au cours des prochains mois.
Avant l’adoption du Code du travail
Jusqu’en 1964, le régime des relations de travail des salarié·e·s des services publics (enseignement, hôpitaux, municipalités, Hydro-Québec, etc.) est encadré par la Loi des différends entre les services publics et leurs salariés dont l’origine remonte à 1944. Les employé·e·s de ces secteurs peuvent se syndiquer et négocier, mais la grève leur est interdite et les conflits sont soumis à l’arbitrage avec sentence exécutoire. Pour ce qui est des employé·e·s du secteur public (les fonctionnaires), ils ont le droit de s’associer, mais ils n’ont pas le droit de s’affilier à une centrale syndicale. De plus, ils n’ont pas le droit ni de négocier collectivement ni de faire la grève. Ajoutons que le gouvernement libéral ne voyait pas d’un bon œil la syndicalisation de ses employé·e·s. Le premier ministre Jean Lesage leur lancera en 1962 : « La Reine ne négocie pas avec ses sujets. »
Les conditions de travail et de rémunération des employé·e·s dans les secteurs public et parapublic sont largement inférieures aux conditions qui existent dans le secteur privé. Par ailleurs, le favoritisme règne dans la fonction publique. On retrouve des disparités importantes dans la rémunération entre les hommes et les femmes, mais également entre les régions. Les secteurs de la santé et de l’éducation sont des lieux de travail où les salarié·e·s doivent avoir la « vocation ». Les personnes qui y œuvrent sont exploitées au nom de la « charité chrétienne ».
Ce sera à la suite de l’adoption de la Loi d’assurance-hospitalisation en 1961 que s’amorcera la vague de syndicalisation durant la Révolution tranquille. L’État va déloger les administrations religieuses et prendra lui-même le contrôle du secteur hospitalier. L’extension du secteur de l’enseignement permettra également une montée du nombre de syndiqué·e·s. Il en va de même pour la fonction publique dont les effectifs augmentent en raison des responsabilités nouvelles qu’assumera le gouvernement durant cette période où on tourne la page sur le non-interventionnisme étatique atavique de l’ancien premier ministre Maurice Duplessis. Les syndicats vont s’implanter également chez Hydro-Québec, à la Régie des alcools du Québec et dans d’autres sociétés d’État.
Des grèves illégales
Au début des années 1960, des grèves illégales vont se produire dans les secteurs des hôpitaux et de l’enseignement. En 1962, les infirmières de l’Hôtel-Dieu votent la grève. La direction de l’hôpital fera des concessions pour éviter le débrayage. En 1963, ce sera au tour des infirmières de l’hôpital Sainte-Justine de déclencher un arrêt de travail. Après 30 jours de grève, elles obtiennent la formule Rand, de meilleures conditions de travail et de rémunération et, surtout, la négociation du fardeau de la tâche de travail. En 1964, ce sont 15 000 employé·e·s des hôpitaux qui se mettent en grève illégale. Après six heures d’arrêt de travail, ils et elles obtiennent la semaine de travail de 37 heures et demie (au lieu de 44), une importante augmentation salariale et une clause d’ancienneté contre l’arbitraire patronal.
Des grèves illégales auront lieu également dans le secteur de l’éducation. Les institutrices et instituteurs de la commission scolaire de Sainte-Foy effectueront, en 1963, une grève illégale de trois jours. En 1964, ce sera au tour des enseignant·e·s de l’Estrie de se mettre en grève. Ils obtiennent après 30 jours de débrayage rotatif la signature d’une convention collective. En 1965, 650 syndiqué·e·s de 13 commissions scolaires de la région de Québec déclenchent la « grève de la périphérie ». Ils gagnent, après trois semaines d’arrêt de travail, l’application d’une sentence arbitrale. C’est dans ce contexte de forte conflictualité sociale que le mouvement syndical fait campagne pour obtenir un Code du travail plus favorable aux salarié·e·s des secteurs public et parapublic. Les trois centrales syndicales – CEQ, CSN et FTQ – forment alors une coalition qui a pour nom le « Carrefour de la fonction publique ».
La réforme du Code du travail
Lors de la campagne électorale de 1960, le Parti libéral promettait de réformer les lois du travail. Le projet de loi que le gouvernement Lesage dépose en juin 1963 est loin de contenir des dispositions audacieuses. À des lieux de proposer une « révolution tranquille » dans le champ des rapports collectifs du travail, le gouvernement se limite, dans les deux premières versions du projet de loi 54, à regrouper diverses lois éparses et donne à son recueil de textes législatifs le titre pompeux de Code du travail. Les centrales syndicales dénoncent ce projet de loi qu’elles jugent trop timide. La CSN organise une assemblée extraordinaire. La FTQ prépare de son côté un congrès extraordinaire, qui accordera au comité exécutif le pouvoir de déclencher une grève générale si le gouvernement ne modifie pas substantiellement le projet de loi. Les dirigeants syndicaux de l’enseignement annoncent la convocation éventuelle d’un congrès d’urgence si le gouvernement ne leur accorde pas le droit de grève.
En juillet 1964, le gouvernement du Québec achève la quatrième version du projet de loi 54. Celui-ci a pour effet de libéraliser le régime de négociations collectives en étendant aux employé·e·s de certains services publics et parapublics le droit de grève (à l’exception des enseignant·e·s et des fonctionnaires [1]). Ce ne sera qu’en 1965, lors de l’adoption de l’article 43 du Code du travail et de la Loi de la fonction publique, que les enseignant·e·s et les fonctionnaires se verront reconnaître le droit de faire la grève. Si on considère que le Canada figure, sur le plan international, comme un des tout premiers à avoir reconnu le droit d’association à ses salarié·e·s et qu’il fut précédé par le gouvernement du Québec dans cette voie, on peut considérer que la nouvelle mesure législative adoptée lors de la Révolution tranquille était le résultat d’un rapport de force nettement favorable aux salarié·e·s et aux organisations syndicales qui entendaient les représenter. Si, en 1944, on refusait aux salarié·e·s du secteur public d’accéder à la syndicalisation et au droit de négociation, sous prétexte qu’il s’agissait là de dispositions contraires « à la souveraineté de l’État », on ne semblait plus en mesure de soutenir une telle chose 20 ans plus tard. Les droits de citoyenneté étendus aux entreprises depuis 1944 devaient aussi s’élargir aux salarié·e·s des secteurs relevant directement de l’État ou directement financés par lui. Avec la réforme du Code du travail en 1964-1965, une nouvelle période voit le jour pour les salarié·e·s des secteurs public et parapublic : l’ère de la libre contractualisation.
Le nouveau régime de négociation est fondé à quelques nuances près sur les dispositions existant dans le secteur privé. Dans les secteurs public et parapublic, si la grève appréhendée ou en cours a pour effet de mettre en danger la santé et la sécurité publique, le gouvernement peut s’adresser à la Cour supérieure en vue d’obtenir une injonction pour empêcher cette grève (voire menace de grève) ou pour y mettre fin.
La Loi de la fonction publique, adoptée en 1965, précise le champ du négociable. Ce champ est plus restreint que celui autorisé dans le Code du travail. Dans la Loi de la fonction publique, ne sont négociables que les points suivants : la rémunération, les heures de travail, la durée du travail et les congés. L’embauche et la promotion sont exclues de la négociation. En ce qui a trait à la grève, à l’exception des gardiens de prison et agents de la paix, ce droit est garanti aux fonctionnaires à condition qu’il y ait entente préalable sur la détermination des services essentiels. Les matières sujettes à la négociation dans le secteur public sont donc plus restreintes que dans le secteur privé et le droit de grève est conditionnel à une entente sur les services essentiels.
Conclusion
Les grèves des années 1963 à 1965 dans les secteurs des hôpitaux et de l’éducation ont entraîné un élargissement des droits syndicaux pour les salarié·e·s de ces secteurs et ceux à l’emploi direct de l’État. Ces débrayages ont débouché sur l’inclusion des secteurs public et parapublic dans les principales dispositions du Code du travail. Toutefois, depuis la réforme de celui-ci en 1964 et 1965, et à la suite de l’exercice de moyens de pression par les salarié·e·s syndiqué·e·s de ces secteurs, les nouvelles lois du travail ont, pour la plupart, restreint l’application et la portée de ces droits. Autrement dit, l’ère de la libre contractualisation n’aura pas eu l’éternité devant elle. Les parlementaires n’ont pas hésité à adopter des lois spéciales pour se soustraire à leurs obligations légales devant les salarié·e·s syndiqué·e·s des secteurs public et parapublic. Force est de conclure qu’en politique, il existe quelque chose comme des sincérités successives : parole d’État (ou de politicien), parole d’un jour.
[1] Les policiers et les pompiers se verront eux aussi interdire de faire la grève.