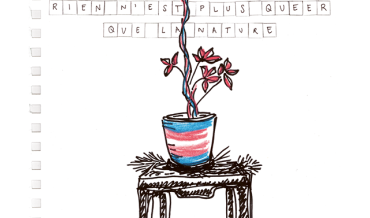La grande convergence
Quand le rouge s’allie au vert
par Christian Brouillard
En jetant un regard sur l’état de la planète, nous ne pouvons que dresser un constat des plus accablants : déforestation accélérée, épuisement des sols, « effet de serre », destruction de la couche d’ozone et changement climatique, multiplication des catastrophes « naturelles », accumulation des déchets dont ceux d’origine nucléaire (avec une durée de vie de quelques milliers d’années…), pollution génétique et ogm. Ce constat sur l’état alarmant des écosystèmes est largement partagé, de l’Organisation des Nations unies jusqu’aux simples citoyens et citoyennes.
Quant aux causes, peu de gens mettent maintenant en doute le rôle joué par les activités humaines dans cette destruction environnementale. Notable exception, l’administration Bush, aux États-Unis, n’y voit que des incidences dont le mode de production économique dominant n’est aucunement responsable. Cette myopie est partagée par les grandes entreprises, dont celles du secteur énergétique, qui n’ont de cesse de contourner ou de saboter les quelques accords internationaux, entre autres celui de Kyoto, promulgués en vue d’atténuer les dégâts. Comme le souligne Michael Lowy dans un ouvrage récemment publié (Écologie et socialisme, Paris, Syllepse, 2005), ce n’est pas céder à la panique que de souligner que le saccage de l’environnement terrestre ne peut que s’accélérer avec la course folle aux profits des grandes entreprises, course largement facilitée par les politiques néolibérales adoptées par la grande majorité des États.
Ce n’est pas céder à la panique mais tirer froidement une conclusion : le mode de production hégémonique, le capitalisme, représente une formidable machine à détruire l’environnement et les ressources naturelles, une machine qui, si elle n’est pas stoppée, risque d’entraîner l’humanité dans la destruction et la barbarie. Il est donc clair que rien ne changera si nous ne procédons pas à un sérieux virage, non seulement en termes de style de vie (consommation, etc.) mais aussi au niveau de la production.
C’est ici que se pose la question des alternatives à proposer face à la situation critique dans laquelle nous sommes engagés. La montée du mouvement altermondialiste a certes permis l’émergence d’un acteur international qui, jusqu’à un certain point, forme l’ébauche d’un contre-pouvoir. Cependant, si nous savons ce à quoi nous nous opposons, les propositions concrètes d’alternatives en sont encore à leurs premiers balbutiements. Il est vrai qu’à la suite de la chute du mur de Berlin en 1989, il fallait procéder à un long bilan sans complaisance des tentatives de changement social qui ont eu lieu au cours du XXe siècle. La caricature de socialisme qui s’est développée en URSS, pas plus que le capitalisme réellement existant, n’ont su apporter une véritable solution tant à la question sociale qu’à la question environnementale. Tchernobyl et la Mer d’Aral en constituent d’éloquents témoignages [1].
Critique de deux paradigmes
Par-delà cette évaluation des expériences passées, il s’agit de revoir sérieusement les conceptions théoriques ayant nourri et légitimé les processus révolutionnaires tels que les révolutions russe, espagnole ou chinoise.
À cet égard, le socialisme, dans toutes ses composantes mais surtout le marxisme, s’est construit autour de l’idée du progrès, celui-ci se basant à son tour sur une croissance économique sans fin. Le « développement des forces productives », libéré de l’entrave des rapports de production capitalistes, était censé, en bout de course, libérer l’humanité de la « vieille merde », pour reprendre les termes de Marx. Encore faut-il noter, au sujet des écrits de ce dernier, que tout n’était pas aussi clair, car tout en louangeant le côté positif que le développement du capitalisme pouvait avoir dans un premier temps, Marx relevait avec inquiétude les effets de la production manufacturière sur la santé des travailleurs-travailleuses ainsi que l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols.
Quoi qu’il en soit, la plupart des épigones de Marx vont réduire sa théorie à l’état de catéchisme baptisé « socialisme scientifique », où la domestication de la nature est un élément essentiel dans la construction du socialisme. Cette construction relevait exclusivement de l’État opérant au nom du prolétariat. Il apparut vite que les nouveaux États socialistes opéraient sur le prolétariat, réalisant d’importantes avancées industrielles, mais à quel prix en termes humains et environnementaux ! Le courant anarchiste a depuis longtemps dénoncé ces tendances autoritaires-centralisatrices du socialisme marxiste, basant plutôt son action sur l’émergence de communes de base fédérées. Cela dit, l’idée de progrès reste encore prégnante dans la mouvance anarchiste.
C’est vers les années 60 et 70 qu’un nouveau paradigme surgit, dans la foulée des luttes sociales de cette époque et de la constatation des dégâts grandissants infligés aux écosystèmes ( [2]. Les différents courants d’écologie politique qui ont ainsi émergé remettent en cause le productivisme qui est à la base des systèmes capitaliste et « socialiste » (sic). Ce trait commun étant posé, le courant écologiste présente lui aussi de nombreuses tendances. Pour les tenants de la Deep ecology, le problème, c’est l’humanité en tant que telle. Pour d’autres, dont Barry Commoner ou ceux et celles qui s’inscrivent dans les courants de l’écologie sociale (avec Murray Bookchin) ou de l’éco-féminisme, c’est le type de société où nous vivons qui est à dénoncer, sans pour autant développer une vision socialiste. Enfin, pour beaucoup d’écologistes comme Alain Lipietz en France, la tentation est forte de faire de l’écologie la science par excellence, celle qui résoudra tous les problèmes d’une manière similaire au « socialisme scientifique » de naguère…
Ce tableau, forcément sommaire, étant brossé, peut-on espérer voir s’esquisser, malgré leurs contradictions internes et leurs divergences théoriques, une convergence entre le rouge du socialisme et le vert de l’écologie ? Pour certains, comme Joel Kovel, Victor Wallis et James O’Connor aux États-Unis, Michael Lowy, Philipe Corcuff et Pierre Rousset en France ainsi que beaucoup d’autres à travers le monde, cette convergence est non seulement possible, elle est nécessaire si on veut changer durablement l’ordre social. Un manifeste écosocialiste, signé autant par des personnalités du Nord que du Sud, a été lancé il y a deux ans. Signe que les choses commencent légèrement à bouger.
Sous le signe de l’arc-en-ciel
L’arc-en-ciel de la libération est pourtant au creux de vos mains.
Qui se rappelle la Rainbow coalition, initiée aux États-Unis durant les années 80 en vue d’offrir une alternative aux vieux partis ? Peu de gens, et pourtant on trouvait là l’esquisse, malgré bien des contorsions électoralistes et réformistes, de ce qu’avance l’écosocialisme. Le théoricien marxiste français Henri Lefebvre a développé cette idée, appelant à une vaste coalition regroupant le rouge du socialisme marxiste, le mauve du féminisme, le vert de l’écologie et le noir libertaire, alliance basée non pas sur de simples échéances électorales mais sur une compréhension claire de l’interdépendance des diverses problématiques et de leurs solutions.
Pour l’écosocialisme, il est clair qu’il y a articulation entre la lutte contre le capitalisme et pour la protection de l’environnement, ne serait-ce que parce que la logique même du capital, le profit maximum, ne peut se traduire que par un pillage sans fin de la nature. Cette articulation ne se fera cependant que par une remise en cause des notions de progrès et de croissance. Sans aller jusqu’à l’ascétisme, des mesures concrètes peuvent d’ores et déjà être prises comme la valorisation des énergies douces et renouvelables, un accent plus fort sur le transport public, l’abolition de la dette du Tiers monde ou une législation plus sévère à l’endroit des entreprises pollueuses. Ces mesures, en soi, ne sont pas « révolutionnaires » mais elles constituent autant de grains de sable dans la machine du capital et permettent, à terme, la construction d’un rapport de force. Par ailleurs, l’écologie politique doit intégrer plus fortement la dimension sociale dans sa vision.
Ce ne sont pas là des prescriptions qui permettraient de tracer l’autoroute conduisant vers des lendemains radieux. Des autoroutes, il y en a trop et elles ne conduisent nulle part, comme on a pu le voir durant le siècle tragique que nous venons de quitter. Il s’agit d’ouvrir, humblement, un simple chemin, sans savoir d’avance les résultats ultimes, tant il est vrai que « le chemin se construit en marchant » (Antonio Machado).
[1] Lire, entre autres choses, « Du projet de dominer la nature », annexe D du livre de Michel Barillon, D’un mensonge déconcertant à l’autre, Marseille, Agone, 1999, pp. 129-132.
[2] Le Rapport du Club de Rome, appelant à une croissance zéro, paraît en 1972 alors que le livre pionnier de Barry Commoner, L’encerclement, sort en 1971. André Gorz, pour sa part, publie, en 1975, Écologie et politique.