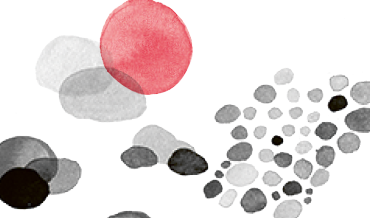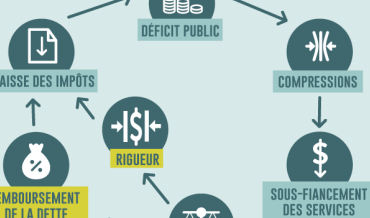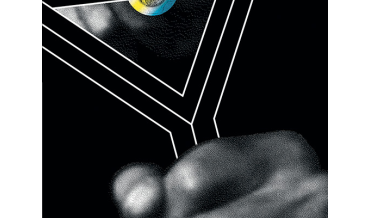Mouvement syndical et changement social au Québec
Quelle voie politique ?
par Christian Brouillard
Cest une banalité de base que daffirmer le rôle crucial du mouvement ouvrier dans tout processus de changements ou de réformes sociales. Rôle crucial ne serait-ce que par la position quoccupent les salariées dans les structures économiques et qui leur confère une arme de poids : la grève. Il est cependant tout aussi banal de constater que le monde du travail, depuis plus de vingt ans, sest profondément transformé avec, entre autres, la prolifération des formes de travail dites « atypiques » (travail autonome, temps partiel, contractuel, etc.) et qui posent, pour les syndicats, de sérieux dilemmes en termes d`organisation et de mobilisation.
Il n’en reste pas moins que le mouvement ouvrier organisé, au Québec, est devenu, au fil des ans, une force nationale. Une force qu’on peut d’abord mesurer en terme numérique : en 2002, 40,7 % des travailleurs-travailleuses étaient syndiquée (principalement, comme nous le verrons plus loin, dans le secteur public, le privé devenant, au fil des ans, minoritaire) alors que ce taux, pour la même période, en Ontario était de 28,3 %, de 31,5 % au Canada et de 14,6 % aux États-Unis. Une force qui est aussi capable d’impulser d’importantes actions, comme on a pu le constater en décembre dernier, dont les retombés politiques ne sauraient être ignorées par nul parti ou gouvernement. Cette apparente puissance n’est malheureusement pas sans failles car, outre les nouveaux défis posés par la mondialisation capitaliste et les transformations dans l’organisation du travail, le syndicalisme québécois n’a jamais réussi à résoudre le problème d’être capable de traduire sa combativité revendicative dans une action politique qui lui soit propre. C’est une question qui se pose avec de plus en plus d’acuité depuis les années 50, années où le mouvement syndical surgit véritablement en force sur la scène politique et sociale québécoise.
D’hier…
C’est durant la période duplessiste que le mouvement ouvrier, au cours de dures batailles comme à Asbestos (1949), Louiseville (1952) ou Murdochville (1957), se taille une place qui soit réellement en rapport avec la stature qu’il avait acquise dans la société et l’économie québécoise. Divisé essentiellement entre les unions internationales (qui seront regroupées au sein de la FTQ en 1957) et les syndicats catholiques de la CTCC-Confédérations des Travailleurs Catholiques du Canada (rebaptisée CSN en 1960), le mouvement ouvrier québécois commence alors, timidement, à remettre en question la position qu’il avait, jusqu’à cette date, adoptée sur le terrain politique, celle de la non partisanerie. Avec cette position, les syndicats québécois restaient, paradoxalement, soit sur le terrain de l’abstention, soit à soutenir une organisation politique qui n’était pas issue du mouvement ouvrier. Cette attitude politique, notons-le, n’est pas propre au seul syndicalisme québécois, elle est en lien avec la tradition nord-américaine et, plus précisément celle des États-Unis où l’on voit les syndicats généralement soutenir le Parti Démocrate. En outre, ce n’est pas la seule position, historiquement, adoptée par le mouvement ouvrier : il y a celle du troisième parti où les syndicats sont amenés à être la force motrice dans la création d’une formation chargée de représenter leurs intérêts (Parti des travailleurs ou Parti social-démo-crate), le marxisme-léninisme (Parti communiste) ou le syndicalisme révolutionnaire. Dans ce dernier cas, ce sont les syndicats qui assument le rôle dévolu aux partis. C’est une tradition qui est, en Amérique du Nord, minoritaire si on excepte les expériences, assez significatives malgré tout, des IWW (Industrial Workers of the World) aux États-Unis et de la One Big Union au Canada anglais.
Cela dit, à la fin des années 50, propulsé par la force des conflits, le syndicalisme se heurte au cul-de-sac du duplessisme et des partis existants. D’où la recherche d’une autre voie qui se traduira concrètement par un appel lancé au congrès de 1958 de la FTQ, pour la fondation d’un parti des travailleurs ; appel qui sera relayé par la décision prise, en 1959, par la CTCC d’autoriser ses syndicats à appuyer et à s’affilier à un parti. Ce changement d’orientation est au diapason avec la prise de position du Conseil du Travail du Canada, en avril 1958, appelant à la formation d’une nouvelle organisation politique au Canada. Celle-ci verra effectivement le jour, en 1961, sous le nom de NPD (Nouveau Parti Démocratique). Au Québec, cependant, l’orientation prise vers la création d’un troisième parti restera sans lendemains. D’une part, l’occultation de la question nationale québécoise par le NPD lui aliénera le soutien du mouvement ouvrier ; d’autre part, l’ouverture d’un vaste processus de modernisation au Québec, la « Révolution tranquille », permettra au Parti libéral de capter le soutien syndical. Ce soutien ne sera pas sans contre-partie, car cette période voit une nouvelle expansion des organisations ouvrières dans un secteur public lui-même en plein boom. Cette expansion a laissé des traces largement perceptibles aujourd’hui : en 2002, près de 82 % des salariées de la fonction publique était syndiquées alors que cette proportion, pour le privé, s’établissait à 27,7 %.
La lune de miel entre les libéraux et le mouvement syndical sera de courte durée. À la fin des années 60, un nouveau cycle de lutte s’enclenche posant, une fois de plus, la question politique. L’ouverture d’un deuxième front, hors des lieux de travail, la constitution de comité d’action et d’éducation populaire ou de comités d’action politique (CAP) représentent alors des tentatives pour répondre à la nécessité de passer à l’action politique. À Montréal, cela débouchera, au début des années 70, à la création d’un parti municipal, le FRAP (Front d’action politique), dont l’existence sera relativement brève. Ces initiatives ne s’insèrent pourtant pas dans une démarche structurée en vue de déboucher sur une option syndicaliste révolutionnaire ou sur la création d’un troisième parti. Elles représentent plutôt un complément à l’orientation non partisane, une « greffe » d’un discours politique sur une action qui se situe encore, pour l’essentiel, uniquement sur le plan des seuls enjeux des conventions collectives. L’ambiguïté créée par cet écart entre le discours et la pratique en illusionnera plus d’un, laissant planer la possibilité d’un tournant vers la création d’un parti des travailleurs. Or, le vide politique qui s’est creusé au Québec (dû, entre autres, à la forte combativité ouvrière et, conséquemment, le discrédit dans lequel plongeait les formations politiques comme le Parti libéral ou l’Union nationale) durant cette période sera rapidement comblé par un nouveau joueur : le Parti québécois.
… à aujourd’hui
L’arrivée au pouvoir, en 1976, du PQ clôt une période et en ouvre une nouvelle, celle dans laquelle nous sommes encore. Le PQ a ainsi réussi rapidement à capter le soutien syndical d’abord parce qu’il est apparu comme en rupture avec les anciens partis. Sans jamais se désigner comme parti des travailleurs (sinon, d’une manière très floue, comme « social-démocrate »), il en est arrivé à être perçu comme tel, d’ou les illusions récurrentes sur la possibilité de le « gauchir » ou (comme tout récemment avec le SPQ libre) de créer une aile gauche en son sein. Ce monopole en terme de représentation politique auprès du mouvement ouvrier, le parti a réussi à le renforcer avec tout son appareil concertationniste : Sommets, rencontres, partenariat, etc. En conséquence, le PQ apparaît encore pour beaucoup actuellement, dans le mouvement syndical et populaire, comme le véhicule capable de porter les solutions à la question nationale et sociale. Certes, le véhicule est pas mal ébréché, l’ensemble des politiques anti-ouvrières (comme en 1982-83 à l’encontre des syndicats du secteur public) et anti-sociales adoptées par le Parti ayant laissé quelques traces dans la mémoire. Mais le PQ, trop souvent, incarne le moindre mal d’autant plus que l’arrivée au pouvoir du parti libéral, en avril 2003, semble ouvrir une nouvelle ronde accélérée de politiques néolibérales. L’illusion, c’est de croire que le PQ pourrait, à la suite, minimiser les dégâts alors qu’il a démontré qu’il était parfaitement capable d’implanter ce type de politiques mais à un rythme et sur un mode différents.
Une fois de plus, donc, le vieux dilemme se pose au mouvement ouvrier québécois : comment traduire politiquement son action revendicative sans se laisser prendre au piège de la non partisanerie et de partis qui lui sont, au fond, antagonistes. Ce passage au politique implique aussi que le syndicalisme puisse mettre ses ressources, qui ne sont pas négligeables, non seulement au service de ses seuls membres mais aussi pour l’ensemble des salariées (dont les précaires qui représentent une catégorie de plus en plus importante et qui ne sont pas, à toute fin pratique, syndiqués) et des classes populaires dans la constitution d’un vaste mouvement de résistance anti-capitaliste. Cela représente, certes, une rupture avec le rôle traditionnellement dévolu aux syndicats, à savoir seulement négocier une convention collective. L’époque actuelle, marquée par de multiples bouleversements et une aggravation des inégalités sociales, appelle cependant aux ruptures et aux innovations. Comme l’écrivait Rimbaud : « Oui, l’heure nouvelle est au moins très sévère. »