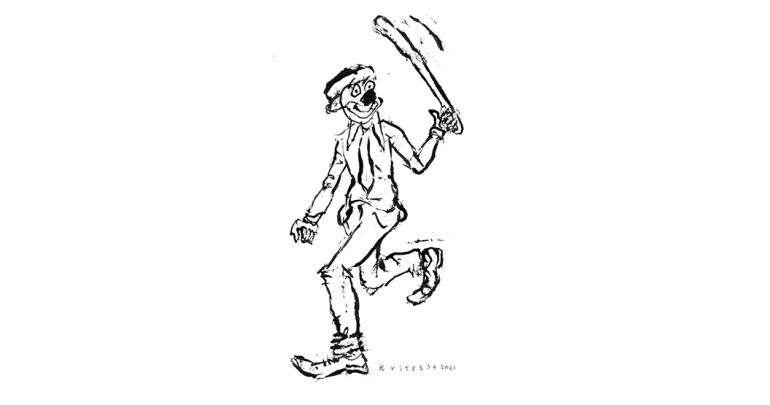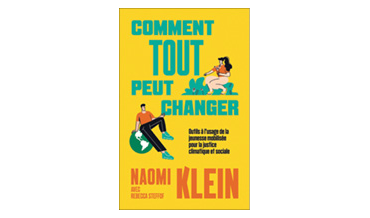Dossier : La police, à quoi ça sert ?
Expertise sur les gangs de rue. Contrôler plus et comprendre moins
L’esprit policier n’est pas exclusif aux appareils de police. L’imaginaire médiatique et l’expertise scientifique autour des gangs de rue au Québec manifestent une approche des enjeux sociaux qu’il faut bien qualifier de policière.
Réagissant à la multiplication des fusillades dans le nord-est de Montréal, fin 2019, le journaliste de La Presse Daniel Renaud demande dans son texte éditorial [1] s’il ne faudrait pas ressusciter l’escouade policière « Gangs de rue », pourtant démantelée en 2016, après que le SPVM l’ait lui-même reconnu coupable d’avoir favorisé le profilage racial par ses « stratégies, tactiques et politiques opérationnelles discriminatoires [2] ». Spectre d’une forme de délinquance présentée comme spécialement violente et dangereuse, mais aussi plus « noire », le gang de rue projette depuis les trente dernières années au Québec l’ombre d’une nouvelle « classe dangereuse » autour de laquelle s’édifie la surveillance policière des jeunes racisé·e·s.
Par son parcours médiatique et expertal, la catégorie de « gang de rue » matérialise une difficulté à penser hors des catégories policières l’insécurité vécue par les populations marginalisées. Cette difficulté peut se rapporter au fait que la déviance est le plus souvent adossée à la constitution de réseaux d’experts qui, comme instances de régulation sociale, débattent des meilleures catégories permettant de saisir, prévenir et contrôler les individus qui s’écartent de la norme. Nous proposons ici d’illustrer brièvement comment la constitution d’un savoir expert sur le gang de rue au Québec a pu contribuer à rendre objectif, quantifiable et gouvernable ce « barbare imaginaire ».
De la panique morale au besoin d’expertise
Aux États-Unis, le gang de rue devient l’objet de préoccupations publiques au tournant des années 1980. Il mobilise pêle-mêle une série de peurs collectives entourant l’immigration, l’utilisation des armes à feu et le trafic de drogues. En 1989, cette panique morale trouve écho au Québec. Identifiant les États-Unis comme point d’origine de l’éclosion d’une « culture du gang », le discours médiatique de l’époque perçoit ce qu’il croit être les signes avant-coureurs d’une prolifération des gangs de rue à Montréal.
Le 16 février 1989, un article qui s’intitule « Les gangs d’adolescents prolifèrent à Montréal » occupe une page entière du Journal de Montréal. Le journaliste Serge Labrosse y accorde une place centrale au film hollywoodien Colors (1988) mettant en scène « l’histoire des gangs à Los Angeles, [qui] semble devoir s’appliquer concrètement à la réalité des gangs d’adolescents criminels qui, à Montréal, connaissent une prolifération inquiétante ». Dénonçant l’inaction des pouvoirs publics québécois devant le phénomène, le journaliste conclut son texte par une citation de Gilles Gendreau, psychoéducateur et figure historique du champ de la réadaptation des jeunes au Québec, qui soulignait que « c’est maintenant qu’il faut intervenir, si l’on ne veut pas que Montréal connaisse, au cours des 5 ou 10 prochaines années, la même escalade de violence qu’ont connue New York et Los Angeles avec les gangs d’adolescents criminels… ».
Quelques mois plus tard, Yves Boisvert, pour le journal La Presse, cite ainsi le chef du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM), Alain St-Germain, qui réaffirme que le phénomène des gangs de rue « n’est pas un problème majeur en termes de criminalité », ajoutant cependant qu’il s’agit d’« un problème majeur parce que maintenant les gens qui prennent le métro et l’autobus sont inquiets, et il faut les rassurer ». Se profile alors entre ces lignes, à la fin des années 1980, la construction d’un consensus autour de la nécessité d’anticiper la menace du gang.
Une régulation des pratiques scientifiques à des fins de gouvernement
Mettant à l’avant-scène les images de violence exacerbée, cette panique morale a eu pour effet d’interpeller et de mettre au défi les autorités qui expriment alors un urgent besoin d’expertise pouvant orienter l’action publique. Avec l’impulsion du gouvernement et des agences de contrôle du crime, un savoir expert sur le gang de rue se développe alors au Québec, et ce, dans le cadre d’un régime particulier de régulation des pratiques scientifiques.
Impliquant la production de connaissances utiles aux politiques publiques, ce régime a notamment conduit, au milieu des années 1990, à une collaboration renforcée entre le champ universitaire et le champ administratif de la santé et des services sociaux. Cette collaboration a notamment pris la forme de procédures de « désignation universitaire », offrant à divers établissements de santé et de services sociaux la charge de produire des connaissances scientifiques sur des enjeux de pratiques — le Centre jeunesse de Montréal a ainsi obtenu sa première « désignation universitaire » le 30 août 1996. Ce régime lui permet de mettre sur pied son propre centre d’expertise, l’Institut de recherche pour le développement social des jeunes (IRDS), qui a de fait constitué l’un des principaux foyers de production de connaissances scientifiques sur les gangs de rue.
L’IRDS publie en 1997 l’une des premières recherches francophones sur les liens entre « jeunesse et gangs de rue ». Présentée au SPCUM en vue d’établir un plan stratégique quinquennal, cette recherche présente les défis que pose « l’absence d’une définition normalisée du phénomène » pour en évaluer « [la] nature, [l’]étendue et [la] gravité [3] ». Bien que cet obstacle épistémologique fasse consensus dans la littérature scientifique sur le sujet, il n’empêche pas l’IRDS, quelques lignes plus loin, de formuler l’hypothèse selon laquelle les gangs de rue à Montréal, « comme ceux des États-Unis », seraient majoritairement « issus des minorités culturelles plus récemment immigrées au Québec », et qu’ils seraient « dorénavant davantage orientés vers la violence, la drogue et les armes et tendent à être autant mobiles qu’astucieux ».
Plutôt que de remettre en question la catégorie de gang de rue, cette instabilité épistémologique a paradoxalement favorisé la production expertale. Cette dernière s’est progressivement orientée vers la production d’indicateurs, de schèmes de classification des individus et d’instruments de calcul des risques qui, s’ils échouent à rendre le phénomène plus intelligible, sont destinés à le rendre « objectif », univoque et gouvernable.
Des savoirs policiers
Dans la formation de ce savoir expert, certaines formes de connaissances sur le gang de rue, valorisées par les champs institutionnels, ont été mises de l’avant, notamment celles produites dans les disciplines de la psychoéducation et de la criminologie positiviste. En contrepartie, cela a entraîné l’occultation d’autres traditions scientifiques dans l’étude du gang, notamment les approches sociologiques, ethnographiques et réflexives qui s’inspirent des travaux pionniers de l’École de Chicago et qui ont été marginalisées au Québec.
Par cette architecture, la « science du gang de rue » qui s’est institutionnalisée au Québec a contribué à faire de son objet d’étude une « affaire de police ». Elle participe moins à une entreprise d’analyse compréhensive des réalités sociales qu’au développement d’outils techniques permettant d’en limiter les cadres interprétatifs et d’en faire des réalités quantifiables, prédictibles et conformes aux outils du contrôle social.
Suivant le philosophe Jacques Rancière, la « police » doit être entendue non pas seulement au sens de la répression, mais de l’activité qui ordonne la société et autorise le partage entre ceux qui « savent » et ceux qui sont « sans-part », dont on dit qu’ils ne manifestent que fureur et hystérie [4]. En effet, comme l’a montré le sociologue Ian Hacking, les catégories conceptuelles issues de l’expertise parviennent à produire des « genres humains » et des classes d’acteurs [5]. Dès que nous avons la catégorie, l’étiquette, nous avons l’impression qu’il existe un genre bien défini de personne, permettant l’institution d’un principe de partage qui organise notre ontologie sociale.
Le parcours expertal qu’a emprunté la catégorie de « gang de rue » fait ainsi obstacle au développement d’une démarche réflexive et démocratique, capable de prendre en compte ce processus d’étiquetage des « classes dangereuses » qui demeurent encapsulées dans des catégories policières.
[1] Daniel Renaud, « Fusillades à Montréal : Faut-il ressusciter les escouades Gangs de rue ? », La Presse, 5 décembre 2019.
[2] SPVM, Plan stratégique en matière de profilage racial et social 2012-2014, Montréal : Ville de Montréal, p. 22.
[3] Hébert (J.), Hamel (S.), Savoie (G.J.), Plan stratégique jeunesse et gangs de rue : Phase I. Revue de littérature, Montréal : I.R.D.S., 1997, p. 3.
[4] Voir Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004.
[5] Voir Ian Hacking, Entre science et réalité : la constructions sociale de quoi ?, Paris, la Découverte, 2001.