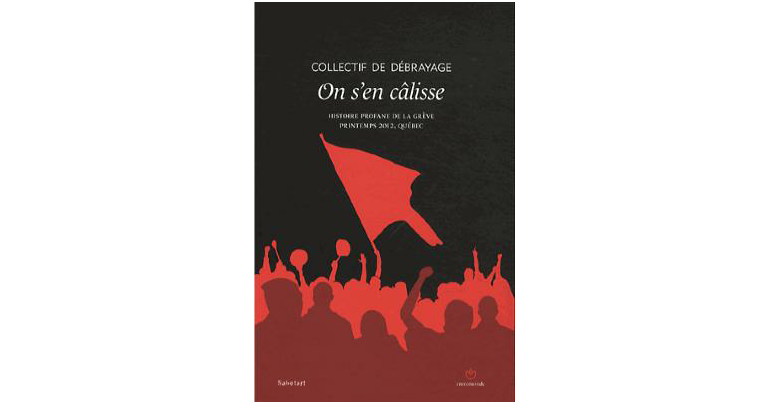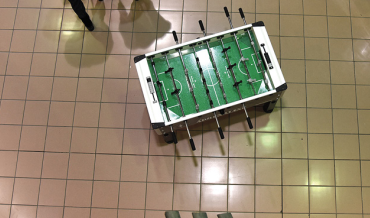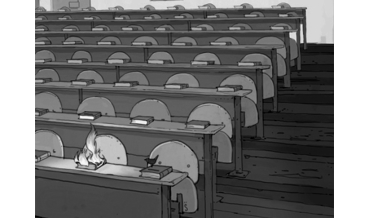Collectif de débrayage
On s’en câlisse – histoire profane de la grève printemps 2012
Collectif de débrayage, On s’en câlisse – histoire profane de la grève printemps 2012, Montréal/Genève, Sabotart/ Entremonde, 2013, 283 p.
Récit percutant des différentes phases de la grève, On s’en câlisse s’attaque à l’interprétation dominante, à gauche, voulant que la lutte des carrés rouges ait été somme toute adroitement menée et ait débouché sur des résultats probants ; il cherche à lui substituer une lecture hétérodoxe, en vertu de laquelle la grève aurait finalement été détournée de son sens profond.
Cet ouvrage, dont l’écriture est de belle qualité, offre deux grands attraits : la narration informée et enlevante des principaux épisodes de la lutte de 2012 – on peut presque sentir l’odeur âcre du gaz lacrymogène et entendre la détonation des engins utilisés durant ce conflit – et la mobilisation d’une série d’auteur·e·s en pensée politique afin de questionner la lutte des carrés rouges dans sa relation complexe avec le Québec et ses institutions. Ainsi, on apprécie le cadre théorique, d’une relative profondeur intellectuelle, ce qui le démarque de plusieurs des autres titres parus sur le même sujet depuis un an et demi. Ce cadre soutient une entreprise de déconstruction du réel en vertu de laquelle il n’y a pas de société viable et fonctionnelle. À l’intérieur de ce réel dépeint comme un état permanent d’aliénation et de désordre, la révolte est un acte d’émancipation exigeant une désaliénation progressive ; la grève a justement permis de frôler ce moment béni d’affrontement pur entre un État autoritaire mis à nu et la plèbe enfin sortie de sa torpeur.
On aime l’analyse éclairante des modalités du développement de ce printemps étudiant, tout comme l’étude de ses tactiques variées et créatives, ainsi que l’explication de leur articulation aux faits et gestes du pouvoir tentant de contrôler ou de briser le mouvement. De plus, la critique des dispositifs de l’arsenal répressif mis en œuvre par l’État est judicieuse. À la fin, on mesure avec les auteur·e·s l’immense désenchantement qu’ils et elles (et plusieurs autres) ont ressenti lorsqu’est arrivé, durant l’été 2012, ce moment fatidique où la grève était à la croisée des chemins. Dans les derniers chapitres, la défense de la thèse du dévoiement des impulsions « naturelles » du mouvement (favorables au chaos et à l’insurrection) est telle qu’elle prend le dessus sur l’analyse empirique et rigoureuse des faits sociaux.
C’est pourquoi le collectif ne parvient pas à nous convaincre du rôle prétendument délétère joué par certains acteurs de cette lutte : l’ASSÉ (dépeinte comme une structure oppressante, à laquelle doivent se substituer les collectifs affinitaires), les partisans du syndicalisme de combat (à qui le livre reproche de vouloir réduire le mouvement à sa dimension économique : la gratuité scolaire, voire le gel des frais de scolarité) ou encore Québec solidaire, responsable, selon le collectif, d’avoir tenté de leurrer les carrés rouges en les invitant à opter pour une résolution électorale de ce conflit social sans précédent. L’ouvrage est indispensable cependant pour quiconque veut appréhender les profondes lignes de faille qui traversent le mouvement étudiant combatif au Québec.