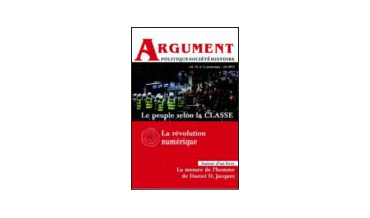Au-delà des principes de la démocratie directe
Témoignage sur le fonctionnement réel de la CLASSE
Dossier : Le printemps érable - Ses racines et sa sève
,
Le mépris des milieux institutionnels et la fascination des milieux alternatifs pour la démocratie délégative pratiquée à la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) s’appuient souvent sur son opposition à la démocratie représentative québécoise. La représentation confère, pour les uns, la légitimité et l’efficacité nécessaires à une bonne gouvernance, et aliène, pour les autres, les notions d’égalité, de participation, de transparence et de délibération. Si publiquement la CLASSE s’enorgueillit de ses fondements démocratiques, c’est parce qu’elle a été capable de mobiliser des dizaines de milliers d’étudiantes grâce à une expérience politique participative, délibérative, radicale et originale tant dans les moyens d’action que dans les principes.
Quels que soient les vices et vertus des deux modèles, rarement sort-on de cette opposition pour entrer dans les débats à l’interne sur les pratiques de démocratie directe de la CLASSE. Pourtant, au-delà de la critique et de l’apologie béate, nombre d’étudiantes et d’étudiants au sein de la CLASSE ont été confrontés au cours du printemps 2012 aux enjeux, incohérences et paradoxes d’un mode d’organisation parfois en décalage avec leur idéal démocratique et incapable de satisfaire complètement leurs attentes – un témoignage que nous nous proposons de livrer ici.
Démocratie décentralisée
Construite à même les principes directeurs de l’ASSÉ, la coalition de grève de la CLASSE a pour but de coordonner nationalement l’action des associations étudiantes collégiales et universitaires selon les pratiques de la démocratie directe et du syndicalisme de combat. Son fonctionnement démocratique semble simple : dans leurs assemblées locales, les étudiantes adoptent des mandats qui doivent ensuite être présentés, publicisés et défendus par leurs déléguées aux congrès de la CLASSE. Lorsqu’un mandat est commun à une majorité d’associations étudiantes, les représentantes et représentants élus de la CLASSE sont tenus de veiller à leur application en disposant de peu d’autonomie pour ce faire. Ce mode opératoire sert à préserver la décentralisation du mouvement, garantit l’égalité de tous et toutes à pouvoir se représenter eux-mêmes et elles-mêmes, et reconnaît à chacune une compétence politique équivalente.
Cet esprit décentralisateur instille une certaine méfiance envers toute organisation hiérarchisée. Se justifiant par l’urgence, le fait nouveau ou la stratégie, des déléguées et des représentantes et représentants nationaux prennent parfois des libertés dans l’interprétation de leurs mandats. En réaction à ces comportements, des assemblées rappellent à l’ordre leurs déléguées, et des délégations déposent des motions de blâme en congrès. L’insatisfaction des étudiantes se manifeste par l’invocation d’une certaine pureté dans l’application des principes de la CLASSE. Ce débat, opposant pragmatisme et efficacité au respect strict des principes, est typique des nouveaux mouvements sociaux ; c’est le rapport représentation/délégation qui est ici en jeu.
Résidu de représentation, la délégation rompt avec l’idéal de la démocratie directe. Elle permet certes la coordination nationale entre les différentes assemblées et la réalisation de tâches spécialisées, mais elle pervertit parfois la volonté des étudiantes, tandis que l’autonomie des élues dans le mouvement étudiant forme ironiquement l’un des principes inhérents de la démocratie représentative. Tel est le cas, par exemple, de l’autonomie relative du comité médias, appelé à agir auprès des acteurs traditionnels de la société, et de la visibilité grandissante du co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, glorifié ou honni en tant que « leader étudiant ». De l’avis de plusieurs, dans les deux cas, ils se sont arrogé des libertés par rapport aux mandats adoptés en Congrès ou s’en sont parfois remis à l’influence d’acteurs externes au mouvement.
Les déléguées et représentantes sont confrontés à la difficile conciliation du respect de leurs mandats avec leurs positions personnelles, mais aussi à l’accumulation d’une expertise et d’un capital symbolique mettant à mal les aspirations égalitaires de la CLASSE. La différenciation entre les étudiantes ne relève pas que des postes occupés, mais aussi de facteurs sociopolitiques tels que l’expérience militante, la maîtrise des procédures, les ressources (temps et moyens) ou le capital culturel intériorisé (comme le niveau de langage). Cette dynamique mène à une certaine « professionnalisation » du militantisme qui semble inévitable. La monopolisation totale ou partielle du temps de discussion par certaines et leur accès privilégié aux postes électifs trahissent la reproduction des inégalités sociétales au sein des instances. Par exemple, on peut faire une corrélation entre la surreprésentation des hommes et des universitaires dans les fonctions et dans le temps de parole, et la minimisation des enjeux féministes et collégiaux. Ainsi, l’influence exercée par certains individus sur l’amalgame des volontés collectives, en circonscrivant l’horizon des débats, en limitant le champ des possibles et en contrôlant l’efficacité de la mise en œuvre des résolutions adoptées, mine les fondements nécessaires à l’exercice de la démocratie directe.
Démocratie du plus grand nombre
La démocratie directe veut garantir l’égalité réelle de tous et toutes et cherche à valoriser leur participation active aux délibérations. La rhétorique gouvernementale a misé sur la faible participation dans les assemblées et sur le caractère supposément « intimidant » du vote à main levée pour délégitimer les pratiques de la CLASSE. Ces accusations ont eu peu d’impacts dans les milieux étudiants. Au contraire, les quorums nécessaires à la tenue des assemblées et à la prise de décisions majeures (affiliations ou grève) font encore l’objet d’avis de motion visant à les diminuer, tandis que les demandes de référendum ou de votes secrets sont souvent rejetées par de très larges majorités de voix. Pour les nombreux étudiants et étudiantes qui se présentent dans leurs auditoriums pour débattre et décider, la légitimité repose sur autre chose que le seul nombre, soit la délibération active au sein des assemblées.
À cet aune, le référendum n’est pas une option viable, même s’il élargit la participation étudiante au processus décisionnel, puisqu’il empêche le processus délibératif censé précéder et guider le choix. La légitimité ne provient donc pas de l’expression des préférences individuelles, mais de la délibération même. À cet égard, les procédures en assemblée prévoient l’alternance hommes/femmes lors des tours de parole et la priorisation des premières prises de parole. Donc, par l’échange d’informations et l’argumentation libre, les membres peuvent prendre des décisions plus éclairées. Les perdants du vote, ayant pu participer au débat et atténuer les propositions par des amendements, devraient être satisfaits du processus et convenir de sa légitimité.
Or, pour les opposantes à la grève, l’assemblée ne semble n’avoir de légitimité que si elle avalise leur préférence. Leur présence en assemblée ne relève donc pas pour beaucoup d’un désir de participation active à leur communauté politique, mais s’explique par l’assurance que les décisions prises seront mises en application, notamment la levée ou la reprise des cours. À première vue, la démocratie directe, telle que pratiquée au sein du mouvement étudiant, semble échouer à rallier effectivement un grand nombre de ses membres par son incapacité à remplir ses promesses d’inclusion. Il apparaît que l’objectif est autre : non pas mettre en œuvre une véritable « démocratie délibérative » axée sur le consensus, mais mener à terme un projet de contestation dans un « espace public oppositionnel », pour reprendre le terme d’Oskar Negt [1].
Ce système peine aussi à intégrer les minorités, notamment les étudiantes et étudiants étrangers, les minorités visibles et les femmes qui déplorent l’exclusion réelle de leurs enjeux dans le processus délibératif, ou qui sont carrément invisibles dans les débats et les structures organisationnelles du mouvement. Les adversaires politiques cherchant à décrédibiliser la CLASSE ont souligné l’absence de minorités ethniques au sein de ses instances. Également remarqués et décriés à l’intérieur du mouvement, ces faits s’expliquent difficilement compte tenu des positions féministes, anticolonialistes et anti-oppressives de l’association. Les voix de ces groupes « silencés » et « invisibilisés » sont, dans les faits, souvent intégrées sur un mode de prise en charge, condamnées encore une fois à se taire ou à « être parlées » comme le soulignait Pierre Bourdieu. Lorsque ces groupes prennent l’initiative de défendre leurs enjeux propres, l’intégration de leurs propositions relève davantage du consentement que de la réelle volonté de les mettre en œuvre. Les revendications de la CLASSE qui portent sur les étudiantes et étudiants étrangers sont ainsi accessoires, rapidement exclues des joutes de négociation où priment les revendications concernant l’ensemble des étudiantes. Les groupes féministes, nettement plus organisés au sein de la CLASSE, notent la persistance d’attitudes paternalistes, sexistes ou oppressives dans les milieux militants et manifestent leur insatisfaction à voir leurs préoccupations retardées, ou tout simplement évacuées, faute de temps.
La réflexion sur la démocratie directe au sein du mouvement étudiant québécois gagne à être menée autrement que dans son opposition manichéenne avec le régime libéral. Les ratés de la démocratie représentative, en crise de légitimité, renforcent certes le besoin d’espaces participatifs et délibératifs. Les espaces qu’offrent la CLASSE ne sont cependant pas exempts de zones d’ombre et semblent confirmer l’impossibilité d’une pratique pure de l’idéal démocratique : on ne parvient à remédier efficacement ni aux inégalités réelles du social, ni aux incohérences structurelles des procédures délibératives et décisionnelles. De plus, on n’arrive pas à y transcender le caractère conflictuel des rapports politiques pour réaliser une inclusion plus grande des intérêts minoritaires. La démocratie étudiante tend ainsi à se rapprocher d’un modèle que Chantal Mouffe [2] qualifie de radical et pluriel, qu’elle définit comme « démocratie agonistique ». Ce modèle prend acte des antagonismes inconciliables à l’intérieur des communautés politiques, mais propose une reconnaissance mutuelle de la légitimité des positions adverses. Un exercice qui n’est possible que sur la base d’un partage d’idéaux démocratiques de liberté et d’égalité, mais aussi de luttes pour l’émancipation. Enfin, l’ASSÉ, la CLASSE et les associations étudiantes locales qui en sont membres affichent encore des insuffisances et des incohérences propres à toute organisation de cette envergure. Cet espace de mobilisation démocratique, certes imparfait, demeure toutefois malléable et perfectible. Il est apte à admettre que les procédures ne pourront totalement neutraliser la reproduction des inégalités sociétales au sein des instances, et enclin à accepter la conflictualité circonscrite par des principes démocratiques communs.
[1] Negt O., L’Espace public oppositionnel, Paris, Éditions Payot, 2007.
[2] Mouffe C., « Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism », Political Science Series, vol. 72, 2000, Institute for Advanced Studies.