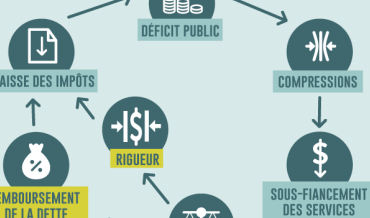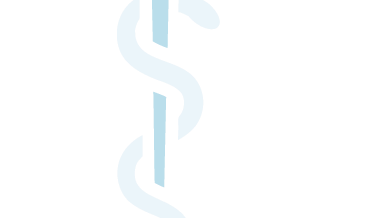Travail
Multiplication des postes vacants : où est le problème ?
Tout indique que le thème de la pénurie de main-d’œuvre occupera encore la conversation publique en 2022. Le phénomène, qui a gagné en importance dans les dernières années, justifierait qu’on lui accorde notre attention et que les gouvernements agissent pour y remédier. Mais remédier à quoi exactement ?
Au Québec, le taux de postes vacants, soit la proportion de postes que les employeurs cherchent à pourvoir par rapport aux nombres d’emplois occupés et vacants, est en constante progression depuis 2015 – comme c’est le cas d’ailleurs dans le reste du Canada. Ce taux était de 1,8 % lorsque l’Enquête sur les salaires et les postes vacants de Statistique Canada a débuté il y a 7 ans. Au troisième trimestre de 2021, il était plus de 3 fois plus haut et s’élevait à 6,1 % dans la province, pour un total de 238 050 postes vacants [1].
Des causes mécomprises
Les raisons expliquant cette progression sont multiples. La vigueur de l’économie est bien entendu en cause. Le taux de chômage avait atteint 4,5 % en février 2020, un niveau historiquement bas qui a été retrouvé en novembre 2021. Le vieillissement de la population entre aussi en ligne de compte. En 2020, toujours selon Statistique Canada, 63 500 personnes ont indiqué avoir quitté leur emploi parce qu’elles ont pris leur retraite, soit 25 % des personnes ayant quitté leur emploi cette année-là. Ce chiffre ne s’élevait qu’à 31 100 en 2000 (14 % ). Enfin, le nombre d’immigrant·es reçu·es, une population en moyenne plus jeune que celle née au pays, a eu tendance à stagner dans la dernière décennie selon les données du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Il faut aussi se pencher sur la nature des emplois à combler pour comprendre la situation. Les deux postes les plus en demande sont ceux de serveur ou serveuse au comptoir (18 795 postes vacants) et de vendeur ou vendeuse dans le commerce de détail (10 070 postes vacants). Les services de restauration représentent d’ailleurs l’industrie qui affichait le taux de postes vacants le plus élevé, soit 14,2 % . Le salaire affiché pour les postes vacants de cette industrie s’élève à 14,55 $/h en moyenne. Le salaire des 10 professions les plus en demande, qui représentent près du tiers (31,9 % ) des postes vacants, était de 17,58 $ l’heure, contre 21,70 $ en moyenne pour l’ensemble des postes vacants et 28,73 $/h en moyenne au Québec, d’après Statistique Canada.
La majorité des postes vacants demandent peu de qualifications, peu d’expérience et offrent un salaire peu attrayant. Ainsi, parmi les postes vacants au Québec au cours du troisième trimestre de 2021, 38,5 % d’entre eux n’exigeaient aucune scolarité minimale, 20,1 % requéraient un diplôme d’études secondaires et 28,4 % demandaient un certificat ou un diplôme non universitaire. Pour 58,3 % des postes, moins d’un an d’expérience est requis. Certaines professions pour lesquelles de nombreux postes sont à pourvoir offrent de meilleurs salaires, mais la plupart d’entre elles viennent avec des horaires atypiques ou des conditions de travail difficiles, comme c’est le cas de la profession d’infirmière et d’infirmière auxiliaire (10 485 postes vacants) ou de conducteur·rice de camions (5 235 postes vacants).
Il serait en somme plus juste de dire que l’économie québécoise est affectée non pas par une pénurie de main-d’œuvre, mais bien par des difficultés de recrutement qui touchent principalement (quoique pas exclusivement) les industries et les professions offrant de moins bonnes conditions de travail. Le Québec n’est d’ailleurs pas le seul endroit à faire face à un tel problème. Aux États-Unis, on parle de « grande démission » pour qualifier un mouvement qui touche les bas salarié·es des secteurs de l’alimentation et du commerce.
Des solutions aux effets ambigus
De nombreuses solutions sont mises de l’avant pour surmonter ce problème. Certaines mesures visent à influencer la main-d’œuvre : faire la promotion de domaines d’études donnant accès à des industries ou à des professions où le recrutement est élevé, inciter les retraité·es à revenir sur le marché du travail ou encore favoriser l’embauche de personnes exclues du marché du travail. D’autres visent plutôt les emplois : modifier l’organisation du travail pour attirer la main-d’œuvre ou réduire les besoins en personnel. Deux mesures méritent particulièrement notre attention.
L’implantation de technologies dans les entreprises est présentée par plusieurs, dont le gouvernement du Québec, comme un moyen d’accroître leur productivité et de compenser le manque de main-d’œuvre. Or, si elle permet dans certains cas de remplacer des êtres humains, l’automatisation permet surtout d’accomplir certaines tâches à l’aide de machines en tout genre. La main-d’œuvre est plus souvent qu’autrement appelée à travailler avec les robots, ce qui signifie dans bien des cas de se plier à leur rythme et de s’adapter à leurs exigences, avec la part de souffrance psychologique et physique que cela implique.
Le cas des entrepôts de la multinationale Amazon, où le recours à des ordinateurs pour communiquer les tâches au personnel rend le rythme de travail particulièrement pénible, est à cet égard emblématique, tout comme celui d’Uber, une entreprise qui comme d’autres oblige les personnes offrant un service par son entremise à se plier aux commandes qu’envoie la plateforme. Dans la majorité des cas, l’automatisation apparaît comme une fausse solution qui ne fait qu’augmenter la cadence du travail, la surveillance des employé·es et l’aliénation des travailleurs et des travailleuses.
Qu’en est-il de l’immigration ? Le milieu des affaires et les représentants patronaux y voient une solution à leurs difficultés de recrutement. C’est potentiellement que les personnes immigrantes sont, aux yeux des employeurs, une main-d’œuvre prête à accepter de mauvaises conditions de travail faute d’avoir l’expérience ou le rapport de force nécessaire pour en exiger de meilleures.
Il importe cependant de rappeler que l’immigration est un phénomène complexe qui existe indépendamment de la réalité du marché du travail. Réduire notre capacité d’accueil ne réglera pas les abus et la discrimination que vivent les personnes immigrantes. En revanche, arrimer la politique migratoire aux besoins des entreprises pourrait être le meilleur moyen de garantir que les personnes immigrantes soient traitées comme des salarié·es de seconde zone. Par exemple, le gouvernement caquiste, qui adhère aux discours sur les problèmes d’intégration qu’une immigration trop abondante poserait, mise sur l’immigration temporaire pour répondre aux besoins du secteur privé. Depuis le 10 janvier, les entreprises de certains secteurs désignés peuvent embaucher jusqu’à 20 % de main-d’œuvre étrangère temporaire (plutôt que 10 % ). De par leur statut précaire, ces travailleurs et ces travailleuses sont plus susceptibles d’être victimes d’abus.
Ainsi, la politique migratoire ne doit pas être soumise en priorité aux impératifs des entreprises. Il n’en demeure pas moins que les personnes qui choisissent le Québec ont besoin de travailler et que lorsque l’économie se porte bien, elles s’intègrent plus aisément au marché du travail, comme en témoigne la diminution constante de leur taux de chômage depuis 2009 (de 13,9 %, il est passé à 7,0 % en 2019, et même de 22,7 % à 11,8 % pour les immigrant·es récent·es, selon les données de Statistique Canada).
Au-delà des emplois vacants
Un constat s’impose alors : la meilleure manière de pourvoir bon nombre de postes vacants est d’offrir des conditions salariales et de travail dignes et donnant accès à un revenu viable, c’est-à-dire un revenu suffisant pour vivre en dehors de la pauvreté et pour faire des choix. L’IRIS a calculé que pour une personne seule vivant à Montréal en 2021, un salaire de 18 $/h était requis pour atteindre un tel niveau de vie. Bien que la situation actuelle obligera sans doute des employeurs à emprunter cette voie, il ne faut pas s’attendre à des hausses substantielles, d’autant plus que le gouvernement refuse à ce jour de hausser significativement le salaire minimum (il passera à 14,25 $/h le 1er mai) et qu’il s’est contenté d’offrir des primes pour attirer du personnel dans le secteur public.
La mal nommée pénurie de main-d’œuvre nous donne l’occasion de nous questionner sur la qualité des emplois que produit l’économie québécoise et sur la pertinence de soutenir certaines industries. Pourvoir les postes actuellement vacants serait sans doute bénéfique pour les entreprises qui cherchent à embaucher, mais rien n’indique que ce soit dans l’intérêt du plus grand nombre de toujours le faire. À l’heure actuelle, surtout si on tient compte de la proportion décroissante de la population en mesure de travailler, la solution à ce problème est peut-être de décider collectivement du type d’emplois les plus utiles pour répondre aux besoins des citoyen·nes et pour opérer une réelle transition écologique.
[1] Selon les plus récentes données trimestrielles disponibles au moment d’écrire cet article (janvier 2022).