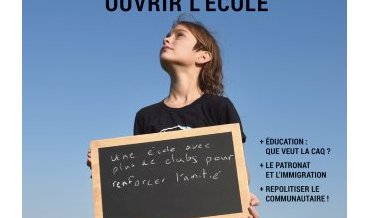Attentats de Paris
Vivre avec
,
Je rentre chez moi en métro sur la ligne 2. Après l’annonce inhabituelle : « La station Oberkampf est fermée sur ordre de la police », mon téléphone vibre. Un texto : « Fusillade dans ton quartier, j’espère que t’es chez toi. » Ce récit à la première personne est une composition de témoignages, d’expériences multiples.
Je passe la soirée la radio allumée et les yeux rivés sur les réseaux sociaux jusqu’à épuisement. Le décompte est macabre. Heureusement, aucun proche n’a été touché. Ça tient à peu de choses. Une heure avant, j’étais à la terrasse d’un des bars attaqués, le couple à qui j’ai laissé ma table ne s’est pas relevé. Aujourd’hui, les attentats se sont invités en bas de chez moi, j’ai été pris pour cible. J’habite dans le quartier depuis trois mois. Dans le 11e arrondissement de Paris, on est le vendredi 13 novembre 2015.
Au réveil, 115 morts et beaucoup de blessés. Des avis de recherche défilent encore. Je sors acheter la presse dans les rues désertes. Les Unes noires des journaux confirment que tout est bien réel. Notre 11 septembre. Le ciel est clair, les quelques regards croisés sont cernés et rougis. Je marche 10 minutes jusqu’à la place de la République, lieu de rassemblement depuis les attentats de Charlie Hebdo. En chemin la façade colorée du Bataclan est entourée d’un large périmètre de sécurité et d’une trentaine de camionnettes média, paraboles sur le toit. Les envoyés spéciaux se relaient devant les caméras. En une nuit, le quartier est devenu le centre morbide attirant les regards du monde entier. Il est tôt, la place de la République est encore vide, je continue de marcher vers le canal Saint-Martin, machinalement. C’est ce Nord-Est parisien que je connais bien, à cheval entre le 10e et le 11e arrondissement. Il y a un rassemblement devant deux lieux visés hier soir. Les impacts de balles visibles sur la façade et sur les vitres, des restes de sciure au sol pour éponger les traces de sang. Des larmes, des bougies et des fleurs. Le silence est glaçant. Les sirènes retentissent en continu toute la journée dans le quartier.
Le soir même, je retrouve spontanément des ami·e·s dans un bar. Ça fait du bien de se voir. On se rassure, on boit beaucoup. On plaisante, on tente d’oublier ; 130 morts maintenant et de nombreux amis d’amis parmi les victimes. On se rend compte qu’il va falloir maintenant vivre avec cette menace invisible et permanente, avec la peur de peut-être crever, ce soir, là, au coin de la rue. Comme dans tant d’autres pays du globe. Mais tout le monde ne partage pas cet état d’esprit : un ami se fait voler son vélo juste devant le bar. C’est peut-être, finalement, un samedi soir comme les autres à Paris. Peut-être que rien ne va changer... Au loin, la devise de Paris – Fluctuat nec mergitur, « battu par les flots, mais ne sombre pas » – s’affiche sur les panneaux lumineux de la ville.
Même pas peur ?
Dimanche soir, malgré l’interdiction de se rassembler, j’ai envie de sortir de chez moi. Sur la place de la République, le socle de la statue est devenu un véritable autel. Encore un parterre de fleurs, des messages, des dessins, des bougies partout et un calme d’église. Il y a très peu de policiers sur la place. D’un coup, un bruit, puis un mouvement de foule. La place se vide en moins de 20 secondes. Pris dans le mouvement, il est difficile de ne pas être embarqué malgré les appels au calme. Des caméras sont brisées, des poussettes abandonnées. La police en civil tente de nous diriger mais, dans l’affolement, des gens tombent sur les bougies, piétinent les fleurs et les gens à terre. Je cours comme pour éviter une fusillade. Mes jambes flageolent, j’ai la bouche sèche et le cœur qui bat très fort. Caché dans un hôtel qui a ouvert ses portes, planqué avec une vingtaine de personnes dans la cage d’escalier, on écoute les informations. Après confirmation de la fausse alerte, je rentre en vitesse, à contresens des sirènes de police. À plusieurs endroits de la ville, les mêmes affolements. Certains se sont même jetés dans le canal Saint-Martin. Une ampoule qui éclate, une porte qui claque trop fort suffisent à créer la panique que d’autres provoquent en faisant éclater des pétards.
François Hollande vient de prononcer un discours martial devant le Congrès réuni à Versailles. La France est en guerre et l’état d’urgence sera sûrement prolongé. Je me persuade qu’au fond rien ne va changer, que je vais continuer à sortir, voir des concerts et boire des bières en terrasse. Résister à cette peur sans visage. Comme pour me persuader, j’ai photographié la banderole Même pas peur accrochée sur la statue de la République. Le mot-clic #enterrasse se généralise, comme si consommer en terrasse était désormais un acte de résistance. Mais je me surprends à repérer les issues de secours en entrant dans une salle, je préfère prendre le bus plutôt que le métro, j’évite d’écouter la musique avec le casque pour rester alerte en cas de danger. Je me rends compte que mes réactions et celles des autres sont imprévisibles. Insidieusement, la peur et la méfiance s’installent.
Sous état d’urgence permanent
Depuis les attentats, les fouilles se généralisent. À la piscine, dans les magasins, il faut toujours ouvrir son sac. J’en ai un de couleur noire à quatre poches. C’est pénible de toutes les ouvrir devant les vigiles, mais je coopère. Je réfléchis sérieusement à en acheter un autre, en plastique transparent, plus « état d’urgence friendly », mais un ami m’a convaincu de garder celui-là : « Avec son épaisseur, ça peut peut-être te protéger un peu des balles. » Dans la brasserie où nous sommes, la table d’à côté est occupée par des militaires appelés en renfort dans la capitale. Après avoir ôté leurs gilets par balle et déposé leurs fusils d’assaut, ils avalent calmement un burger avant de reprendre la ronde de nuit. Un va-et-vient incessant toutes les 20 minutes qui n’a rien de rassurant. D’ailleurs, mon ami n’a pas dit à ses parents qu’il était venu me voir à Paris. À son retour, comme il s’y attendait, ils l’ont traité d’inconscient.
Ce matin, sur la porte de l’immeuble en face de chez moi, une photo et quelques fleurs sont accrochées. C’est un visage que je reconnais. J’ai lu sa nécrologie dans la presse. La jeune femme de 24 ans a vécu ici ; sur le message « ses voisins se souviennent ». En route pour l’université, le RER s’arrête pendant 30 minutes après un énième colis suspect. À l’entrée de mon bâtiment, des bougies et des fleurs à la mémoire de deux professeurs. Le cours est annulé. Sur le chemin du retour, un nouveau colis suspect ralentit la circulation. En rentrant, la serveuse du café d’en face de chez moi a réceptionné un colis à mon nom. Elle m’avoue qu’avec « tout ce qu’il se passe », elle a eu peur de le prendre, mais « heureusement que mon nom n’est pas trop étranger... » Mon amie ne travaille pas ce matin, la police a bouclé le quartier où elle travaille pour un assaut interminable. On se retrouve alors pour manger au restaurant habituel Le cent kilo. L’établissement est fermé, il y a des fleurs partout devant. Pareil au Café des anges et au Comptoir Voltaire. Les nécrologies, que je lis tous les jours compulsivement me donnent les réponses : des membres du personnel ont aussi été tués.
Depuis, chacun gère ses émotions à sa manière. Chacun sa stratégie. J’hésite à me remettre à fumer. Comme pour m’y inciter, le marchand de tabac a affiché sur sa vitrine les noms des victimes. Difficile d’oublier. Après une coupure d’électricité dans la rame du métro, une femme se plonge dans Comment réagir en cas d’attaque terroriste, le livret de prévention publié en décembre par le gouvernement. Aujourd’hui, le premier ministre a annoncé un projet de modification du Code pénal pour étendre les pouvoirs de la police. Menace terroriste et sécurité nationale obligent. Mais il y a toutes ces perquisitions abusives, les assignations à résidence d’activistes écologistes pendant la COP21 qui n’ont rien de rassurant. La communauté musulmane est elle aussi visée : lieux de culte, associations confessionnelles et certains restaurants ont reçu la visite musclée des équipes antiterroristes galvanisées par l’état d’urgence. Après les attentats, la tendance est aux amalgames. Que penser de cette femme en abaya dans le métro ? Le profil type du terroriste est devenu incertain. Aujourd’hui, n’importe qui peut brandir une hache et menacer en se revendiquant de Daesh. C’est arrivé avant-hier dans le 18e arrondissement, aujourd’hui dans un lycée à Marseille.
L’état d’urgence va laisser des traces. La lutte antiterroriste et la peur sont d’habiles outils de gouvernance. Comment résister à la paranoïa et au piège sécuritaire à l’approche des élections présidentielles de 2017 ? L’extrême droite monte en flèche et les communautés se referment sur elles-mêmes. Mes réflexes et mes habitudes ont changé, la contrainte de la présence militaire est progressivement intégrée, devant les lieux de culte, les écoles, dans les restaurants, les transports en commun et les lieux touristiques. La contrainte de la fouille permanente et des portiques pour entrer dans des gares et les musées. Que penser des drapeaux français maintenant pendus aux fenêtres des Parisien·ne·s ? Les réactions sont multiples entre ceux qui s’inscrivent à l’armée ou à des cours d’autodéfense, ceux qui crient au complot, ceux qui ont peur et ceux qui tentent d’oublier. Maintenant, dans le 11e arrondissement et ailleurs, on doit tous s’organiser et apprendre à vivre avec.