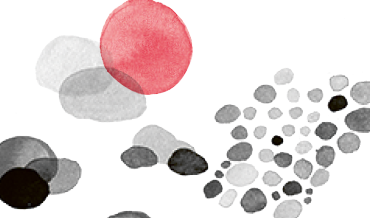À l’origine de Tricofil
L’occupation de 1972
Devenue un mythe dans l’imaginaire québécois, l’histoire de Tricofil à Saint-Jérôme (1974-1982) s’inscrit parmi les plus exaltants récits ouvriers de notre histoire. Si les faits saillants de l’aventure autogestionnaire sont passablement connus, rarement aborde-t-on ses conditions d’émergence du point de vue de l’autonomie collective. Cet article s’intéresse ainsi à une étape d’incubation décisive qui mènera au rachat de l’usine textile par les travailleuses et travailleurs : l’occupation de 1972.
Cette année-là, à la Regent [1] plane la rumeur d’une fermeture de l’usine au profit d’une augmentation de la production de celle de Montréal (les actuels ateliers Grover, rue Parthenais) où la main-d’œuvre est honteusement meilleur marché. Fin de contrat de travail, mises à pied massives (300 congédiements) et bris d’ententes, les travailleurs·euses répondent à ces méthodes de gestion indignes par un premier débrayage en novembre 1972. Les mouvements sociaux sont alors en pleine ébullition. Encouragé par le Front commun, le syndicat de la Regent, que l’on cite parmi les plus combatifs à l’époque, n’échappe pas à la mouvance.
Devant l’inconséquence patronale, le 30 novembre, le comité exécutif appelle les travailleuses·eurs à une réunion d’urgence à la cafétéria de l’usine. « On était convaincu qu’on réglerait la journée même ou le lendemain au pis aller », rapporte Pierre-André Boucher [2], alors président du syndicat. L’avocat de Grover est très clair face à la « menace » des ouvrières et ouvriers : soit ils retournent à l’ouvrage, soit ils sortent de l’usine. Les camarades de la Regent résolvent ce faux dilemme et paralysent la production. La riposte sera symétrique : entre 250 et 500 travailleurs·euses occuperont l’usine par rotation, sans cesse menacés qu’aucune négociation ne sera entreprise sans retour au travail. L’occupation durera pratiquement un mois et plus de la moitié des occupant·e·s sont des femmes.
Une occupation déterminante
Le syndicaliste Pierre-André Boucher fait référence à l’occupation comme d’une « fraternité différente de celle qu’on trouvait dans les réunions ou les assemblées générales syndicales » et d’un « gros acquis » à l’aventure de Tricofil qui devait s’amorcer deux ans plus tard. Une franche camaraderie attisée par l’organisation de comités (cafétéria, entretien, journal, négociation et relations extérieures). « Les jeunes étaient beaucoup plus échauffés que les vieux », raconte-t-il. Les journaux de l’époque évoquent à l’unisson des organismes, un clergé et une mairie concernés – une ville mobilisée.
Un premier pas dans la réappropriation de l’usine par les ouvriers·ères : la visite des ateliers. Habituellement confinés à leur département respectif, les travailleurs-euses peuvent enfin étancher leur curiosité et découvrir l’atelier de leurs camarades ! Grand moment, témoigne Boucher, qui amène les ouvriers·ères à saisir leur rôle dans la chaîne de production. Cette épiphanie aura un impact déterminant sur les relations de travail, comme le raconte le syndicaliste : « On a vu à quel point c’était important pour la couturière d’aller voir la teinturerie ou pour les teinturières de visiter l’atelier de couture ou de tricot ! Pour ma part, c’est à ce moment-là, quand j’ai entendu les commentaires des travailleurs, que j’ai pu comprendre toute la force de l’entreprise privée et du capitalisme, qui sépare les opérations et détruit les équipes de travail comme cela s’est fait avec le travail à la chaîne et les principes de Taylor. »
Auparavant, quand les teinturiers et teinturières voulaient débrayer, décriant la chaleur insupportable dans leur département, et qu’à la même assemblée générale, les embobineuses pestaient contre le froid ardent du leur, « les autres se disaient : « les gars, faites-vous une idée, est-ce qu’on crève ou qu’on gèle ? » », décrit Boucher dans son vivant témoignage. La visite a eu cet effet de sensibiliser les travailleuses·eurs aux réalités des leurs, ce que les témoignages n’avaient jusqu’ici su égaler.
Autre moment fort : une journée durant, l’usine ouvre ses portes au public. Ce mythique monstre aux fenêtres barricadées qui, soir et matin, avale des centaines de Jérômien·ne·s, parents et amis pouvaient enfin le visiter ! L’engouement fut tel que près de 500 visiteurs répondirent à l’appel des occupant·e·s. Ils purent finalement visiter le milieu de vie de leurs proches, le temps de ce dimanche portes ouvertes.
Il serait cependant romantique de ne traiter que de la chaleur des liens tissés au cours de l’occupation de 1972 ; au compte des bilans, sa portion administrative mérite tout autant l’attention.
De la démocratie syndicale
Récapitulons. C’est au bout de 10 jours d’occupation que le Congrès du travail du Canada (CTC) commence à s’intéresser au conflit. Le syndicat avait demandé à avoir accès au fond de grève. Or, pour en bénéficier, il fallait… être en grève, répliquait le Congrès ! Que la recette soit conforme : usine fermée, piquetage aux portes. La FTQ y allait de la même tergiversation, le fonds de secours n’était accessible que dans la mesure où l’on convainquait le Congrès à Ottawa des tenants et aboutissants d’une occupation. Yvon Leclerc, alors permanent au CTC, appelle donc à la tenue d’un vote de grève. Le CTC rétorquera à Leclerc de plutôt « prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs retournent [au travail] », « de reprendre le cours normal des négociations » et que « si [elles] n’apportent pas de succès, à ce moment-là, le congrès considérera la question de grève », et ce, « selon sa procédure [3] ».
Suite à cela, jugeant qu’« il ne voyait plus rien, ne comprenait plus rien », le Congrès remplacera Leclerc pour « trouver un compromis » et ainsi mettre fin à l’occupation. Le CTC prescrit donc l’embauche de l’ex-président syndical Édouard Gagnon, embauche sur laquelle l’exécutif sera « obligé de trancher », selon Boucher. « Certains pourraient dire que c’est la compagnie qui a dicté notre régie interne », confie-t-il dans son récit sur ce choix qui aura une portée décisive. Il met en question l’émotivité des porte-parole et le sentiment que Grover « n’aurait jamais négocié ». Leur décision d’embaucher Gagnon à cette fin rappelle les « objectifs que les travailleurs [s’étaient fixés] au début d’un conflit ».
Ainsi, trois semaines après le début de l’occupation et à la veille de Noël, la Regent entreprend finalement des négociations. Un marathon de 24 heures tient en haleine les travailleuses et travailleurs au terme duquel ils seront convoqués en assemblée générale le soir même. L’offre stipule grosso modo le rappel des engagements de la Regent (qui, finalement non tenus, avaient mené à l’occupation). « Ça commençait à gigoter fort en maudit dans l’usine ! », déclare Boucher, en référence au mécontentement suscité par l’offre négociée, ce sur quoi l’exécutif est clair : aucune recommandation. Aucune parce que les membres de l’exécutif sont divisés. Néanmoins, Gagnon, craignant de voir l’usine fermer, invitera l’assemblée à accepter l’offre. Cette position sera contestée par « les dissidents » qui « déviaient complètement les revendications premières de l’occupation ». « Quand on va leur avoir donné la lune, ils vont nous demander la planète Mars », prétendait Gagnon.
Aussitôt l’assemblée terminée, Leclerc démissionne avec fracas, accusant l’organisation d’avoir exercé des pressions indues pour que les travailleurs·euses acceptent les propositions patronales. Quatre officiers de l’exécutif emboîteront le pas et les journaux de l’époque racontent qu’une soixantaine d’employé·e·s renonceront à poursuivre leur vie à la Regent. Le CTC accuse tacitement Leclerc « d’avoir oublié l’objectif du départ », « d’avoir fait du conflit une question personnelle, d’être contrôlé par des éléments extérieurs ». Dans cette tempête d’insatisfaction lors des jours qui suivent à l’usine, se chuchote la possibilité d’une reprise de l’occupation. Les murmures déclineront après quelque temps. Si le CTC se disculpe de ne pas avoir fait des travailleurs·euses de la Regent « des gars de Lapalme », le travail reprendra néanmoins à l’usine au détriment de la solidarité syndicale.
Conclusion
Selon Boucher, l’occupation n’est somme toute pas étrangère à la solidarité régionale et à la résilience des travailleuses·eurs face à la fermeture de l’usine en 1973. Son bilan est clair : l’occupation était un moyen de pression jusqu’alors peu utilisé dont le rendement a surpassé les attentes, et ce, malgré l’obstruction opérée par la Centrale et le syndicat. C’est d’ailleurs au cours de cette occupation que les travailleurs·euses planchèrent sur la location, sinon le rachat potentiel de l’usine. Si le rêve autogestionnaire est modéré « par les technocrates de la FTQ », il deviendra néanmoins réalité deux ans plus tard.
[1] Regent Mills Knitting (1916-1974), une institution industrielle dont les pouvoirs étaient presque absolus. En 1972, les conditions misérabilistes poussent le syndicat (FTQ-CTC) à sa sixième grève depuis 1939. Notons que celle de 1963 s’était soldée, au bout de 18 semaines, par une émeute et le kidnapping du fils du propriétaire de l’époque.
[2] Pierre-André Boucher et Jean-Louis Martel, Tricofil tel que vécu !, les Éditions CIRIEC en collaboration avec les Presses HEC, 1982, p. 52-59.
[3] Huguette Laprise, « Le travail a repris à la Regent Knitting mais au détriment de la solidarité syndicale », La Presse, 2 janvier 1973 ; Le Quartier Latin, « On a raison de se révolter », dossier spécial, 13 décembre 1972, p. 5-12 ; Marcel Simard dans L. Collonges, Autogestion, hier, aujourd’hui, demain, Éditions Syllepse, 2010, p. 583-592.