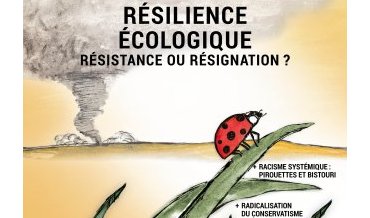Dossier : Saguenay - Lac-St-Jean. Chroniques d’un royaume
Ce que je vois
Je ne suis pas Autochtone. J’ai bien une arrière-grand-mère micmac, mais celle-ci a épousé un Blanc et, pour cette raison, a dû couper tout contact avec sa famille, sa culture, sa langue, en renonçant à son statut d’Indienne, ainsi que le stipulait alors la Loi sur les Indiens. Cela a eu pour effet que tout un pan de ma mémoire familiale m’est interdit.
Sans cette disposition de la loi, mon grand-père aurait connu ses grands-parents maternels, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, la langue micmac, des contes aussi sans doute, et comme il était passionné de connaissance, il aurait transmis à ses enfants cet héritage immatériel, que j’aurais reçu à mon tour de ma mère. Mais il n’en est rien. La loi a fait en sorte que la transmission de la culture a été coupée. Je ne suis pas Autochtone. Et parce que je ne suis pas Autochtone, je n’ai pas le vécu d’une Autochtone. Je ne peux donc pas parler du racisme à partir de ce point de vue. Tout ce dont je peux témoigner, à titre personnel, c’est du fait qu’une loi ouvertement génocidaire m’a privée d’une part d’identité que je ne pourrai jamais revendiquer. D’un autre côté, si j’avais pu revendiquer cette identité-là, j’aurais été, et ma mère aussi, forcée de vivre dans une de ces horribles écoles résidentielles où l’on a, durant plusieurs générations, tenté d’éradiquer l’indianité de dizaines de milliers d’enfants, en les battant, en les affamant, en les frigorifiant, en les humiliant, etc. Vous voyez l’ironie ? L’obligation raciste faite à mon arrière-grand-mère de renoncer à son identité m’a évité cette expérience-là. Une expérience qui aurait brisé ma mère, son frère et ses sœurs, nous aurait doublement brisés moi, mon frère, nos cousins et cousines, et aurait aussi brisé nos enfants par le biais du traumatisme intergénérationnel. On n’en sort pas.
Donc, je ne suis pas Autochtone. Je n’ai pas le vécu de la réserve, pas celui du Territoire, pas celui non plus de l’individu aux cheveux noirs et aux yeux en demi-lune dans la ville. Pas le vécu des pensionnats, pas le vécu de la honte et de l’interdiction, pas celui du citoyen de seconde zone, des préjugés, des idées reçues. Du racisme. Mais je vois ces choses. Je les vois parce que je côtoie de près et au quotidien, depuis une vingtaine d’années, des membres des Premières Nations. Je peux parler de ce que je vois. Et ce que je vois, c’est que le racisme est présent sur le territoire de la petite ville du sud du Nord où je travaille. Un racisme décomplexé, omniprésent, systémique. Je vais vous raconter ce que je vois.
En ville
Je vois des étudiant·e·s des Premières Nations qui arrivent en ville, qui se cherchent un logement et qui ont du mal à trouver parce que certains propriétaires ne louent pas aux Autochtones pour cause de « mauvaise expérience » passée. Mauvaise expérience ? Pour qui ? Quand ? Combien de fois ? Refusent-ils de louer à des Blancs pour cause de mauvaise expérience aussi ? Il n’y a pas de mauvais locataires Blancs ? Pas de mauvais payeurs, malpropres, bruyants, brise-fer Blancs ? Je vois des gens des communautés autochtones venir en ville pour permettre à leurs enfants d’avoir une meilleure éducation, les écoles des réserves étant sous-financées, faméliques et manquant d’enseignant·e·s qualifié·e·s (ah tiens, une éducation à deux vitesses…) et avoir du mal à trouver à se loger sous prétexte du nombre d’enfants. À ce que je sache, il est illégal de refuser un logement à cause des enfants.
Je vois aussi des jeunes Autochtones se chercher des jobs d’étudiants. En vingt ans, je compte sur la moitié des doigts d’une main ceux qui ont réussi à en décrocher une. On envoie son CV, on est demandé en entrevue et la job est mystérieusement devenu indisponible lorsqu’on se présente. Il y a les places en garderie aussi. Des jeunes femmes qui appellent, à qui on dit oui, il reste une place pour un enfant de l’âge du vôtre ; certaines de ces jeunes femmes vont rencontrer une responsable qui va leur dire, en les voyant : « Désolée, je m’étais trompée, la place disponible n’est pas du tout pour l’âge de votre enfant. » Et lorsqu’on appelle pour tester, ensuite, on se fait dire oui oui, il reste une place pour un enfant de cet âge… Il y a l’école, où il arrive que des responsables interdisent aux enfants de parler leur langue autochtone entre eux. L’école, où il arrive encore que des profs d’histoire ou d’autres matières répandent des idées fausses sur les Indiens profiteurs du système, jamais contents, paresseux, etc. L’école, où il est possible que cette étudiante au collégial entende dans son dos des insultes (« Sauvage », « Kawish ») ou ce bruit de bouche hérité des dessins animés qui n’a rien à voir avec la réalité, et tout à voir avec le mépris : « Whou whou whou ! » L’école, où des enseignantes et enseignants pourtant instruits voient, dans certains accommodements nécessaires à la réussite de ces étudiant·e·s qui doivent surmonter bon nombre d’embûches, « encore des privilèges ». L’école, où l’intimidation et les bagarres sont monnaie courante dans la cour de récré.
Je vois des regards. Ce commis de magasin qui suit « discrètement » cette famille dans les allées, parce que, on le sait, ils peuvent voler. Cette femme, à la pharmacie, qui ne se gêne pas pour regarder longuement, avec une moue désapprobatrice, des pieds à la tête un jeune couple qui fait tout bonnement ses courses dans la bonne humeur. Ce couple âgé, dans un ascenseur, qui se demande ce qui sent l’alcool, et dont l’homme désigne du menton la jeune femme autochtone, là, dans le coin, alors que c’est moi qui viens de me mettre du gel antibactérien sur les mains.
Je vois des poubelles vidées sur des balcons, des graffiti haineux tracés dans la poussière sur les voitures, des gens réveillés en pleine nuit par du monde qui varge sur la porte de leur logement en hurlant debout les sauvages. Je vois des jeunes qui jettent du pop-corn sur les cheveux noirs de personnes qui sont simplement là, comme eux, pour voir un film. Je vois du monde s’étonner de la propreté du musée de Mashteuiatsh, de la qualité du travail d’un élève, de l’élégance d’un jeune homme, de l’éloquence d’une jeune femme. Je vois certains de mes pairs considérer que nos efforts pour accompagner nos étudiants des Premières Nations dans leur parcours scolaire sont vains, parce qu’ils ne sont tout simplement pas capables, et ce, malgré tous les exemples de réussite, et ils sont nombreux, à tous les niveaux. Je vois du monde se faire dire dans un McDo de la région : « T’as pas d’affaire icitte, crisse ton camp. » – Eux qui sont si accueillants et généreux. – Je vois de la part des forces policières du profilage racial par lequel un nombre significatif de gens se font arrêter pour « simple vérification ». Je vois tout ça, et plein d’autres choses.
Appartenance
Je ne suis pas Autochtone. J’ai néanmoins hérité d’assez de traits de cette partie occultée de ma famille pour qu’on me demande à l’occasion à quelle nation j’appartiens. Ou si je suis une 6.2 ou une 6.1, en référence à l’article de la Loi sur les Indiens qui définit qui peut transmettre son statut à sa descendance et qui ne le peut pas, selon son degré de « sanguinité ». Cela me flatte, que l’on puisse me prendre pour une des leurs. Parce que je suis leur amie, parce que je vois des personnes des Premières Nations au quotidien et que je sais leur force et leur beauté, parce que je les aime et les admire sans mesure. Mais j’ai les yeux bleus et je n’ai pas le vécu des réserves. Je ne sais donc pas ce que c’est que de vivre, au quotidien, dans un monde qui vous est hostile à un nombre effarant de points de vue, avec la fierté et la dignité qui sont les leurs. Dans ce racisme d’apartheid, tellement ancré dans la pensée collective qu’il convient de l’appeler systémique. Je ne peux que voir. Je ne peux que témoigner de ce que je vois.
Et vous, que voyez-vous ?