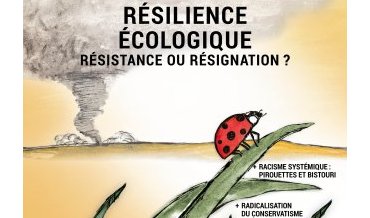Culture
Montréal. Ville autochtone
Aujourd’hui, la majorité des Autochtones du Canada devient urbaine. Alors que cela risque de bouleverser définitivement la vision passéiste que l’on a trop souvent d’eux, j’ai souhaité rencontrer dans le cadre d’un projet photographique une dizaine de jeunes habitant à Montréal. Celles et ceux y ayant presque toujours vécu ont bien voulu m’expliquer ce qui les a retenus en ville ; celles et ceux arrivé·e·s il y a peu m’ont évoqué les raisons de leur venue et les conséquences que cela a eues sur leur vie et leur identité. Voici une partie de ce qu’il m’a été permis d’apprendre.
Une des caractéristiques principales des Premières Nations, des Inuits et Métis dans le Canada du XXIe siècle est leur urbanisation grandissante. Celle-ci demeure encore très faible comparée au reste de la population (80 % de la population canadienne vit dans les centres urbains contre 50 % de la population autochtone), mais représente néanmoins un phénomène d’une ampleur inédite.
Au Québec, ce mouvement a véritablement commencé au début des années 1980, et Montréal a ainsi vu au cours des trente dernières années un doublement décennal de sa population autochtone, atteignant aujourd’hui près de 20 000 personnes. En conséquence la proportion d’Autochtones qui vivent en ville ne cesse de croître, portée par l’intensification de l’exode, le plus souvent définitif, des jeunes des réserves vers les centres urbains.
Une présence discrète
Avant d’arriver au Québec, et venant d’un pays où l’on ne reconnaît pas l’existence de minorités ni de majorité, je pensais que mon installation à Montréal serait l’occasion de plonger dans une ville riche de la présence de populations issues des Premières Nations, des Inuits, et que cela lui donnerait une importante profondeur culturelle. L’importance de leur rôle dans cette ville et le bénéfice de la fertilité de leur regard sur la société québécoise y seraient reconnus. Au mépris des leçons à tirer de l’Histoire, un optimisme naïf peut toujours faire passer sous silence le non-démantèlement dans le présent des mécanismes de ségrégation qui nous rendent parfois si indignés envers le passé.
Ainsi, après plusieurs mois passés à découvrir les différents quartiers de la ville et des activités culturelles variées, j’ai remarqué que, malgré le nombre important d’Autochtones vivant à Montréal, le hasard ne m’avait pas donné l’occasion d’en rencontrer. Il me semblait que leur présence dans la ville n’était pas évidente, Montréal ne comptant pas non plus de musées d’histoire, de culture ou d’art autochtone (ceux qui existent au Québec sont tous sur des réserves en dehors de la ville, alors que le nombre d’Autochtones vivant à Montréal est bien plus important que dans n’importe quelle réserve), et les quelques galeries d’art inuit du Vieux-Montréal ont surtout une visée commerciale et sont tenues par des personnes qui ne sont ni Inuits ni Amérindiens. Il existe bien le Centre d’amitié autochtone, mais son mélange des genres, entre sensibilisation culturelle et intervention sociale auprès des Autochtones les plus marginalisé·e·s, fait qu’une frange plus aisée de la population autochtone se refuse à le fréquenter et qu’il peine à atteindre un public plus large.
La comparaison avec les personnes issues d’un pays étranger n’est pas heureuse, pour des raisons historiques flagrantes, mais elle permet de se rendre compte des différences de visibilité entre les diverses communautés. Les immigrés italiens ou chinois, arrivés relativement récemment à Montréal, ont chacun investi un quartier délimité par des portes d’entrée et que la mairie reconnaît comme étant la Petite Italie ou le quartier chinois, au sein desquels la densité d’habitants et de commerces rend évidente leur présence et exhibe leur culture. On peut ainsi avoir l’impression que les Montréalais d’origine chinoise sont bien plus visibles que les Autochtones alors qu’ils ne sont qu’à peine plus nombreux qu’eux sur l’île de Montréal. C’est ce manque de visibilité patent, impliquant l’impossibilité de la rencontre fortuite, qui provoqua ma démarche.
« Je dirais que je suis un Autochtone urbain »
La première personne avec laquelle j’ai pu véritablement discuter est Delores, une Crie qui a quitté sa réserve Mistissini, dans le nord-ouest du Québec, il y a cinq ans pour déménager à Montréal. Elle habite aujourd’hui dans l’ouest de l’île avec son fiancé, un jeune Québécois né de parents immigrés qui l’a crue la première fois qu’elle lui a dit que dans sa réserve ils vivaient dans des tipis, et leurs deux enfants. Arrivée seule à l’âge de 17 ans, elle s’est sentie étouffée par les responsabilités et par sa peur de parler aux gens qu’elle ne connaît pas :
« Je devais partir de ma communauté parce que j’avais l’impression de ne rien faire avec ma vie là-bas. La seule chose que je voyais était des gens en train de boire. C’est ce que je faisais aussi et je ne m’aimais pas alors j’ai décidé de venir à Montréal. J’ai eu le mal du pays en vivant seule parce que dans la réserve il y a toujours ta famille et plein de gens autour de toi, on ne fait jamais rien seul. Je pleurais souvent la nuit en pensant à ma famille parce que je me sentais bloquée. »
Leur arrivée dans la ville est perçue à la fois comme une opportunité mais aussi comme un défi, et des difficultés importantes sont parfois rencontrées. Cory, Micmac par sa mère et Shuswap par son père, a lui vécu à Montréal depuis l’âge de quatre ans et ne garde que très peu de souvenirs de sa vie dans les réserves. Il revendique une identité autochtone très forte qui l’influence personnellement, culturellement et professionnellement. Il est ainsi un danseur de pow-wow assidu, participe à des conférences pour parler de la culture autochtone et travaille comme intervenant social dans le centre d’hébergement pour Autochtones du centre-ville de Montréal. Pour lui, la ville est vraiment l’endroit auquel il appartient : « Je suis là depuis vingt ans, maintenant c’est ma maison ici j’imagine. Je connais juste ma réserve en y étant allé quelques fois pendant l’été, donc je dirais que je suis un Autochtone urbain. »
L’urbanisation comme miroir de la situation dans les réserves
Les Autochtones que j’ai rencontrés, dont eux-mêmes ou leurs parents sont issus de réserves implantées dans tout le Canada, m’ont chacun parlé de leurs diverses expériences dans celles-ci. Leurs témoignages décrivent pour la plupart un attachement très fort à leur réserve, mais aussi une lassitude tout aussi importante vis-à-vis des problèmes sociaux qui n’y trouvent pas de résolution. Les discussions ne visaient pas à découvrir les aspects négatifs de la vie dans les réserves, mais leur évocation a rapidement émergé.
Jackie est une Inuit arrivée depuis quelques mois seulement avec son petit ami. Elle dit adorer sa nouvelle vie à Montréal, après avoir réussi à surmonter le choc culturel initial. Pour décorer leur appartement, ils ont acheté juste avant de partir dans le magasin de souvenirs de l’aéroport d’Iqaluit un petit panneau de bois sur lequel est écrit : « Puisses-tu avoir chaud dans ton igloo, de l’huile dans ta lampe et la paix dans ton cœur. » Quand je leur demande pourquoi ils aiment Montréal, Jackie répond, par opposition, pourquoi la vie dans le Grand Nord n’était plus possible pour eux : « Nous n’avions pas d’endroit pour rester à Iqaluit, car les loyers sont trop élevés. Nous avions aussi juste besoin de partir loin du Nunavut. Il n’y a pas beaucoup de choses à faire là-bas, donc beaucoup d’Inuits ont recours à la drogue, à l’alcool. Il y a aussi énormément de suicides et de violence. »
Malgré la volonté de certain·e·s de partir à la découverte d’une nouvelle vie urbaine ou d’accéder à la possibilité d’étudier, une majorité de ceux et celles qui ont déménagé adultes fuyait surtout un milieu social devenu insupportable. Dans ce cas, le quitter était leur seule issue possible, le seul moyen pour eux d’accéder à une vie meilleure même si, dans l’absolu, leur désir aurait souvent été de pouvoir y rester.
Au contraire, Michael a lui été placé dans une famille d’accueil anglophone de Montréal à l’âge de cinq ans et n’a donc gardé que très peu de souvenirs de son passé dans la réserve. Il n’a redécouvert qu’adolescent qu’il avait de la parenté autochtone et a alors cherché à comprendre d’où il venait et à en apprendre la culture. À vingt-deux ans, le fait d’être autochtone représente pour lui un lien familial, « comme un lien de parenté sur lequel vous avez été branché, comme une toile d’araignée. Et tu sais que tu es en sécurité, que tu vas avoir du soutien. Il y a des histoires tristes sur les Autochtones, l’alcool, le suicide, les cow-boys, les bagarres et tous ces trucs. Mais les meilleures histoires sont les histoires spirituelles, les enseignements. Ils ont vécu tant de moments douloureux qu’ils connaissent probablement un grand nombre de réponses, la voix de la guérison, et que pour moi ils sont profonds. Je sais pas trop, mais je suis juste super fier d’être Autochtone. »
La ville ne s’oppose pas à la culture autochtone
Bien que leur famille manque souvent terriblement à celles et ceux qui sont venus seul·e·s, les jeunes Autochtones qui arrivent en ville pour fuir leur réserve peuvent ressentir un dédain envers leur communauté d’origine qui doit alors être équilibré avec leur fierté d’appartenir à un peuple autochtone. Or, des aspects de la vie urbaine peuvent aussi apparaître comme difficilement conciliables avec leurs valeurs et l’équilibre peut être complexe à trouver.
Pour Delores, il s’agit de parler quotidiennement le cri, sa langue maternelle, qui constitue pour elle un lien précieux avec son histoire. Tous les jeunes n’ont pas forcément l’opportunité de communiquer dans leur langue, mais elle a la chance de pouvoir la transmettre à ses enfants et de la parler avec son fiancé. Il a aussi décidé de l’apprendre et connaît selon elle la moitié du vocabulaire : « Je n’ai pas peur de perdre ma langue, car je vais empêcher que ça arrive. Je veux que mon fils la parle afin qu’il puisse communiquer avec mon arrière-grand-mère, qui veut pouvoir lui apprendre d’où nous venons et des trucs comme ça. C’est très important pour moi. » Comme plus de la moitié des jeunes que j’ai rencontrés, Delores prévoit de retourner chaque année dans sa réserve, notamment pour voir sa famille.
Pour Cory, qui a presque toujours habité à Montréal, le fait de vivre sur une réserve et celui de préserver la culture autochtone sont totalement dissociés. C’est surtout un choix de vie, une démarche que personne ne peut être obligé de faire : « Beaucoup des grandes figures dans notre communauté ne vivent pas dans une réserve. Certains pensent que ce serait traditionnel de rester sur les réserves, mais le monde change. Il est très important que l’on conserve notre culture, mais je pense que ça n’a rien à voir avec le lieu où on vit, mais plus avec ce à quoi on croit et notre manière de vivre notre vie. »
L’innovation culturelle pour être vu et entendu
La vie urbaine est encore plus éloignée de la manière dont vivaient les Autochtones du siècle dernier que ne l’est la vie dans les réserves. Mais les Premières Nations, les Métis ainsi que les Inuits vivant en ville s’efforcent tout autant que les autres d’affirmer leur appartenance autochtone et de la faire reconnaître. De nouvelles formes culturelles émergent alors, permettant à une nouvelle modernité autochtone de se créer dans les milieux urbains, que ce soit en organisant des cérémonies dans la ville, en participant à des pow-wow d’hiver dans les salons de grands hôtels ou en s’appropriant la musique rock ou le hip-hop.
Avec l’arrivée cet automne de l’exposition itinérante Beat Nation : art, hip-hop et culture autochtone au Musée d’art contemporain de Montréal, une occasion est donnée de les mettre en lumière. Au lieu de se dissoudre et se désintégrer, l’identité culturelle autochtone serait en réalité renforcée par les nouvelles formes d’art et de création. Pour Joey, un Inuit aux airs discrets que j’ai rencontré alors qu’il récitait un poème à une veillée en hommage aux victimes de brutalité policière, le slam est devenu le moyen d’affirmer son point de vue publiquement : « Au cours des dernières années certains de mes travaux sont devenus socialement engagés et politisés. Je puise mon inspiration dans tout ce qui arrive dans le paradigme social, j’essaie juste de montrer mon point de vue. »
Idle No More comme mouvement autochtone urbain
Le hip-hop autochtone serait alors plus souvent utilisé comme outil de réappropriation, de transmission des valeurs traditionnelles que d’acculturation. Bien qu’étant pancanadienne et donc peut-être en partie déphasée de la réalité montréalaise, l’exposition dans le centre-ville est certainement l’expression, ou l’indice, d’un changement en cours qui consolidera la place des Autochtones dans les villes.
Finalement, une des réussites du mouvement Idle No More a aussi été de rendre les Autochtones plus visibles dans les villes, en leur permettant de s’approprier leurs modes d’organisation spécifiques afin de les accorder à leurs aspirations sans plus les subir. Complétant le rôle habituellement porté par les réserves, les villes étaient alors devenues de nouveaux centres de la contestation autochtone. Les Autochtones sortaient dans les rues des grandes villes et les centres d’achat des plus petites, souvent non pas comme des ambassadeurs venus des réserves, mais comme des résidant·e·s de ces lieux.
La visibilité gagnée dans les centres les installait comme groupe faisant partie de la cité. Cela pouvait donc leur permettre de témoigner des problèmes de fond qui aujourd’hui concernent et préoccupent toutes les personnes appartenant aux Premières Nations du Québec, mais aussi de montrer que leurs dénonciations pourraient dorénavant se cristalliser avec une intensité toute particulière dans les centres urbains.
« Après l’école, je veux travailler dans un centre de traitement pour les jeunes, je sais comment le faire parce que je suis déjà passée par là. Je suis partie de ma réserve dans le but de rester sobre et de suivre mes rêves alors je n’y retournerai pas, je veux rester pour toujours vivre à Montréal », conclut Delores.