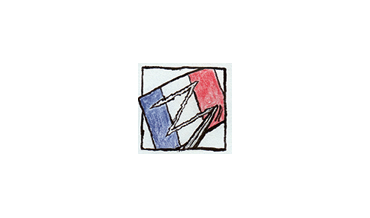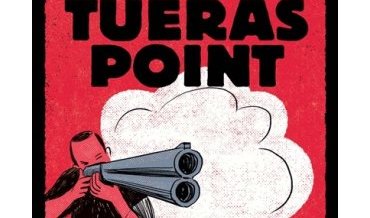Scandales et corruption en Turquie
Tapis glissant pour Erdoğan
Entretien avec Jean Marcou
,
Le 17 décembre dernier, une vague d’arrestations a frappé le milieu politique et des affaires en Turquie. Plus de 50 personnes, dont des individus très en vue – fils de ministres, maire d’un arrondissement d’Istanbul, hauts fonctionnaires, directeur de banque, etc. –, ont été arrêtées pour des motifs de malversations, de corruption et de blanchiment d’argent. Le Parti pour la justice et le développement (AKP) du premier ministre Recep Tayyip Erdoğan a été directement touché par cette opération sans précédent. En pleine année électorale et près d’un an après les manifestations de Gezi, qui ont enflammé les grandes villes turques à l’été 2013, À bâbord ! s’est entretenu avec Jean Marcou, professeur à l’Institut d’études politiques de Grenoble et spécialiste de la Turquie, afin de faire le point sur la situation sociale et politique en Turquie.
À bâbord ! : Comment décririez-vous le climat social et politique en Turquie à la suite des arrestations du 17 décembre dernier ?
Jean Marcou : Le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan semble avoir été pris par surprise par les arrestations du 17 décembre. Le cas des fils de trois ministres arrêtés a été particulièrement dommageable pour l’image de l’AKP. Rappelons-nous qu’en 2002, ce parti a été élu avec la promesse de mettre fin à la corruption en Turquie et en dénonçant les pratiques de ses adversaires politiques.
La réaction d’Erdoğan a été immédiate. Il a d’abord interdit à la police turque d’obéir aux juges. L’objectif, dans un premier temps, était d’éviter une deuxième vague d’arrestations. Son fils, Bilal Erdoğan, aurait pu être l’un des prochains suspects sur la liste. Le gouvernement a ensuite effectué une vaste opération d’épuration dans les services de police du pays. Au total, plus de 6 000 personnes ont été touchées par des réaffectations ou par des mises à pied. Cela est énorme. Même au moment des coups d’État, il n’y a jamais eu de telles épurations ! Erdoğan s’est finalement attaqué au système et, plus directement, aux procureurs responsables des arrestations du 17 décembre. Des centaines de magistrats ont été déplacés ou remplacés. Le gouvernement a également annoncé une grande réforme du pouvoir judiciaire et, surtout, du système policier. En dépit des protestations non seulement internes mais internationales (notamment de l’Union européenne), il a finalement fait adopter par le Parlement, le 15 février, une loi qui accroît le contrôle du pouvoir exécutif sur le Haut Conseil des juges et des procureurs qui gère la carrière des magistrats. Une grande partie des personnes arrêtées le 17 décembre ont par ailleurs été libérées par les nouveaux procureurs en charge de l’affaire.
Tout cela s’inscrit dans un contexte où l’intimidation des opposant·e·s, des contestataires et des journalistes s’accentue dans le pays. Cette tendance, qui a culminé avec les événements de Gezi à l’été 2013, se précise actuellement. Début février, le gouvernement a fait voter une loi visant à restreindre l’utilisation d’Internet. Cette loi comporte des mesures très préoccupantes, comme la possibilité pour l’autorité gouvernementale des télécommunications turques d’interdire certains sites, et ce, sans devoir passer par le pouvoir judiciaire. Ou encore la possibilité de compiler des données sur les sites fréquentés par les internautes turcs. À la suite des manifestations de Gezi, de nombreux journalistes qui avaient critiqué le gouvernement ont dû démissionner ou ont été congédiés. Parmi ceux-ci, plusieurs se sont tournés vers Internet. Ils utilisent les médias sociaux, où ils sont très actifs, et ils publient leurs articles sur différents sites. On peut également estimer que cette loi vise, une fois de plus, à intimider l’opposition. Cela est très préoccupant.
ÀB ! : Après s’être attaqué à la toute puissante armée turque, le premier ministre Erdoğan semble désormais viser les sympathisants de la confrérie de Fethullah Gülen, qui était pourtant son alliée il y a quelques années à peine. Comment en sommes-nous arrivés là ?
JM : Lorsqu’un parti domine totalement la scène politique au point qu’il n’y a plus d’enjeux capables d’impulser une alternance, la dynamique naturelle du conflit politique, puisqu’elle ne peut pas s’exprimer entre les partis, se déplace à l’intérieur du parti au pouvoir, voire à l’intérieur de l’État. C’est probablement ce qui est en train de se produire en Turquie depuis quelques années.
À partir de 2002, l’AKP a complètement dominé la scène politique, tandis que l’opposition s’est considérablement affaiblie. Les débats entre partis politiques ont eu tendance à perdre de l’importance et de l’intérêt. La confrontation s’est plutôt déplacée, dans un premier temps, entre l’AKP et l’État, c’est-à-dire en fait les structures-clés de l’État kémaliste traditionnel. Celles-ci se trouvaient alors dans l’armée, les hautes cours de justice, la diplomatie, les élites universitaires, formant alors ce qu’on appelait l’establishment laïque.
Entre 2007 et 2010, l’armée a perdu le contrôle du politique. Les élections présidentielles de 2007 l’ont considérablement affaiblie, car elle a échoué dans sa tentative d’empêcher l’AKP de prendre la présidence de la République. Depuis, elle est très largement en repli. La principale figure d’opposition à l’AKP s’étant ainsi effacée, les conflits se sont déplacés, dans un deuxième temps, vers la confrérie de Fethullah Gülen et ses sympathisants. Il semble que la vague d’arrestations du 17 décembre ait été orchestrée par cet influent prédicateur turc, qui vit aux États-Unis depuis 1999. Longtemps allié de l’AKP et responsable, en partie, de son succès électoral au cours des dernières années, Gülen est désormais en conflit ouvert avec Recep Tayyip Erdoğan. Or, les « Gülenistes » sont très présents dans les sphères du pouvoir turc, et particulièrement dans l’appareil judiciaire et policier.
La division entre les Gülenistes et le premier ministre a éclaté au grand jour l’automne dernier, et surtout après l’affaire du 17 décembre. Or, elle était latente depuis quelques années. Des dissensions sont apparues, entre autres, en 2012 lors d’un événement semblable au 17 décembre 2013. Un procureur lié à la confrérie a ordonné l’arrestation de hauts responsables des services de renseignement turcs qui étaient proches d’Erdoğan. Le premier ministre a réagi immédiatement en faisant voter une loi contraignant les procureurs à obtenir l’accord du gouvernement pour lancer des poursuites judiciaires concernant des membres des services de renseignement.
Les conflits avec les Gülenistes ont également entraîné des répercussions à l’intérieur même de l’AKP, particulièrement depuis les événements de Gezi. La gestion de cette crise par le premier ministre a provoqué de vives critiques, notamment de la part du vice-premier ministre, Bülent Arınç, et du président, Abdullah Gül. Ces deux figures importantes de la politique turque étaient réputées proches de Fethullah Gülen. Pour le moment, on parle surtout de différences de sensibilité, voire de dissidence, et non pas d’opposition frontale. Mais le conflit est latent à l’interne depuis plusieurs mois. Puis, au cours des derniers mois, neuf députés de l’AKP ont démissionné, déçus de la gestion du scandale du 17 décembre par le premier ministre. Jusqu’à ce jour, aucun événement n’avait causé autant de départs au sein du parti. Toutefois le cœur de l’appareil du parti ne semble pas être fragilisé, pour l’instant.
ÀB ! : Quelle importance doit-on accorder aux élections qui auront lieu en 2014 ?
JM : L’année 2014 est cruciale pour l’AKP et pour Recep Tayyip Erdoğan. En plus des élections locales du 30 mars, il y aura des élections présidentielles au mois d’août prochain. Ce sera la première fois que les élections présidentielles se dérouleront au suffrage universel. Depuis qu’elle est passée à la démocratie parlementaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie pratique un parlementarisme assez classique et comparable à celui de la plupart des pays européens, plus ou moins basé sur le système de Westminster. Le premier ministre gouverne avec la majorité au parlement, tandis que le président exerce une sorte de magistrature morale.
Erdoğan, qui achèvera théoriquement en 2015 son troisième et dernier mandat comme premier ministre (selon les statuts de son propre parti, qu’il a contestés récemment), compte se présenter à la présidence. S’il est élu, il ne serait pas étonnant de voir le système politique du pays se « présidentialiser » à la française. Ce type de transformation faisait d’ailleurs partie des plans d’Erdoğan et de l’AKP jusqu’à l’année dernière, lorsqu’ils ont tenté de réformer la Constitution turque pour y inclure des mesures allant dans ce sens, en se déclarant d’ailleurs pour un régime carrément présidentiel. Le projet a finalement été abandonné face au refus des partis d’opposition. On peut toutefois penser que l’élection d’août représente un élément central dans la stratégie de « présidentialisation » d’Erdoğan et de son parti.
ÀB ! : Qu’advient-il du mouvement de Gezi ?
JM : Les événements de Gezi ont vraiment secoué la Turquie. Ils représentaient une sorte de Mai 68 à la turque, qu’on ne peut comparer ni au printemps arabe, ni tout à fait au mouvement des indignés. Au cours des dernières années, la Turquie a connu une forte croissance économique. Bien sûr, il y a des jeunes au chômage, mais on n’est pas en récession comme dans certains pays européens. Dans ce contexte économique plutôt favorable, les contestataires ne voulaient pas tant la fin d’un régime que critiquer la politique menée par le gouvernement et son usage de la croissance. Ces contestataires avaient surtout l’impression que la croissance était mal utilisée. Entre la construction d’un troisième pont sur le Bosphore, celle d’un troisième aéroport à Istanbul, l’implantation de gigantesques hôtels ou de centres commerciaux de luxe, il y avait matière à critiquer. Au départ, ces grands projets ont émerveillé, mais peu à peu, les gens en ont vu la contrepartie : les problèmes environnementaux, les inquiétudes au sujet de l’approvisionnement en eau, la destruction du patrimoine, les atteintes au cadre de vie, etc.
Près d’un an après le soulèvement, on constate que le mouvement, même s’il ne s’est jamais complètement éteint, n’a pas repris significativement. Certes, il y a eu plusieurs actions citoyennes et des tentatives de reprise, voire des actions ponctuelles dans certains quartiers alévis d’Istanbul, mais nous n’avons pas assisté à une relance globale. Après le 17 décembre, il y a eu des manifestations de dénonciation de la corruption qui auraient pu laisser croire à un nouvel embrasement et provoquer de nouveau un choc dans la société turque. Or, ça n’a pas été le cas. Les responsables des manifestations de l’été 2013 ne sont pas parvenus à mobiliser sur la question de la corruption.
Il faut toutefois se rappeler que la répression des manifestations de Gezi a été très violente. L’intimidation continue présentement : plusieurs contestataires sont poursuivis en justice et des poursuites judiciaires sont toujours en cours. Pendant ce temps, les procès des responsables de la mort de deux manifestants, qui devaient avoir lieu à la mi-février, ont été reportés au mois de mai. Deux poids, deux mesures ? En quelque sorte, la stratégie d’intimidation d’Erdoğan pourrait avoir fonctionné. Mais pour combien de temps ? Ω