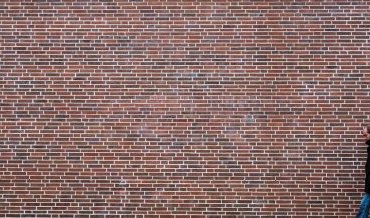Mini-dossier - La philanthropie : une fausse solution pour le communautaire
Le philanthro-capitalisme : l’extension du ruissellement
La théorie du trickle-down effect, ou ruissellement économique, prônée dans les années 1980 aux États-Unis puis dans de nombreux pays acquis au tournant néolibéral, soutient qu’un système économique et fiscal qui profite aux plus riches serait bénéfique pour tou·te·s, via la consommation et les investissements des premier·ère·s : les bons effets « ruisselleraient » jusqu’aux catégories sociales inférieures. Cette théorie a été largement battue en brèche, avec une hausse des inégalités marquée dans les dernières décennies [1]. Néanmoins, elle trouve encore un avatar parmi des fondations, via le philanthrocapitalisme, un courant très spécifique au sein du champ philanthropique.
Le terme de « philanthrocapitalisme » est apparu durant les années 2000 et il est fréquemment rattaché à l’ouvrage éponyme de Matthew Bishop et Michael Green, publié en 2008 [2]. Sous-titré « How the Rich Can Save the World » dans sa première édition, puis « How Giving Can Save the World » dans les éditions suivantes, il a suscité un fort engouement dans le milieu philanthropique, autant que des critiques. Il transpose dans le secteur social le discours, les pratiques et les instruments du monde des affaires.
En premier lieu, le philanthrocapitalisme repose sur l’engagement personnel d’entrepreneur·e·s à succès, qui utilisent le capital financier, le réseau social, la légitimité, voire le charisme, issus de leur carrière dans le secteur privé, pour devenir des leaders dans le domaine philanthropique. Le déploiement de la fondation qui porte leur nom met en scène la figure de l’entrepreneur visionnaire, prenant des risques afin de « régler un problème ». Qu’il s’agisse de l’itinérance, de la malnutrition ou d’une pandémie, ces problèmes sont présentés de manière dépolitisée, existant en soi et nécessitant une solution technique (incitatif économique, nouveau cultivar, nouveau vaccin, etc.).
En second lieu, le philanthrocapitalisme présente le don comme un « investissement social ». On entend par là des pratiques efficaces permettant de maximiser les répercussions sociales du capital investi. Stratégiquement, afin de pallier des problèmes de pauvreté ou de santé, on mise alors en amont sur la prévention ; c’est une manière de prévenir à la fois les problèmes et les dépenses à venir. Maximiser le capital investi, c’est aussi enrôler d’autres ressources, par exemple en suscitant des appariements financiers de la part du gouvernement ou d’autres bailleurs.
Enfin, ce transfert du modèle entrepreneurial vers la sphère sociale a des répercussions sur les modes d’action du philanthrocapitalisme. Tout d’abord, une ingénierie de l’accompagnement est déployée en direction des organismes financés, souvent via des consultant·e·s, afin « d’accroitre et de mesurer leur impact », « de produire une théorie du changement », « de réaliser un changement d’échelle ». De plus, la valorisation des mécanismes marchands conduit à ériger l’entrepreneuriat comme solution en soi (financement des « jeunes pousses » de l’entrepreneuriat social), à tarifer les activités et services, à contractualiser le soutien, voire à développer des partenariats avec des entreprises privées.
Si on retient cette définition intégrale du philanthrocapitalisme, il ne concerne qu’un nombre extrêmement limité de fondations au Canada. Au Québec, si la Fondation Lucie et André Chagnon s’inscrivait à ses débuts dans ce courant, elle s’en est détournée depuis. Néanmoins, dans un sens plus relâché, on peut dire que l’horizon philanthrocapitaliste inspire de nombreuses fondations, dans le transfert vers l’intervention sociale de discours et de pratiques managériales.
Trois ouvrages critiques sur le philanthrocapitalisme, avec un focus sur la Fondation Bill et Melinda Gates pour les deux premiers.
Linsey McGoey, No Such Thing as a Free Gift. The Gates Foundation and the Price of Philanthropy, Londres et New York, Verso, 2015, 304 p.
Lionel Astruc, L’art de la fausse générosité. La fondation Bill et Melinda Gates, Arles, Actes Sud, 2019, 128 p.
Anand Giridharadas, Winners Take All : The Elite Charade of Changing the World, New York, Knopf Doubleday, 2018, 304 p.
[1] Thomas Piketty, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 2019, 1197 p.
[2] Philanthrocapitalism : How the Rich Can Save the World, New York, Bloomsbury Press, 2008, 304 p.