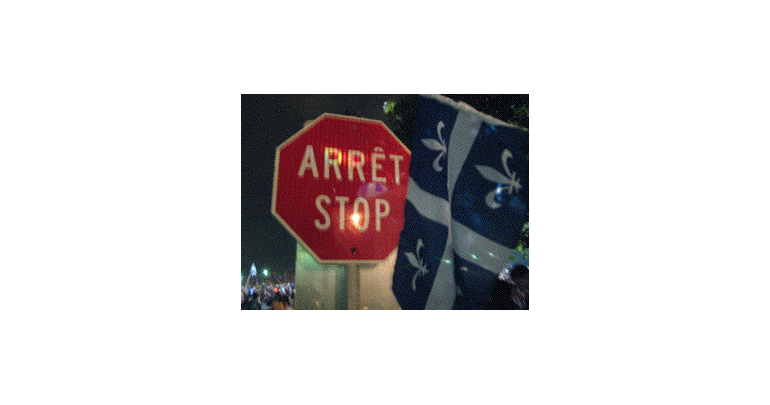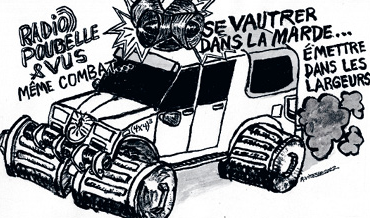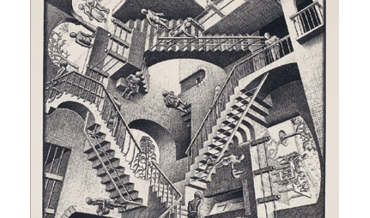L’indépendance - Laquelle ? Pour qui ?
Dissocier indépendance et nationalisme
La question de l’indépendance représente une contradiction irrésolue dans l’histoire de la communauté politique du Québec. Elle est intimement mêlée aux autres formes de domination, dont l’oppression capitaliste. Si elle a, jusqu’ici, fait partie de l’arsenal idéologique des classes dominantes et des élites nationalistes, cela ne veut pas pour autant dire que la gauche peut se permettre de l’escamoter. Peut-être faudrait-il en revenir à dissocier indépendance et nationalisme. Cela ne veut pas dire nier la réalité nationale, mais plutôt penser l’appartenance à une communauté politique concrète comme condition nécessaire de tout projet d’émancipation et d’autonomie politique [1].
De la libération nationale au Québec Inc.
Pour nombre d’indépendantistes, inspirés par Fanon ou Memmi, la lutte de libération nationale du Québec visait la fin d’une double opression, coloniale et capitaliste, des travailleurs et travailleuses du Québec. Pour la classe dirigeante, cependant, la « souveraineté » est vite devenue un slogan publicitaire nationaliste recouvrant la construction d’un capitalisme autonomiste francophone (donc toujours au sein du Canada) : le « Québec Inc. » L’idéologie corporatiste qui l’inspire nie l’existence de la lutte des classes et considère la société comme un corps organique, une « grande famille », et prône la concertation entre les différents acteurs de la société (État, syndicats, associations de métier, familles).
Le projet péquiste n’a plus grand-chose à voir avec la liberté ni avec la culture, et beaucoup plus à voir avec l’argent. Il n’y est plus question de rupture avec le Canada ou le capitalisme. Il s’agit plutôt de maintenir en existence une caste de gestionnaires technocrates francophones [2] s’insérant dans la hiérarchie économique afin d’administrer le monde tel-qu’il-est et « briller parmi les meilleurs » dans la course mondiale à la compétitivité économique (et fiscale) avec des « fiertés nationales » comme Bombardier et le Cirque du Soleil (sans oublier Guy Laliberté dans l’espace).
Ce détournement vers un nationalisme strictement économique a provoqué des rebuffades parfois loufoques. Mathieu Bock-Côté a déchiré sa chemise contre la « dénationalisation tranquille », imputée au PQ, tout en défendant des politiques de droite économique qui mettraient le Québec à la botte des puissances extérieures du capitalisme globalisé. Méchante indépendance ! Les franges « pures et dures » se sont repliées sur un nationalisme ethnique exclusif, souvent raciste, et qui consiste à défendre contre ce qui vient d’ailleurs une identité québécoise chosifiée et folklorisée. Un exemple navrant : Hérouxville (où l’on a interdit aux immigrants de « lapider leurs femmes »).
L’indépendance est-elle irrémédiablement national-bourgeoise ?
À partir d’un tel tableau, on serait tenté de penser que la seule position logique pour l’extrême-gauche s’apparenterait à celle des marxistes-léninistes des années 1970-1980 : dénoncer la mystification nationaliste de l’indépendance et proposer plutôt l’organisation de classe à l’échelle pancanadienne. Ce serait à mon sens répéter une erreur historique, en considérant que l’indépendance du Québec est irrémédiablement liée au nationalisme bourgeois.
Cette attitude tient en bonne partie au fait que la gauche a tendance à considérer que derrière le voile des illusions étatiques, nationales, culturelles et religieuses, se trouve le prolétaire individuel, délié et apatride, qu’il s’agirait ensuite d’organiser en « classe » sérielle sans trop d’égard aux conditions culturelles et institutionnelles spécifiques qui le constituent. Nous aurions donc, d’un côté, le corporatisme et la Nation comme illusion du « corps social » et, de l’autre, une série de producteurs éparpillés à regrouper.
Or il faudrait se garder, à gauche, de faire comme l’élite technocratique, qui ne considère les humains qu’en tant que facteurs de production qui ne seraient liés entre eux que par la logique des échanges marchands. Il faudrait se souvenir que les peuples existent encore (pour le moment) comme communautés de culture et d’expérience et que leur aspiration à l’autodétermination reste encore un rempart fondamental à opposer au tsunami capitaliste.
Peut-être, dans cette perspective, pouvons-nous dissocier indépendance et nationalisme bourgeois, ce qui ne veut pas dire ignorer la réalité nationale ni la défendre de manière xénophobe ou réifiée, mais plutôt de la dépasser pour défendre l’indépendance du Québec comme l’acte de naissance d’un lieu où pourraient s’enraciner la liberté et l’autonomie individuelle et collective.
La liberté ne pousse pas dans les airs
Le capitalisme, de plus en plus apatride et déterritorialisé, lamine sur son passage les communautés humaines, laissant derrière de chanceux-euses « citoyen-nes du monde » mobiles jet-set, et des hommes et femmes sans qualités enchaînées à leur machine dans le no-man’s-land de la valorisation capitaliste. Le projet capitaliste est clair : dissoudre les formes de socialité et de solidarité concrètes qui empêchent encore les individus d’être livrés comme « vie nue » à la puissance de l’appareil productif.
Or, certains marxismes et anarchismes (particulièrement l’anarchisme anticivilisationnel) s’emploient encore à dénoncer comme « abstraction » ce fait anthropologique pourtant élémentaire : nous sommes, en tant qu’individus, et qu’on le veuille ou non, toujours enracinés dans une communauté d’expérience, historique, culturelle-symbolique et politique qui nous a faits, de la même façon qu’un arbre ne pousse pas à six endroits en même temps.
L’anthropologue Claude Lévi-Strauss, interviewé le jour de son centenaire, s’inquiétait de ce que le Québec soit avalé dans une « culture moyenne nord-américaine » par le processus d’uniformisation capitaliste. Si le capital est fondamentalement apatride, il apparaît pour Lévi-Strauss qu’il faille lui opposer la riche diversité des modes d’être différents dont le foisonnement fait la beauté de l’humanité : « Alors que l’humanité se sent menacée d’uniformisation et de monotonie, elle reprend conscience de l’importance des valeurs différentielles. Nous devrions renoncer complètement à chercher à comprendre ce qu’est l’homme si nous ne reconnaissions pas que des centaines, des milliers de peuples ont inventé des façons originales et différentes d’être humains. Chacune nous apporte une expérience de la condition d’homme différente de la nôtre. Si nous n’essayons pas de la comprendre, nous ne pouvons pas nous comprendre. » Le Devoir, 28/11/08.
Plutôt que de penser la liberté comme la capacité de s’arracher à tout, bref, de se déraciner, George Orwell, « l’anarchiste-tory » ainsi qu’il aimait dire en clin d’oeil, pensait plutôt la liberté comme lien, comme attachement. Le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ni du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre. La liberté ne peut donc jamais être décrite indépendamment de ses formes d’inscription dans une communauté vivante.
Pour Orwell, les classes populaires et les communautés partagent toujours entre elles certaines façons de vivre la mise en partage du social, un « socialism of ordinary people », des valeurs, une « common decency » qui incarnent déjà, dans le monde non libre actuel, un possible à développer, un fragment de ce que devrait être une société postcapitaliste. Il ne défend donc pas une démocratie idéale qui surgirait d’en dehors du monde, mais la liberté potentielle telle qu’elle est présente, partiellement et en germe, dans le corps et la culture de n’importe quelle communauté susceptible de se donner à elle-même sa Loi en dépassant le conflit de classe.
Voilà pourquoi Orwell soutint la Grande-Bretagne contre le fascisme plutôt que de combattre simultanément les deux au nom d’un idéal abstrait : « La démocratie qu’il faut apprendre à protéger n’est pas cette coquille abstraite dont l’Idéologie peut toujours ronger entièrement l’intérieur (pour en faire au besoin une démocratie “véritable” ou “populaire”). C’est la démocratie empirique et sensible, incarnée sous nos yeux dans une nation donnée, qu’il convient donc de savoir reconnaître “y compris sous sa forme anglaise très imparfaite”. »
L’indépendance par-delà le national-péquisme
Le Québec est, il va sans dire, un lieu plus qu’imparfait, mais nous n’habitons pas ailleurs. Ce n’est qu’à partir de lui-même que nous pourrons le libérer, c’est-à-dire si l’on finit par reconnaître que les classes populaires québécoises ont quelque chose qui les différencie en propre : une façon d’être, qui ne tient pas de quelque biogénétique stupide mais d’un héritage symbolique, d’une expérience et d’une condition partagées. En ce sens, elles sont effectivement, à la fois dans une condition identitique ET particulière vis-à-vis des autres peuples, ce qui oblige à penser le particulier et l’universel en même temps.
La communauté du Québec devrait s’accorder le droit de Cité, surtout si les exploitées doivent enfin devenir, généreusement, partout chez eux et elles, les auteures de leur histoire. Refuser le nationalisme bourgeois, voire même l’idée de « Nation », n’implique pas que l’on puisse du même souffle faire sauter l’appartenance à une communauté de culture, qui est l’un des traits fondamentaux de l’humanitude. On peut bien apprendre l’esperanto, mais il me semble plus porteur de se réconcilier avec l’idée que l’on ne naît pas dans une feuille de chou, et que l’indépendance peut être autre chose que le projet d’une clique nationaliste-technocratique médiocre vendue ou raciste : le début d’une liberté bien chez elle et généreuse pour le monde, débarrassée du national-péquisme qui, lui, confond liberté et liberté de commerce et, trop souvent, culture avec identité « pure laine ».
Nous sommes peut-être arrivés à ce dépassement du nationalisme dont parlait Pierre Bourgault en 1970 : « D’une génération à l’autre, de projet en projet en projet, nous réussirons bien un jour à faire des hommes libres quelque part dans le monde. Nous travaillons aujourd’hui à assumer notre nationalisme, mais il nous faudra bientôt le dépasser. C’est maintenant le temps des drapeaux et des marches triomphantes, mais il nous faudra demain avoir le courage d’aller plus loin ! Je rêve que le Québec, libre enfin, devienne le premier pays du monde à n’avoir ni drapeau, ni hymne national. Je rêve de voir notre seule liberté nous servir d’étendard et notre seule fraternité nous servir d’identification pour le genre humain. » Et si, franchissant les frontières du Québec, on trouvait avant toute chose ce panneau : « Salut à toi, camarade » ?
[1] Je tiens à me distancer d’emblée du national-anarchisme caractérisé par son anti-modernisme (et son séparatisme racial !). Si le commun n’est pas pour moi une abstraction à abattre, mais un lien social constitutif de la liberté de tout individu singulier, je n’en fais pas une défense sur une base ethniciste ou raciale, mais d’un point de vue culturel-symbolique, politique et autarcique. En ce sens je suis plus proche de L’Archie (http://larchie.net/) que de l’anarcho-individualisme d’un côté ou de l’anarchisme-identitaire de l’autre.
[2] Voir Simon Tremblay-Pépin, « Intellectuels et classes sociales », Les nouveaux cahiers du socialisme, no 1, hiver 2009.