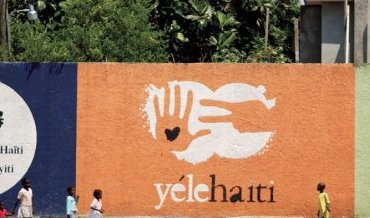Chávez, Uribe, Sarkozy et les otages colombiens
par Maurice Lemoine
« On ne peut m’interdire de parler avec Hugo Chávez sous prétexte qu’il a un problème avec les États-Unis ! » Ainsi s’exprimait le président français Nicolas Sarkozy [1], quelques semaines avant de recevoir, le 20 novembre, son homologue vénézuélien, bête noire de l’administration Bush. Au cœur de leurs conversations figurera la libération d’Ingrid Betancourt, franco-colombienne (d’où l’intérêt du chef de l’État français) détenue par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) depuis 2002. Concernant cette affaire, et plutôt que de supputer à l’infini sur les possibilités de réussite, les faits qu’il convient de connaître sont relativement simples et peu nombreux.
À la fin des années 1990, dans le cadre d’un conflit armé vieux de plusieurs décennies, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) infligent de retentissantes défaites aux troupes du gouvernement colombien (Las Delicias, 1996 ; Cerro de Patascoy, décembre 1997) ; au cours de ces batailles, et de quelques autres, elles font de nombreux prisonniers.
Le 28 juin 2001, les FARC libèrent unilatéralement 242 soldats et policiers à La Macarena (Meta), ne gardant que les officiers. Insensible à la démarche, le pouvoir ne relâche aucun des guérilleros détenus dans ses prisons. Ulcérés, les comandantes des FARC avertissent : ils vont séquestrer des membres de la classe politique jugés « aussi scandaleusement indifférents au drame de la guerre vécue par le peuple qu’au sort des soldats combattant dans les rangs de l’armée ». Leur menace devient réalité quand de nombreux députés, sénateurs, gouverneurs, ex-ministres sont enlevés.
C’est dans ce contexte que, le 23 février 2002 (et dans des circonstances fortuites), est séquestrée Ingrid Betancourt. Députée, puis sénatrice mal vue d’une classe politique colombienne à laquelle elle ne ménage pas ses critiques, elle est, en cette année 2002, candidate à la présidence de la République.
Élu chef de l’État (53 % des voix et 52 % d’abstentions), Alvaro Uribe Vélez prend ses fonctions, le 7 août 2002. Sa politique de « sécurité démocratique », avec comme bras militaire le Plan patriote, destiné à écraser les rebelles, marque une escalade dans la confrontation.
Un échange humanitaire
Entre temps, en septembre 2001, les FARC – et l’Armée de libération nationale (ELN) – ont été inscrites par Washington sur sa liste des organisations terroristes. L’Union européenne leur fera subir le même sort peu de temps après. Uribe confirme à sa manière : il n’y a, en Colombie, ni guerre civile ni conflit armé, mais une « menace terroriste ».
Quoi qu’on pense des méthodes employées par les FARC, cette fiction ne peut occulter la réalité. Si l’on s’en tient à la définition du protocole II additionnel aux quatre conventions de Genève [2], la Colombie vit « un conflit armé interne, sans caractère international ; un conflit où s’affrontent les forces armées de l’État avec d’autres forces, également armées, identifiables, qui s’opposent à l’État, sont vêtues d’uniformes reconnus, portent ouvertement les armes, dépendent d’un commandement et sont, ou ont été à un moment, reconnues comme telles par l’État ». En témoignent les conversations de paix menées en 1984 par le gouvernement de Belisario Betancur, puis celles qui ont eu lieu, du 7 novembre 1998 au 20 février 2002, sous l’égide du président Andrés Pastrana.
Refusant avec vigueur d’être considérées comme une organisation terroriste, les FARC font de leurs 56 « prisonniers politiques » une arme stratégique. Elles réclament une négociation débouchant sur un « échange humanitaire » qui permettra de les relâcher (contre 450 à 500 guérilleros condamnés à de lourdes peines de prison [3]). Plus politique qu’humanitaire, là se trouve le cœur du problème : en obligeant le gouvernement à s’asseoir avec elles autour d’une table, les FARC entendent récupérer, de facto, un statut de belligérant.
Pour des raisons de sécurité, les rebelles exigent par ailleurs qu’une telle négociation ait lieu dans une zone démilitarisée, dans les municipios de Pradera et Florida (800 km2, dans le département du Valle del Cauca). En mai 2003, ils font connaître les noms de trois guérilleros officiellement chargés de cet échange humanitaire. Avec l’aide des services secrets américains et colombiens, l’un d’entre eux, Simón Trinidad, sera capturé par la police équatorienne en janvier 2004, à Quito (Équateur), transféré en Colombie puis extradé aux États-Unis. Le président Uribe sait très bien, à ce moment, que livrer Trinidad à Washington compliquera sérieusement une éventuelle négociation. Peu lui chaut. Au contraire. Cet échange humanitaire, il n’en veut pas. Il préfère de spectaculaires opérations de sauvetage militaires des otages, qui n’ont qu’un inconvénient, moult fois dénoncé par les familles de ces derniers : elles sont exagérément risquées pour ceux qu’on prétend délivrer [4].
Divers facteurs troubles
On en resterait là si n’intervenaient soudain divers facteurs, apparemment sans lien les uns avec les autres, qui vont faire évoluer la situation. À Paris, à quelques jours d’élections législatives dont il espère une majorité écrasante, l’hyperactif Nicolas Sarkozy sait une chose : s’il est une cause populaire en France, c’est bien la libération d’Ingrid Betancourt. Il en fait « une priorité » et, médiatisant largement son action, entre en communication avec le chef d’État colombien.
À Bogotá, ce dernier se trouve dans une situation délicate. Il était déjà fortement critiqué pour les « négociations de paix » ayant permis, dans une quasi-impunité, la démobilisation de 31 000 paramilitaires responsables de déplacements forcés, d’assassinats sélectifs ou de massacres collectifs d’opposants, de crimes contre l’humanité. Depuis quelque temps, le scandale dit de « la parapolitique » l’éclabousse largement. Examinant plus de cent cas de collusion présumée entre paramilitaires et représentants de l’État, la justice colombienne met au jour les fraudes organisées par les uns et les autres lors des élections qui l’ont porté au pouvoir.
L’initiative de Sarkozy offre à Uribe l’occasion de redorer son blason, de donner des gages – y compris à certains secteurs démocrates aux États-Unis – en exhumant le thème de l’échange humanitaire (réclamé par une majorité de Colombiens). Le 11 mai, il annonce la libération « unilatérale » de centaines de rebelles et demande aux FARC de répondre à ce « geste de bonne volonté » en procédant à la libération de leurs otages. Parmi les guérilleros relâchés « à la demande du président Sarkozy », figure le comandante Rodrigo Granda. Considéré comme le ministre des Affaires étrangères des FARC, il a été enlevé fin 2004 à Caracas, rapatrié clandestinement en Colombie, puis condamné à 21 ans d’incarcération pour « terrorisme et rébellion ». Libéré (contre son gré !), et avant de s’envoler, le 19 juin, pour La Havane, Granda avertit ses interlocuteurs, qui ont « oublié » la négociation demandée par les FARC : « Il s’agit d’un geste unilatéral, je vous préviens, il n’entraînera aucune réciprocité. » [5]
Dans le même temps ou presque, le 23 juin, la Colombie se réveille en plein scénario catastrophe : dans un communiqué, le Bloc occidental des FARC annonce que 11 des 12 députés de l’Assemblée départementale du Valle del Cauca, enlevés le 11 avril 2002 à Cali, ont été tués, le 18 juin, « dans des tirs croisés », « quand un groupe militaire jusqu’à présent non identifié a attaqué le campement où ils se trouvaient ». Niant qu’il y ait eu des combats ce jour-là dans cette zone, Uribe accuse : « Il n’y a pas eu d’opération de sauvetage. Ils ont été froidement assassinés. » [6] D’informations en recoupements, on apprendra ultérieurement que l’affrontement « qui n’existe pas » a eu lieu, effectivement le 18, entre les FARC et un « Comando Jungla » de l’armée colombienne, sur le río Cajambre (Valle del Cauca) – la question demeurant posée de la participation de spécialistes étrangers (agents de la CIA, mercenaires anglais et/ou israéliens).
Les FARC remettent les corps des députés à la Croix rouge internationale. Par la voix du médecin canadien James Young, une commission d’experts nommée par l’Organisation des États américains (OEA) conclut : « Ils sont morts de multiples blessures par balles. » Les cadavres présentent des impacts dans l’abdomen, la poitrine, les jambes et les bras. Deux d’entre eux ont des balles dans la tête. Mais d’importantes questions demeurent en suspens : les tirs provenaient-ils de différents types d’armes ? À quelle distance ont-ils eu lieu ? En clair, il n’est pas encore prouvé que les prisonniers aient été exécutés par les guérilleros comme le prétend le gouvernement.
Médiation de Chávez
Au-delà de la tragédie humaine provoquée par cette opération intempestive, le gouvernement colombien a perdu son pari : prendre la guérilla en tenaille entre, d’une part, la libération unilatérale de guérilleros et, d’autre part, une opération militaire récupérant des otages et démontrant l’inutilité d’un échange humanitaire. Uribe tente bien de capitaliser l’émotion provoquée par la mort des 11 députés, il n’y parvient pas. Marleny Orjuela, présidente d’Asfamipaz, organisation regroupant les familles de policiers et militaires prisonniers de la guérilla, réclame à la communauté internationale « qu’elle impose l’échange humanitaire ». Par l’intermédiaire du Quai d’Orsay, la France déclare : « L’usage de la force pour libérer les otages doit être absolument proscrit. » Il devient difficile au pouvoir colombien de faire obstacle aux voix qui s’élèvent du pays et de l’étranger.
Vigoureuse représentante de l’opposition colombienne, la sénatrice Piedad Córdoba est la première à solliciter Hugo Chávez, le chef d’État du pays voisin. Même si, se réclamant d’une révolution démocratique, celui-ci a toujours marqué ses distances à l’égard de la guérilla colombienne, dont il réprouve la violence, la parenté politique entre ses objectifs de transformation sociale au Venezuela et les revendications des FARC en Colombie, est difficilement contestable. Le 5 août, déclarant « je ne peux pas refuser d’essayer de faire quelque chose », Chávez accepte le rôle de médiateur qu’on lui demande d’endosser. Le 20 août, il reçoit à Caracas des membres des familles des otages, dont la mère d’Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio. Les relations n’étant guère au beau fixe avec Bogotá, principal allié de Washington dans la région, Chávez envoie un spectaculaire signal de bonne volonté : il fait amnistier les paramilitaires colombiens arrêtés dans la banlieue de Caracas en mai 2004 [7] . Puis il se rend dans la capitale voisine où, le 31 août, il converse avec Uribe. Qui lui donne le feu vert pour négocier.
Commandant en chef des FARC, âgé de 77 ans, Manuel Marulanda – dit « Tirofijo » (Tire juste) –, dans le maquis depuis 1948, est une légende en Amérique latine. Dans son émission dominicale « Alo Presidente ! », Chávez annonce qu’il lui envoie une missive et qu’il espère pouvoir rapidement parler avec lui « person to person ». Marulanda ayant répondu par courrier qu’il ne pourra se rendre à Miraflores (le Palais présidentiel vénézuélien) dans l’immédiat, « pour des raisons de sécurité », Chavez se dit prêt à aller le rencontrer… au fond de la jungle colombienne. Ce à quoi s’oppose Uribe, manifestement agacé.
Dans une cassette vidéo remise le 14 septembre à Piedad Córdoba, Raúl Reyes, porte-parole des FARC, propose de rencontrer Chávez à Caracas, le 8 octobre, quarantième anniversaire de la mort de Che Guevara. La conversation préparera un futur rendez-vous avec Marulanda. Si la rencontre n’a finalement pas lieu à cette date symbolique, toujours pour des raisons de sécurité, elle demeure à l’agenda.
Les FARC détiennent à l’heure actuelle 45 hommes et femmes à échanger [8] contre environ 500 de leurs combattants, plus deux guérilleros extradés aux États-Unis, Simon Trinidad et Sonia. Rien ne dit Washington prêt à faciliter la tâche de Chávez et à céder aux revendications des révolutionnaires colombiens. Toutefois, les FARC disposent d’une monnaie d’échange susceptible d’assouplir l’administration Bush : Thomas Howes, Keith Stansell et Marc Gonçalvez. Employés de Microwave Systems – entreprise californienne sous-traitante du Pentagone –, ils sont tombés aux mains des rebelles lors du crash de leur avion d’espionnage Cessna 208, appartenant au gouvernement des États-Unis, le 12 février 2003, à Santana de las Hermosas (Caqueta). Chávez a déjà reçu leurs familles.
* * *
À la veille du voyage de Chávez à Paris, l’opinion s’interroge. Le président vénézuélien parviendra-t-il à mener à bien cette délicate mission ? Ou lui a-t-on tendu un piège ? Rien ne dit en effet qu’Alvaro Uribe souhaite sa réussite. Tout en l’autorisant à intercéder, il a précisé, lors de leur conférence de presse commune, à Bogotá, qu’il ne bougerait en aucun cas sur deux points : la reconnaissance des FARC comme force belligérante et la démilitarisation de deux municipios pour négocier. Précisément ce que réclame l’opposition armée. Dès lors, que reste-t-il à négocier ?
Un échec de Chávez, le « perturbateur continental », ne serait sans doute pas pour déplaire, tant à Washington qu’à Bogotá. Cela écornerait son image de président de gauche étendant son influence et à qui, jusqu’à présent, tout réussit. Un succès ne lui vaudrait pas non plus des compliments unanimes : combien de fois ne l’a-t-on accusé d’entretenir des relations privilégiées avec les « narcoterroristes » des FARC ? Un accord avec le groupe armé permettrait de renforcer cette accusation. Il indisposerait par ailleurs la cohorte politicomédiatique haineusement hostile à sa révolution bolivarienne. Signataire, en 1985, d’un appel au Congrès américain pour qu’il reconduise l’aide à la Contra nicaraguayenne [9], le « philosophe » Bernard Henri Lévy persiste et donne le ton – « Non moins absurde, navrant et, pour tout dire, désastreux serait de le voir [Chávez] acquérir, en la circonstance, l’aura et la respectabilité internationales dont ses prises de position l’avaient, jusqu’à présent, légitimement privé » – avant de dénoncer « ce mixte de péronisme, de castrisme et, parfois, de quasi-fascisme qu’est en train de devenir son régime » [10].
Toutefois, et là demeure le plus important, la médiation de Chávez a donné un souffle nouveau aux défenseurs de l’échange humanitaire. L’Amérique latine étant beaucoup moins sensible qu’en d’autres temps aux sirènes de l’Empire et de ses relais, les présidents Lula (Brésil) [11], Daniel Ortega (Nicaragua), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur) ont manifesté leur soutien à leur homologue vénézuélien. Tout comme l’ensemble du Marché commun du Sud (Mercosur), puis les 112 pays non alignés. Certes, tous ne sont pas dénués d’arrière-pensées. En cas de réussite, tout le monde veut figurer sur la photo. Et en tirer bénéfice (particulièrement Nicolas Sarkozy). Mais somme toute, l’objectif recherché vaut qu’on ne s’attarde pas trop sur ces détails secondaires.
Sabotage d’Uribe
Reste que, tout en « appuyant » la médiation, les autorités colombiennes donnent de plus en plus l’impression qu’elles font tout pour la saboter. Elles continuent à souligner qu’elles ne peuvent exclure un recours à la force pour libérer les otages. Par ailleurs, si la fameuse réunion du 8 octobre a dû être annulée c’est que, refusant de leur accorder un quelconque sauf-conduit, le ministre de la Défense colombien déclara quelques heures auparavant que les émissaires de la guérilla se déplaçant de Colombie au Venezuela le feraient à leurs risques et périls et que l’armée colombienne continuerait à tenter de les capturer. Au même moment, Uribe faisait savoir que son gouvernement n’est pas disposé à accepter l’inclusion dans un quelconque échange humanitaire des deux guérilleros extradés aux États-Unis, Sonia et Simón Trinidad. Le comble de l’absurde (ou de la duplicité ?) sera atteint le 8 novembre lorsque le président colombien mettra en cause Hugo Chávez qui, la veille, avait rencontré une délégation des FARC emmenée par Iván Márquez, l’un de ses principaux comandantes.
Pour leur part, sans ou avec Chávez, les FARC n’ont nullement renoncé à une « négociation » en tête à tête avec le pouvoir destinée à les relégitimer. Seul élément nouveau, peut-être, en faveur d’une issue positive... « J’ai du mal à croire que le président Sarkozy ait demandé la libération d’un “terroriste”, nous déclarait Rodrigo Granda, à La Havane, en juillet dernier. Quant à Uribe, avec le décret qu’il signe pour me relâcher, il reconnaît le caractère politique des FARC. » Pour les insurgés, qu’Iván Márquez hier, Raúl Reyes et/ou Manuel Marulanda demain soient reçus par Hugo Chávez, avec l’assentiment de nombreux présidents en exercice, redonne un statut international à la guérilla. Ce qui est précisément l’objectif recherché par l’« accord humanitaire ». Bref, que Bogotá s’y oppose ou non, celui-ci est peut-être plus proche qu’il ne l’a jamais été. Ce qui n’implique pas que cet épineux problème se règlera en quelques jours. L’une des premières étapes pourrait être la remise au président vénézuélien par les FARC de preuves qu’Ingrid Betancourt et les autres otages sont en vie, ce qui ne fait guère de doute, mais aurait le mérite d’être confirmé.
[1] Le Monde, 25 septembre 2007.
[2] Ratifié par Bogotá le 18 mai 1995.
[3] Alors que la peine maximum est limitée par la loi à 40 ans, de nombreux rebelles sont condamnés à 60 ou 80 ans de détention.
[4] Le gouverneur du département d’Antioquia, Guillermo Gaviria, l’ancien ministre de la défense Gilberto Echeverri, et huit militaires sont morts, sans doute exécutés par les guérilleros qui les gardaient, lorsque, le 5 mai 2003, un commando s’approcha de l’endroit où ils étaient détenus. Dans des circonstances similaires, l’ex-ministre de la culture Consuelo Araujo Noguera a également perdu la vie.
[5] Ironie de l’histoire, l’homme « qui doit sa liberté » à l’agitation perpétuelle du président français a, depuis, rejoint la Colombie et ses camarades des FARC ! Il fait désormais partie de la délégation chargée des conversations avec Caracas.
[6] El País, Madrid, 29 juin 2007.
[7] Ces 88 paramilitaires s’entraînaient dans la finca « Daktari », propriété du cubain anticastriste Roberto Alonso, idéologue de l’« opération guarimba » de déstabilisation. Portant l’uniforme de l’armée vénézuélienne, ils devaient simuler un soulèvement militaire et provoquer le chaos.
[8] Deux de leurs otages se sont échappés entre janvier et mars 2007. L’un est l’actuel ministre des Affaires étrangères, Fernando Araujo, l’autre le policier John Frank Pinchao.
[9] Le Monde, Paris, 21 mars 1985.
[10] Le Point, Paris, 6 septembre 2007.
[11] Le 20 septembre, à Manaos, Lula a offert le territoire brésilien pour la rencontre entre Chávez et les FARC.