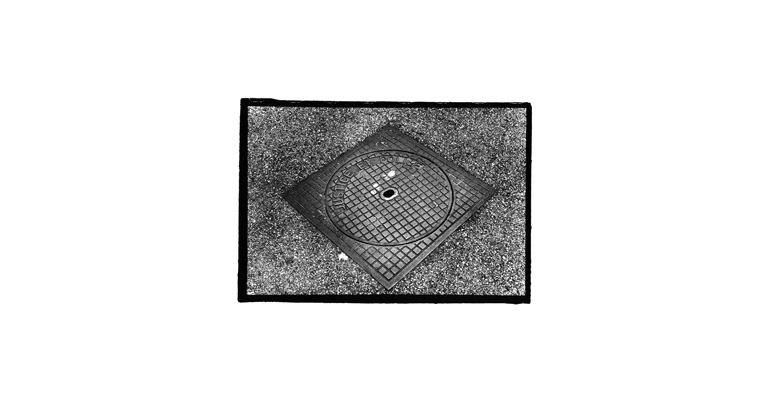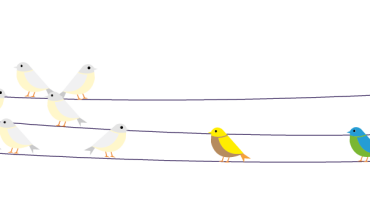Syndicalisme
Le détestable arrêt Fraser
Droit d’association des travailleurs agricoles
Législateurs et juges font malheureusement trop souvent peu de cas des travailleurs agricoles. Pour preuve, le refus de les entendre par le biais de la vidéoconférence sans prise en compte de leurs conditions matérielles (comme le retour – obligatoire – au pays après la fin de leur contrat de travail), la lenteur du système à lutter contre les conditions inhumaines et racistes dans lesquelles ils sont parfois contraints de travailler et de vivre, l’existence de plusieurs législations fédérales et provinciales leur octroyant ou retirant certains droits collectifs du travail, et ce, pour des raisons obscures, en réaction ou non à des décisions de justice. Si la justification de chaque avancée ou recul en matière de liberté d’association des travailleurs agricoles est souvent faible, l’analyse du mouvement dans son ensemble conduit à sérieusement douter de l’impartialité du traitement réservé à ces travailleurs et, plus largement, de celui offert à la liberté d’association reconnue par la Constitution. Le cas du régime des relations collectives de travail ontarien est édifiant.
Un pas en avant, trois pas en arrière
Dès l’institution du régime général des relations collectives de travail ontarien (1943), les travailleurs agricoles en sont exclus.
Il faut attendre un demi-siècle pour voir le gouvernement ontarien favoriser la syndicalisation et la négociation collective des travailleurs agricoles. En effet, la Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture leur garantit le droit de s’associer et de négocier collectivement leurs conditions de travail. En d’autres termes, elle protège la représentation démocratique, la protection des pratiques de travail, l’obligation de négocier de bonne foi et le droit de soumettre des griefs à l’arbitrage. Dans un autre ordre d’idées, elle substitue au droit de grève et de lock-out le choix de propositions finales pour résoudre les différends dans le cadre de la négociation collective. Peu de temps après l’adoption de cette loi, l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce [TUAC] voit le jour et est accréditée pour représenter quelque 200 travailleurs de la champignonnière Highline Produce Ld. et elle présente deux demandes d’accréditation visant les travailleurs de Kingsville Mushroom Farm Inc. et ceux de Fleming Chicks.
Toutefois, cette avancée est de courte durée, puisque la Loi de 1994 disparaît en 1995 dans le cadre de la « révolution du bon sens » de Harris ; les nouvelles dispositions prescrivent la dissolution des syndicats agricoles et excluent de leur champ d’application, c’est-à-dire de la protection légale contre les pratiques déloyales de travail, les personnes travaillant dans l’agriculture (Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi et Loi de 1995 sur les relations de travail).
Les travailleurs agricoles attaquent en justice ces nouvelles dispositions en invoquant la Loi constitutionnelle (Charte canadienne des droits et libertés, 1982), qui offre une protection extraordinaire à la liberté d’association. En 2001, la Cour suprême finit par rendre le jugement Dunmore affirmant que la liberté d’association perd tout son sens en l’absence d’une obligation de l’État de prendre des mesures positives pour que ce droit ne soit pas un droit fictif. En l’occurrence, le gouvernement ontarien doit fournir aux travailleurs agricoles une protection légale contre les pratiques déloyales de travail.
En réaction au jugement Dunmore, le gouvernement ontarien crée un régime de relations de travail particulier réservé aux travailleurs agricoles (Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles). Mais les droits ainsi obtenus sont limités, voire quelque peu fictifs : le droit de former une association et d’y adhérer, de participer à ses activités, de se réunir, de présenter à l’employeur, par l’entremise de leur association, des observations relatives à leurs conditions d’emploi et d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination. Quant à l’employeur, il doit donner à l’association syndicale l’occasion de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi et est tenu de les écouter ou de les lire.
Insatisfaits de ces nouvelles dispositions, les travailleurs agricoles ne tardent pas à en contester la validité constitutionnelle. Dans un premier temps, leur action judiciaire ne leur donne pas gain de cause, puisqu’en 2006, la Cour supérieure de justice de l’Ontario affirme le caractère constitutionnel du régime particulier instauré en 2002. Dans un deuxième temps, la Cour d’appel de l’Ontario accède, en 2008, à leur demande en ordonnant au gouvernement de leur accorder une protection suffisante pour qu’ils puissent exercer leur droit de négociation collective. Dans un troisième temps, les travailleurs agricoles subissent un terrible revers, dans la mesure où, en 2011 (arrêt Fraser), la Cour suprême du Canada donne tort à la Cour d’appel et décide que le régime particulier de 2002 est parfaitement respectueux de la Constitution.
Arguments hypocrites
La ligne jurisprudentielle de la Cour suprême du Canada est difficile à suivre.
En 2007, dans une affaire ne concernant pas les travailleurs agricoles, mais les employés du secteur de la santé (Colombie-Britannique), cette Cour reconnaissait – après avoir porté des œillères pendant 20 ans – le fait que la protection constitutionnelle reconnue à la liberté d’association depuis 1982 rejaillit sur le droit à la négociation collective (affaire Health Services and Support, 2007). Jusqu’alors, elle affirmait en effet que si la liberté d’association était protégée par la Constitution, les moyens de l’exercer ne l’étaient pas (affaire Public Service Employee Relations Act, 1987). La raison d’être d’une organisation syndicale étant la négociation collective des conditions de travail de ses membres, il aurait été idiot de reconnaître le droit de vivre sans celui de respirer. En 2007, en reconnaissant le fait que le droit des travailleurs de négocier collectivement est inhérent à leur liberté d’association, la Cour réaffirme les valeurs de dignité, d’autonomie de la personne, d’égalité et de démocratie, intrinsèques à la Charte. Depuis lors, la plupart des spécialistes se réjouissaient de cet élan de clairvoyance, tant attendu, et s’attendaient à ce qu’à la première occasion la Cour suprême fasse preuve de logique et adopte le même raisonnement au sujet du droit de grève, autre moyen d’exercer la liberté d’association, qui n’a pas encore fait l’objet d’un appel en si haut lieu.
Il convient de souligner qu’en 2008 la Cour d’appel de l’Ontario s’appuyait d’ailleurs sur les décisions de la Cour suprême de 2001 (affaire Dunmore) et de 2007 (affaire Health Services and Support) pour donner raison aux travailleurs agricoles. En effet, elle affirmait que le régime particulier de 2002 rend impossible l’exercice véritable du droit de négocier, protégé dans la Charte, compte tenu de l’absence de garantie comme l’obligation de négocier de bonne foi, la reconnaissance des principes du monopole syndical et du vote majoritaire ou encore un mécanisme permettant de dénouer l’impasse des négociations et de résoudre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective. À quoi bon prévoir un droit à la négociation collective si les parties ne sont pas contraintes d’agir de bonne foi ? Cela ne signifie pas l’obligation d’aboutir à la signature d’une convention collective, mais celle de faire tout effort raisonnable dans ce sens. Des critères jurisprudentiels clairs encadrent d’ailleurs cette obligation.
En 2011, la Cour suprême du Canada (arrêt Fraser) fait preuve, à une écrasante majorité de huit voix contre une, d’un manque flagrant de logique, ou pis d’une incroyable bêtise, lorsqu’elle affirme que la protection constitutionnelle de la liberté d’association s’étend uniquement au droit des travailleurs agricoles de former une association et d’y adhérer, de participer à ses activités, de se réunir, de présenter à l’employeur par l’entremise de leur association des observations relatives à leurs conditions d’emploi et d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination. Le droit de s’associer… dans quel but, déjà ? Négocier les conditions de travail… Ce formidable pouvoir rappelle les doléances, déclarations et autres pétitions auxquelles avait recours notamment le Tiers-État sous la Révolution française. La Cour suprême a l’outrecuidance de préciser, sans gêne, son propos : le régime particulier ontarien n’exige pas expressément de l’employeur qu’il examine de bonne foi les revendications de ses employés ; toutefois, l’obligation lui en est faite implicitement. Bien sûr… Pis, elle prétend que rien ne permet de démontrer dans cette affaire Fraser que le régime repose sur des stéréotypes inéquitables, perpétue des préjugés ou des désavantages existants ou défavorise indûment les travailleurs agricoles.
Force est de constater que la Cour suprême du Canada a regretté son élan impartial et juste de 2007 et saisi l’occasion de bafouer sa propre ligne jurisprudentielle. Si elle affirme ne pas pouvoir écarter son arrêt de 2007 (affaire Health Services and Support), c’est pourtant ce qu’elle fait en pratique. En effet, elle est en accord avec le fait que la négociation collective est un droit protégé par la Constitution, tout en affirmant qu’il est constitutionnellement acceptable de se contenter d’un régime particulier qui se résume au droit de former une association et de présenter à l’employeur des observations relatives aux conditions d’emploi, sans imposer une quelconque obligation de bonne foi lors de la négociation. Ledit régime particulier est réservé aux travailleurs agricoles, dont une grande partie sont des migrants…
Saluons la dissidence de la juge Abela, la seule juge sur neuf à avoir fait preuve d’un certain bon sens et d’une certaine honnêteté. Dans la foulée du jugement Fraser, deux juges de la Cour suprême ont annoncé leur départ l’un pour raisons familiales, l’autre pour raisons personnelles. Il aurait été préférable que cela soit pour incompatibilité idéologique.