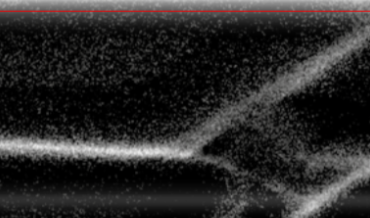Dossier : Les classes dominantes au Québec
Le pouvoir des technocraties
Les coordonnateurs
Historiquement, on a surtout compris les classes dominantes grâce aux rapports de propriété. Selon les schèmes classiques, ceux qui possèdent les outils ayant la capacité de produire des marchandises (les capitalistes) ont la main haute sur ceux qui n’ont pour propriété que leur force de travail, qu’ils doivent offrir en échange d’un salaire leur assurant subsistance (les travailleurs et travailleuses). Dans cette configuration à deux pôles, les intérêts économiques des uns sont opposés à ceux des autres.
La diversification des formes du Capital
Or, plus le vingtième siècle avance, plus les modes de propriété se transforment. L’élargis-sement de la propriété par actionnariat croît largement avant la moitié du siècle. Bien sûr, il demeure des petites entreprises possédées par des propriétaires privés, il reste également des grandes familles à la tête d’empires corporatifs, mais une vaste partie des grandes entreprises deviennent des sociétés par action. La gestion courante de l’entreprise, son contrôle effectif, tend alors à se dissocier progressivement de la propriété de cette dernière. De plus, comme les organisations se complexifient, des savoirs techniques de plus en plus nombreux sont nécessaires pour en coordonner les opérations. Ce ne sont plus les actionnaires, les propriétaires légaux des moyens de production, qui vont aller dire quoi faire à telle employée ou qui vont décider du fonctionnement interne de telle division. Un type nouveau de salarié-es joue ce rôle : les dirigeantes d’entreprises, qui s’accaparent de la majeure partie du pouvoir décisionnel.
Au même moment, le développement de politiques keynésiennes qui promulguent une intervention de l’État au sein de l’économie crée une caste de hauts fonctionnaires ayant une importance prépondérante dans l’économie. Ils sont responsables des finances de l’État, de l’attribution des contrats publics, des choix d’investissements, d’agences de développement et d’imposantes caisses de retraites publiques. Ces salariées de l’État jouent un rôle fondamental dans l’économie, mais également dans la reconfiguration politique des rapports de pouvoirs internes dans l’appareil étatique où ils prennent un pouvoir de plus en plus important face aux syndiquées et aux personnels politiques.
L’émergence de nouveaux acteurs : les coordonnateurs
Certains soutiennent que ce rapport particulier à la production engendre une nouvelle classe, située entre la classe ouvrière et les capitalistes à proprement parler, qu’ils nomment les coordonnateurs. Qu’ils soient au privé ou au public, les coordonnateurs jouent un rôle central dans l’allocation des ressources, pour décider comment et à quel but on doit utiliser les biens matériels, le capital, le savoir, la force de travail, etc. Michael Albert et Robin Hahnel proposent le critère suivant pour reconnaître ceux qu’ils qualifient de coordonnateurs : des personnes qui ne sont pas propriétaires des moyens de production, mais qui dirigent le travail d’autres salariées. Par exemple, le système économique stalinien s’explique par la domination de cette classe sur l’ensemble de l’économie.
Quels sont les objectifs de cette classe ? En s’inspirant de John Kenneth Galbraith, on pourrait répondre : une autonomie de décision croissante par rapport aux propriétaires des moyens de production, le maintien et la croissance stable de l’organisation pour laquelle ils travaillent et une augmentation de la part de la plus-value qui leur est redirigée. Ils n’ont pas intérêt à réaliser des profits à court terme et à les maximiser à tout prix. Ils visent plutôt une croissance continue dans laquelle leur organisation a plus de pouvoir économique et politique tandis qu’eux-mêmes, grâce à son expansion, obtiennent des postes où ils ont plus d’autonomie et de résonance dans l’organisation.
Le fondement idéologique : le rationalisme managérial
Comme les autres classes, les coordonnateurs ont leurs intellectuels et leur idéologie. Ils se rattachent à la pensée rationaliste et se posent comme ceux qui font usage de raison dans l’utilisation des ressources, contrairement aux capitalistes et aux salariées qui sombrent dans leurs passions égoïstes. Cette idéologie trouve sa forme populaire dans la théorie managériale, diffusée largement à travers toute une littérature qui offre aux coordonnateurs à la fois des façons de vivre et des justifications de leur existence. Côté politique, leurs intellectuels ont pu former des organisations ou des partis et promouvoir la croissance de leurs intérêts.
L’existence de cette classe permet d’expliquer des luttes qui sont difficiles à comprendre en son absence. Par exemple la révolution actionnariale ayant eu lieu dans les années 1980-1990, où les actionnaires tentent d’imposer des plans de restructuration qui court-circuitent les hauts dirigeants en place peut très bien être comprise comme une lutte entre coordonnateurs et capitalistes. Cette révolution a mené à un ensemble de compromis entre capitalistes et coordonnateurs visant à coller davantage ces derniers sur les intérêts des actionnaires. La montée de l’utilisation des stock-options pour une partie de leur rémunération illustre bien cette tendance. À l’inverse, la révolte de 1956 des travailleurs et travailleuses de Budapest pourrait bien être comprise comme une tentative de réduire le pouvoir des coordonnateurs qui les dirigeaient alors. Face aux coordonnateurs, la classe ouvrière souhaite obtenir la capacité de gérer elle-même ses milieux de travail et l’information nécessaire pour bien comprendre les enjeux de la production.
Un tiers acteur ?
Au Québec cette classe et ses relations conflictuelles avec les autres classes constituent des éléments prometteurs pour mieux comprendre certains phénomènes. Par exemple, la création d’un ensemble d’entreprises québécoises vouées à être des champions nationaux dans les années 1970 pourrait être analysée sous l’angle d’une alliance entre coordonnateurs et capitalistes. On pourrait ensuite voir la transformation de cette stratégie et la comprendre à l’aune des directions prises par chacune de ces classes.
De la même manière, la transformation néolibérale des services publics peut être analysée à partir de cette nouvelle classe. Si une certaine entente avait eu lieu entre les coordonnateurs et les travailleurs et travailleuses quant à la mission et à la gratuité de ces services depuis la Révolution tranquille, celle-ci semble s’être désagrégée à partir des années 1980. Les coordonnateurs adhèrent au final à la doxa néolibérale, car s’il faut dégraisser c’est d’abord par le bas, en confiant certains secteurs à la sous-traitance ou en instaurant des services de vérification de la performance pour ceux qui restent. Or, autant pour offrir des contrats publics au secteur privé que pour évaluer la performance, il faut des cadres qui prennent un pouvoir croissant. Pensons aux récentes réformes pour améliorer la « gouvernance » tant en santé qu’en éducation, celles-ci ont systématiquement pour conséquence d’accroître le pouvoir des cadres supérieurs au sein de leur organisation.
On peut débattre longuement sur le fait que cet ensemble de personnes peut être défini comme une classe ou sur les façons d’en tracer les limites. Cependant, si on rejette l’outil d’analyse que représente cette troisième classe, il faut être capable de répondre aux questions suivantes : comment expliquer les actions de ces acteurs situés entre le travail et le capital ? S’ils font partie d’une des deux classes classiques, alors laquelle ? De plus, comment explique-t-on qu’ils aient systématiquement certains intérêts contraires à ceux de ces deux classes ? En refusant d’y répondre clairement, c’est tout un pan de notre système économique et politique que nous laissons volontairement incompréhensible.