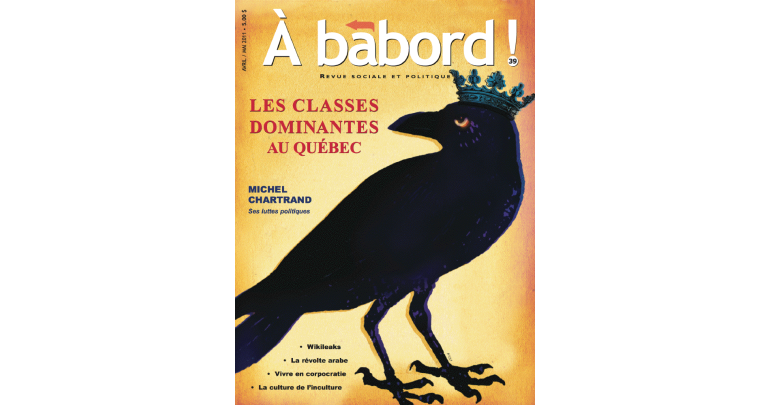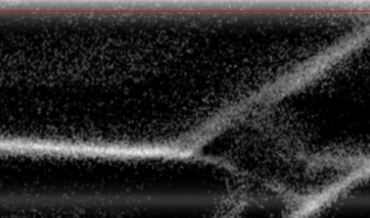Société
Le discours sur l’endettement
Une dépolitisation de la crise économique
Nos élites politico-économiques viennent de tirer la sonnette d’alarme : le taux d’endettement des Canadiens risque de replonger le pays dans une crise financière semblable à celle qui a frappé les États-Unis en 2008. Le ratio de la dette des ménages canadiens par rapport à leur revenu a atteint le niveau record de 148,1 %, taux qui dépasse celui des Américains qui se situe maintenant à 147,2 %. Selon Mark Carney, « La turbulence que traverse l’Europe en ce moment nous rappelle que la crise n’est pas terminée, mais qu’elle vient simplement d’entrer dans une nouvelle phase. Dans un monde submergé par les dettes, l’assainissement du bilan des banques, des ménages et des pays exigera des années. Par conséquent, le rythme, le profil et la variabilité de la croissance à l’échelle du globe se modifient, et le Canada doit s’adapter [1].
Dans ce contexte, plusieurs pontifes de la doxa économique ont entrepris une vaste campagne de propagande afin d’éduquer les masses ignorantes des « choses économiques » aux dangers liés au surendettement. Le 15 janvier dernier, Alain Dubuc, dans un dossier spécial de La Presse intitulé « Vivre à crédit », nous fait part d’une vérité sociologique que personne parmi les sycophantes de l’overclass financière n’a semblé avoir découverte jusqu’ici : « l’endettement est le symptôme de quelque chose de plus profond, une conception du bonheur » qui est axée sur la « gratification instantanée, où les gens se définissent à travers ce qu’ils consomment [2] ». Dans un sermon, digne des moralistes anglais du XVIIIe siècle qui professaient aux masses laborieuses les vertus de l’épargne et du travail, le chroniqueur de La Presse tire la conclusion qu’« à force de glorifier la consommation, on en vient à oublier les autres déterminants du succès économique, comme le travail, l’investissement, la productivité et l’épargne [3] ». Dans la même période, l’ancien ministre Claude Castonguay, maintenant Fellow invité au très scientifique CIRANO, propose quant à lui de forcer les travailleurs pauvres qui ne sont pas couverts par un régime de retraite d’employeur à cotiser au moins 5 % de leurs revenus dans un RÉER.
Cet appel aux vertus de l’épargne de la part des thurérifaires du grand Capital masque une réalité profonde : comment faire pour stimuler la relance économique dans un pays où plus de 70 % de la croissance est générée par la consommation ? Jean-Marc Fournier, ministre responsable de la protection du consommateur, reconnaît le problème. Mais selon lui les pauvres doivent apprendre à vivre selon leurs moyens : « Va pour la consommation, mais une consommation adaptée aux moyens de chacun et non une consommation débridée qui peut créer une bulle [4]. »
Il semble bien que la situation actuelle nous place devant l’une des contradictions profondes du capitalisme avancé qui se manifeste par l’incapacité d’arrimer la dynamique de la surproduction avec celle de la surconsommation. Le remède préconisé par les économistes libéraux, la baisse des salaires pour stimuler la productivité, risque de nous plonger dans le cercle vicieux de la hausse du chômage puisque les principaux partenaires commerciaux vers qui le Canada pourrait se tourner pour exporter sa surproduction peinent à se relever de la crise de 2008. Ainsi, derrière le voile moralisateur de ces discours qui enjoignent les banquiers irresponsables à s’auto-discipliner et appellent la population tout aussi irresponsable à « vivre selon ses moyens », ne se cacherait-il pas un problème plus profond, celui de la crise structurelle qui affecte l’ensemble des sociétés capitalistes avancées depuis maintenant plus d’une trentaine d’années ?
Financiarisation et crise du capitalisme
Les causes de cette crise, est-il nécessaire de le rappeler, ne sont pas uniquement dues au mauvais agissement de quelques financiers véreux, ou encore à des déréglementations orchestrées par de méchants politiciens néolibéraux, mais sont plutôt liées aux contradictions profondes du capitalisme. Comme l’écrit Anselm Jappe, « Le néolibéralisme était, au contraire, la seule manière possible de prolonger encore un peu le système capitaliste que personne ne voulait sérieusement mettre en question dans ses fondements, ni à droite ni à gauche. Un grand nombre d’entreprises et d’individus ont pu garder longtemps une illusion de prospérité grâce au crédit. Maintenant, cette béquille s’est également cassée. Mais le retour au keynésianisme, évoqué un peu partout, sera tout à fait impossible : il n’y a plus assez d’argent « réel » à la disposition des États [5]. »
De fait, le mode de régulation fordiste-keynésien, qui avait réussi le miracle d’arrimer la surproduction à la surconsommation via l’accroissement des salaires en fonction des hausses de productivité, et l’augmentation des dépenses publiques pour stimuler la consommation de biens collectifs, est entré en crise au tournant des années 1970. Ce modèle vertueux s’est muté en un régime d’accumulation financiarisé où le crédit et les actifs financiers (principalement immobiliers) détenus par les ménages sont venus financer leur surconsommation.
Dans ce contexte, le marché de l’immobilier devient une forme d’État-providence de remplacement pour les classes moyennes. Pour que cette métamorphose soit possible, les banques – dont la principale activité lucrative consiste à endetter la population – ont dû mettre en branle au préalable une vaste campagne de mobilisation des esprits afin de changer l’attitude de la population envers sa manière d’habiter l’espace. L’habitat, en tant que « forme la plus élémentaire d’exister et de se situer en propre dans le monde » [6], est maintenant perçu par la plupart comme un actif financier qu’il convient de faire fructifier. « Vous êtes plus riches que vous ne le pensez » clame une publicité de la Banque Scotia. En clair, cela signifie que la majorité de la population dont le salaire n’a pas augmenté depuis plus de 30 ans doit maintenant financer sa consommation grâce à l’augmentation de la valeur de ses actifs financiers.
On assiste ainsi à une mutation profonde de la manière dont s’effectue la reproduction sociale. Celle-ci ne passe plus principalement par le rapport d’esclavage salarial, elle repose en majeure partie sur la capacité des ménages d’obtenir du crédit. Cela ne veut pas dire que le travail en tant que forme centrale de médiation – et de domination – sociale ait disparu, mais plutôt que son rôle s’est transformé. L’emploi a désormais pour fonction d’obtenir un salaire minimum pour acquérir la crédibilité financière suffisante afin d’accéder au crédit. Avec la hausse prochaine des tarifs (TVQ, assurance médicament, frais de scolarité, etc.), l’endettement des ménages ne va qu’augmenter, surtout qu’on normalise le recours au crédit chez les étudiants sous le fallacieux prétexte qu’ils seront en mesure de récolter des flux de revenus futurs en investissant davantage dans leur « capital humain ».
Les institutions financières s’en trouvent doublement gagnantes. D’une part, elles tirent profit de l’individu transformé en investisseur qui place une partie de ses revenus sous forme d’actifs financiers, et d’autre part elles accumulent sur le dos de ce même individu surendetté qui rembourse uniquement le minimum de son solde de carte de crédit à des taux d’intérêts usuriers. En clair, la dynamique vertueuse d’accumulation, plutôt que d’être arrimée à l’augmentation de la productivité industrielle, est liée à l’accroissement spéculatif de la valeur financière. Cette omnipotence de la finance, qui est en mesure de régir jusqu’à notre manière d’être dans le monde, devrait nous amener à questionner la légitimité des institutions financières dans nos sociétés.
Pourquoi ne pas socialiser le système de crédit ?
Effectivement, contrairement à la croyance populaire fortement propagée encore récemment par l’ineffable Maxime Bernier qui souhaite retourner au régime de l’étalon-or (!!!) [7], la création monétaire n’est pas principalement l’affaire de l’État. C’est plutôt celle des banques privées qui possèdent le privilège d’émettre de la monnaie scripturale, c’est-à-dire de l’argent sous forme de crédit. Curieusement, personne parmi la communauté épistémique des économistes ne semble questionner ce privilège qui est accordé par l’État à quelques institutions privées, ni le fait qu’elles génèrent des profits pharaoniques en émettant une marchandise fictive qui ne coûte rien à produire : l’octroi de lignes de crédit qui sont en retour facturées sous forme de taux d’intérêt [8].
Or, à l’opposé des fables que nous racontent ad nauseam nos anciens camarades marxistes vulgaires recyclés en chroniqueurs économiques encore plus vulgaires, l’argent n’est pas une marchandise. Il s’agit d’un bien public au même titre que l’eau qui coule dans les aqueducs municipaux. Plus la monnaie est utilisée, plus la richesse sociale qu’elle représente profite à l’ensemble de la communauté, c’est pourquoi elle doit faire l’objet d’une régulation politique de la part des banques centrales. Dans la mesure où les banques canadiennes ont reçu pas moins de 125 milliards de dollars en aide gouvernementale à la suite de la crise de 2008 [9], argent qui a majoritairement servi à endetter davantage la population et nos gouvernements, ne serait-il pas temps de lancer un débat public sur la socialisation du système bancaire [10] ?
Bien sûr il ne s’agirait là que d’une mesure palliative et temporaire avant d’entreprendre la décroissance nécessaire vers laquelle nous pousse inéluctablement le Capital. Dans un contexte où la finance a colonisé jusqu’à notre manière d’exister et d’habiter le monde, et où les conditions nécessaires à la révolution anthropologique qui nous permettrait de passer à un au-delà du capitalisme ne semblent pas présentes, ce débat aurait au moins le mérite de re-politiser l’économie et de contrer le discours moralisateur qui vise justement à la dépolitiser en culpabilisant les consommateurs irresponsables.
[1] Gérard Bérubé, « Mise en garde de Mark Carney - Les Canadiens s’endettent au-delà de ce qui est raisonnable », Le Devoir, 14 décembre 2010.. »
[2] Alain Dubuc, « Une conception du bonheur », La Presse, 25 janvier 2011.
[3] Idem.
[4] Louise Leduc, « Le ministre Fournier veut agir », La Presse, 15 janvier 2011.
[5] Anselm Jappe, Crédit à mort : http://palim-psao.over-blog.fr/ext/http://sd-1.archivehost.com/membres/up/ 4519779941507678/Anselm_Jappe_-_Cr-dit_-_mort.pdf
[6] Jean-Paul Dollé, L’inhabitable capital, Paris, Lignes, 2010.
[7] Maxime Bernier, « Ancrer la monnaie dans l’or » : http://www.maximebernier.com/2010/01/ancrer-la-monnaie-dans-lor/
[8] Frédéric Lordon, « Pour un système socialisé du crédit », La pompe à phynance : http://blog.mondediplo .net/2009-01-05-Pour-un-systeme-socialise-du-credit
[9] Louis Gaudreau, « La stabilité artificielle des banques canadiennes », À bâbord !, Été 2010, p. 10-11.
[10] À ce sujet voir Lordon, op. cit.