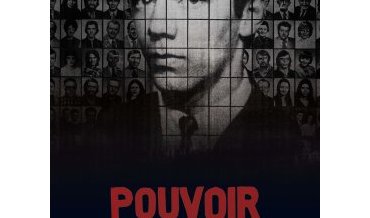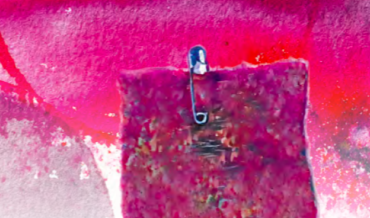Dossier : Violence et politique
Violence et libération
L’apparition de mouvements révolutionnaires prônant une stratégie de lutte armée, durant les années 1960-1970 dans les centres développés du capitalisme, a pu sembler à beaucoup une aberration mentale ou simplement l’expression d’une frustration extrême dans certaines franges de la société. Comment, dans des formations sociales connaissant un relatif bien être économique, pouvait-on envisager sérieusement le recours à la violence politique pour entamer ou accélérer des changements sociaux ? C’était, peut-être, une stratégie valable pour les pays du Sud, en butte à de grandes inégalités et aux dictatures, mais pas pour l’Amérique du Nord, l’Europe ou le Japon, pays riches où règne, de surcroît, une démocratie représentative. Comme le déclarait René Lévesque à la fin des années 1960, au Québec, « On n’est pas le Congo. »
Cette affirmation, en apparence évidente, ne l’était pas pour les mouvements radicaux, car ceux-ci, dans leurs analyses, pointaient du doigt le fait que le capitalisme mondial, à partir du début des années 1960, était entré dans un nouveau cycle de luttes, un cycle qui unifiait, apparemment, les combats du Sud et du Nord.
Un nouveau cycle de luttes radicales
De fait, il est tout aussi évident qu’à partir de la Révolution cubaine de 1959, on assiste à travers le monde à une agitation sociale importante dont le Mai français de 1968 ou l’automne chaud italien de 1969 ne constituent qu’un moment. La multiplicité des luttes et des acteurs engagés – ouvriers, femmes, étudiants, nations opprimées, mouvements contre la guerre menée par les États-Unis au Vietnam – confère à l’époque une image explosive qu’il faut toutefois nuancer. Les sociétés sont agitées mais aucune, à l’exception peut-être de la France en mai 1968 et de l’Italie à l’automne 1969, n’est sur le point de basculer dans une rupture révolutionnaire. Déjà, à la fin des années 1960, sous le coup de l’essoufflement, de la marginalisation et de la répression étatique, le ressac commence à se faire sentir. Pour beaucoup, il y a comme un mur qu’il s’agit de briser ou d’ébrécher par une rupture violente.
Nous pouvons donner quelques exemples. En Allemagne, c’est l’assassinat d’un étudiant, le 2 juin 1967, durant une manifestation contre la venue du Shah d’Iran et l’attentat meurtrier contre le leader estudiantin Rudi Dutschke en mars 1968 qui feront basculer des militants et militantes dans l’action armée, formant le Mouvement du 2 juin, anarchiste, et la Fraction armée rouge, marxiste-léniniste. En France, l’après Mai et le retour à la « normale » vont amener une partie de l’extrême gauche, entre autre l’organisation de la Gauche prolétarienne, à adopter une voie plus violente sans pour autant, à ce moment, prendre concrètement le chemin de la lutte armée. L’assassinat du militant Pierre Overney par un barbouze patronal de Renault, en février 1972, allait sonner un réveil brutal, amenant la direction de la Gauche prolétarienne a abandonner cette direction pour, finalement, dissoudre l’organisation en 1973. En Italie, la répression et l’assassinat de militants (comme l’anarchiste Giuseppe Pinelli en décembre 1969 ou l’éditeur Feltrinelli en 1972), avec comme toile de fond la stratégie de la tension, amènent plusieurs groupes à prendre les armes, dont les Brigades rouges. Aux États-Unis, face aux piétinements du mouvement contre la guerre du Vietnam et à l’exacerbation de la répression étatique (entre autre dans le cadre du programme Cointelpro qui se solda, de 1968 à 1976, par l’assassinat, pris en charge essentiellement par le FBI, de 27 militants du Black Panther et de 69 militants de l’American Indian movement), d’anciens membres du Students for a democratic society (organisation étudiante qui avait initié les mobilisations contre l’agression du Vietnam) décident de fonder, en 1969, les Weathermen. Cette organisation pratiquera, selon ses termes, une « propagande armée », très proche dans son inspiration de la « propagande par le fait » mise de l’avant par certains secteurs du mouvement anarchiste européen du XIXe siècle.
Arrêtons ici cette nomenclature qui, par la force des choses, ne peut être qu’incomplète et fragmentaire. Nous la complèterons, cependant, par une typologie sommaire de certaines des organisations qui, en Occident, ont choisi, d’une manière ou d’une autre, la voie armée. Dans un premier temps, nous retrouvons les organisations impliquées dans une lutte de libération nationale comme : le Front de libération du Québec (FLQ), l’IRA provisoire en Irlande du Nord, l’ETA en pays Basque et la Black Liberation Army (BLA) aux États-Unis. Dans le cadre de la lutte contre le capital et de la défense du prolétariat, on peut relever, entre autres, le Mouvement ibérique de libération (MIL) en Espagne, les Brigades rouges italiennes ou Action directe en France. Sur le front de l’anti-impérialisme et du soutien aux peuples du Sud (entre autres, les luttes des peuples vietnamien et palestinien), nous retrouverons la Fraction armée rouge allemande (RAF) et japonaise ainsi que les Cellules communistes combattantes de Belgique. Il est important cependant de signaler qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre ces types, les différents groupes articulant, dans des proportions variables, les registres de la libération nationale, de l’anti-capitalisme et de l’anti-impérialisme.
Rompre avec le vieux monde…
Pour tous cependant, la violence révolutionnaire est conceptualisée, en premier lieu, comme une réponse à une première violence, celle du pouvoir de l’État et du capital. Acte d’auto-défense, il en découle vite que la violence armée est un élément essentiel de rupture avec l’ordre établi, un élément qui permet aussi de départager les révolutionnaires de ceux qui veulent simplement aménager le vieux monde. Par la suite, le choix par un groupe de l’action violente et clandestine, institue celui-ci comme une mini-société à part, différente de la totalité sociale où règnent encore l’injustice, l’aliénation et l’oppression. Le groupe constitue alors une avant-garde, moins dans le sens conceptualisé par un Lénine que dans la manière de se voir comme des précurseurs qui, dans un futur plus ou moins lointain, seront rejoints par la grande masse du peuple. C’est donc dire que la plupart des mouvements armés de la période étudiée n’ont jamais prétendu prendre le pouvoir ou réaliser un changement révolutionnaire seulement par eux-mêmes. Ils se percevaient essentiellement comme des catalyseurs : « … les forces révolutionnaires auront, à même la lutte quotidienne, fait leur apprentissage. Comme des poissons dans l’eau, elles auront réveillé puis organisé les exploités… elles leur auront indiqué le chemin à suivre pour secouer le joug définitivement… » [1]. Éveilleurs et accompagnateurs, les mouvements armés, par l’exemplarité de leur action, « auront hissé la violence spontanée des masses au niveau d’une conscience de classe organisée » [2]
.
On retrouve des traces de cette vision dans la tradition socialiste européenne, comme dans la pensée du révolutionnaire français Babeuf jusqu’à Lénine en passant par Blanqui, les groupes anarchistes du XIXe siècle qui prônaient la « propagande par le fait », sans oublier les résistances antifascistes de la Seconde guerre mondiale. Toutefois, l’inspiration la plus importante viendra des pays du Sud avec l’expérience des révolutions chinoises, vietnamienne et cubaine ainsi que celle de tout le mouvement de décolonisation qui se met en branle à partir de 1945.
Le vent du Sud
Comme nous l’avons écrit en début de texte, les mouvements radicaux en Occident percevaient le nouveau cycle de luttes sociales comme un tout qui unifiait, apparemment, les combats du Sud et du Nord. La tentation était alors grande d’adopter, tels quels, des moyens de luttes (stratégie des « focos » de Guevara, Guerre populaire conceptualisée par Mao et Giap) qui avaient fait leurs preuves dans une situation sociale donnée, mais qui se révélaient complètement inadéquats pour d’autres. La tentative d’implanter, en 1964, des foyers de guérilla par l’Armée révolutionnaire du Québec (une branche du FLQ), dans des zones éloignées des centres urbains, inspirée par la stratégie des « focos », s’est ainsi révélée un échec. Par-delà cette reprise des moyens de lutte, il faut noter le rôle important qu’a joué, dans la conceptualisation de la violence à l’intérieur de l’action politique révolutionnaire, la pensée de Frantz Fanon. Ce dernier, fortement impliqué dans la lutte de libération nationale de l’Algérie à la fin des années 1950, écrivait : « Cette praxis violente (la lutte armée) est totalisante, puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne, du grand organisme violent surgi comme réaction à la violence première du colonialiste [3] ». Au niveau individuel, la violence est thérapeutique, car « elle débarrasse le colonisé de son complexe d’infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. » Cette idée d’une violence désaliénante se retrouve largement dans les différents textes ou manifestes produits par les mouvements armés d’Europe ou d’Amérique du Nord, ou par des « sympathisants », durant les années 1960-1970 [4].
Une nouvelle époque
La plupart de ces mouvements vont, cependant, disparaître dans le cours de la décennie 1980. La très forte répression étatique, l’isolement des groupes et la fatigue expliquent, en premier lieu, cette disparition. Affronter l’État sur le terrain où il excelle le plus, celui de la violence, n’a de sens que si une large masse de la population, au-delà d’une certaine sympathie, juge légitime l’action armée des groupes. Cela n’a pas été le cas sauf peut-être, durant une certaine période historique, pour l’Ira provisoire en Irlande du Nord et pour l’ETA en pays basque. En second lieu, la disparition de l’URSS et du soi-disant bloc socialiste, au début des années 1990 ainsi que l’imposition du néolibéralisme à travers la planète ont transformé complètement le paysage politique et social. À la suite de ces transformations, l’idée même de changements sociaux, par des moyens violents ou même légaux, a pu apparaître, pour un temps, comme obsolète.
L’apparition des mouvements altermondialistes a remis à l’ordre du jour, dans une certaine mesure, les débats pour des changements de l’ordre social actuel. Dans ces débats, la question de la violence, sous une forme ou une autre, revient. Mais cette question ne peut plus se poser comme il y a 40 ans, à moins que l’on veuille reproduire le passé. Ce qui, comme le relevait Marx, ne peut conduire, dans un premier temps, qu’à la tragédie et, dans un second temps, à la comédie.
[1] FLQ, « Stratégie révolutionnaire et rôle de l’avant-garde », texte ronéotypé, non daté, p. 3.
[2] Idem, p. 3.
[3] Frantz Fanon, Les damnés de la Terre, Paris, Maspero, 1975, p. 51.
[4] Entre autres exemples, on peut se référer au texte de Pierre Maheu, « De la révolte à la révolution », publié dans la revue québécoise Parti pris en octobre 1963.