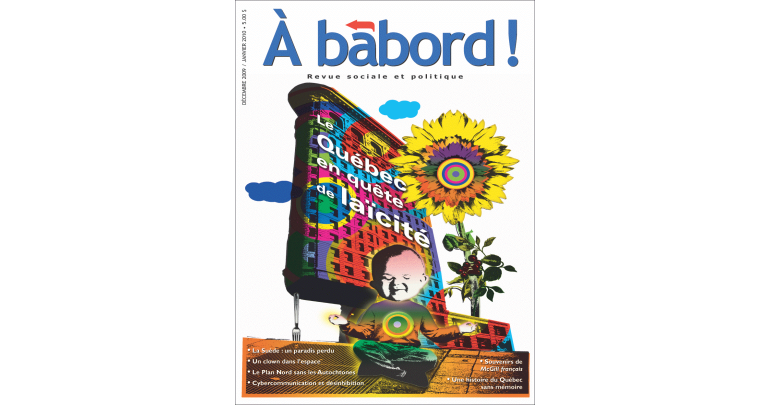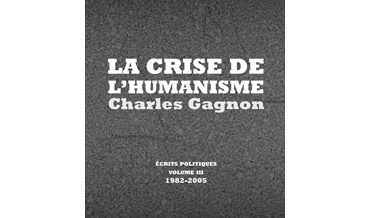Mémoire des luttes
Souvenirs de l’opération
C’était un soir de 1968, dans ce bar qu’on appelait la Casa espagnole, aujourd’hui disparu, au coin des rues Sherbrooke et Hutchison. Avec la Hutte suisse, toute proche, c’était un lieu comme il n’en existe plus vraiment aujourd’hui, fréquenté par une faune artistique, littéraire, nationaliste et de gauche. On y défaisait et refaisait le monde jusque tard dans la nuit. Je me souviens, en particulier, d’interminables débats avec Gaston Miron, qui pourfendait les gauchistes refusant de suivre René Lévesque sur le chemin de l’indépendance. Pedro présidait gentiment, mais fermement en cas de dérapages, ces nocturnales.
Le Comité Indépendance-Socialisme
J’étais ce soir-là avec François – que nous appelions alors Mario – Bachand. Nous étions l’un et l’autre activement engagés dans le Comité Indépendance-Socialisme (CIS), que nous avions fondé avec d’autres, au printemps 1968, en quittant le Rassemblement pour l’Indépendance Nationale (RIN). Nous étions résolument opposés à la ligne défendue à l’époque par le président du parti, Pierre Bourgault, prônant une fusion avec le mouvement politique fondé par René Lévesque après sa démission du Parti libéral, en octobre 1967. Voyant que nous nous dirigions inéluctablement vers la défaite, nous avons choisi de quitter le RIN avant le congrès prévu pour trancher ce débat. Le groupe démissionnaire s’était immédiatement scindé en plusieurs composantes. La vice-présidente démissionnaire du parti, Andrée Ferretti, formait avec d’autres militants le Front de Libération Populaire, alors que d’autres s’apprêtaient à se perdre dans la nature avant de se manifester de manière explosive.
Le CIS, de son côté, se réclamait du marxisme et cherchait l’équilibre entre la lutte sociale et la lutte nationale, en privilégiant néanmoins la première. Certains de ses dirigeants venaient de la revue Parti Pris, dont ils avaient démissionné durant l’été 1968 pour des raisons analogues à celles qui les avaient amenés à quitter le RIN. La majorité du comité de rédaction était en effet favorable à ce qu’on appelait alors l’option Lévesque. Nous avions expliqué notre position, Gilles Bourque, Luc Racine et moi-même, dans un texte intitulé « Pour un mouvement socialiste et indépendantiste ». Bizarrement, nos noms n’apparaissaient pas dans notre article, paru dans ce qui se révéla être le dernier numéro de cette revue qui, née en 1963, avait constitué un vecteur important du débat politique dans le Québec des années 1960.
Sans être un mouvement clandestin, le CIS n’en était pas moins une organisation plutôt secrète qui ne cherchait pas la visibilité. Le groupe, peu nombreux, était néanmoins très actif et organisé. Nous avons été mêlés de près à l’organisation du défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1968, alors que Pierre Elliott Trudeau, fraîchement élu premier ministre, siégeait à la tribune d’honneur. Nous craignions les actions provocatrices, alors que circulaient les rumeurs de jets de cocktails Molotov. L’événement fut effectivement très violent. Nous l’avions à l’esprit au moment de la préparation du McGill français et cherchions à trouver le moyen de contenir ces débordements.
Ce soir-là, Bachand et moi nous demandions quel événement serait susceptible de relancer et de stimuler la lutte nationale et sociale dont nous voyions le CIS comme un des fers de lance. C’est le secteur de l’éducation qui semblait avoir pris le relais. Après deux semaines d’occupation de leurs collèges, 10 000 étudiants de cégeps étaient partis du campus de McGill pour marcher vers l’Université de Montréal le 21 octobre 1968. Le 3 décembre, des locaux de McGill avaient été occupés par des militants du Mouvement pour l’intégration scolaire, qui avaient mené les opérations de Saint-Léonard. L’Université Sir George Williams avait vu son centre d’informatique également occupé et finalement saccagé par des étudiants.
J’étudiais alors à l’Université McGill, dont j’ai obtenu une maîtrise en sciences économiques en 1972. J’étais aussi professeur de mathématiques au Collège Jean-de-Brébeuf, vice-président du Syndicat du Personnel Enseignant (SPE), qui regroupait à la CSN les enseignants des collèges privés, et délégué du SPE au Conseil Central des Syndicats Nationaux de Montréal, alors présidé par Michel Chartrand. Je me trouvais donc à la jonction de plusieurs des mondes qui se sont exceptionnellement rejoints dans l’opération McGill : mouvements étudiant, syndical, nationaliste et socialiste.
La situation à l’université McGill
L’Université McGill était alors en proie à d’intenses remous internes. Étudiants radicaux – comme on disait à l’époque – socialistes et marxistes avaient pris en main les rênes de l’Association étudiante comme du journal étudiant McGill Daily. L’affaire Grey était un moment fort de cette agitation. Enseignant au département de sciences politiques, Stanley Grey avait été congédié par la direction de l’Université pour avoir perturbé des réunions du sénat et du conseil des gouverneurs. Cette décision avait provoqué d’importantes manifestations. Sur un autre front, les étudiants étaient parvenus à obtenir une représentation au comité d’attribution des doctorats honorifiques de l’Université. Dans un rapport minoritaire du dit comité, ils proposaient qu’on attribue des diplômes à Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse et Michel Chartrand.
C’est cet ensemble de circonstances qui nous amenèrent à jeter notre dévolu sur McGill comme lieu de notre prochaine manifestation. Il nous apparaissait en effet comme un point de jonction idéal entre les deux axes de notre projet politique : le national (McGill français) et le social (McGill aux travailleurs). S’y ajoutera le mot d’ordre McGill aux étudiants. Le fait qu’à l’intérieur même des murs d’une institution considérée comme vouée aux intérêts du capitalisme anglo-saxon, un mouvement de révolte était en train de s’amplifier constituait une garantie de succès de l’opération. L’opposition qu’allait manifester le Parti québécois de René Lévesque, de même que la Société Saint-Jean-Baptiste, non seulement n’étonnerait-elle pas, mais de surcroît nous rassurerait en nous posant comme les seuls porteurs d’un authentique nationalisme de gauche.
L’opération McGill français
Je ne sais si c’est ce soir-là, ou plus tard, qu’après des discussions ardues, nous avons choisi le mot d’ordre « McGill français ». Je ne sais pas non plus, à partir de là, comment se sont faites les jonctions avec les autres groupes, dans ce qui s’est avéré une opération organisée très efficacement mais aussi d’une manière très anarchique. Outre le CIS, étaient impliqués le Front de Libération Populaire et le Comité d’Action Socialiste de l’Université McGill. Le Mouvement pour l’Intégration Scolaire, le Conseil Central des Syndicats Nationaux de Montréal et d’autres organismes se sont associés de diverses manières à l’opération. Stanley Grey et l’avocat Robert Lemieux ont joué un rôle important. J’ai beaucoup de difficulté à me souvenir de la structure organisationnelle de cette opération, peut-être parce qu’il n’y en avait tout simplement pas. Je me souviens de diverses réunions au cours desquelles se manifestaient des désaccords importants tant sur les objectifs de l’opération que sur les mots d’ordre à mettre de l’avant et son déroulement concret. Je soupçonnais quelques personnes de préparer, sans l’avouer ouvertement, une occupation de l’Université, ce qui allait immanquablement provoquer un affrontement violent avec les forces policières et le service d’ordre de l’Université. Le jour même de la manifestation, la rumeur circulait que certains seraient armés. La tension était extrême chez ceux qui avaient été mêlés de près à l’organisation de l’événement.
Comme pour la manifestation de la Saint-Jean en 1968, François Bachand a joué un rôle important et parfois énigmatique. Il prenait plusieurs initiatives sans nous consulter, ce qui provoquait des tensions dans notre groupe. Il était de ceux qui souhaitaient les affrontements violents. Il fut arrêté avant la manifestation, accusé d’avoir volé du matériel à des policiers qu’il avait surpris en train d’épier une réunion d’organisation de l’opération. Il a alors choisi de s’enfuir à Cuba, avant de se rendre en Algérie et finalement à Paris, où il fut assassiné en 1971 dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées.
Les forces policières ont sans doute grandement contribué à dramatiser l’opération McGill, comme la campagne de presse hystérique et sans précédent qui s’est développée dans l’ensemble du Canada. Activités de surveillance et arrestations se sont multipliées à mesure qu’approchait l’heure fatidique. Sortant un soir d’une réunion du Conseil central où nous avions présenté l’opération, nous fûmes arrêtés, Stanley Grey, les dirigeants du McGill Daily, moi-même et quelques autres et détenus quelques heures sans aucune explication. De tels gestes contribuaient évidemment plus à nous stimuler qu’à nous intimider.
L’ampleur de la manifestation fut beaucoup plus considérable que ce que nous avions prévu à l’origine. C’était le résultat d’une conjoncture particulière qui se prêtait, ici comme partout ailleurs dans le monde, à des prises de possession massive de la rue. Mais c’était aussi relié à la diversité des groupes et des communautés qui ont été mobilisés et associés à l’organisation de l’événement. La conjonction entre le mouvement syndical, le mouvement étudiant, le mouvement nationaliste, les divers groupes de gauche, explique qu’environ 10 000 personnes se soient déplacées. En dépit de l’opposition du Parti québécois et de la Société Saint-Jean Baptiste, on retrouvait de nombreux membres et dirigeants de ces deux organisations.
La violence que nous appréhendions ne fut pas au rendez-vous. Le grand nombre de manifestants a pu jouer pour tuer dans l’oeuf les actions de commando et éviter que l’opération ne dégénère en émeute sanglante. Mais la présence policière massive, casquée et armée de boucliers et matraques, que le McGill Daily a comparée le lendemain à une scène du Alexandre Nevski d’Eisenstein, a sans doute aussi joué un rôle important. Sentant néanmoins la tension monter à mesure que les manifestants se massaient devant les portes de l’université, nous initiâmes un « sit-in » pour la calmer. Il y eut quelques charges policières à motocyclette, assez désagréables, quelques petits feux de rue, quelques bousculades et arrestations. Mais rien de plus grave que ce à quoi on assiste après une conquête de la coupe Stanley.
Une bataille à valeur symbolique pour le Québec
Quel bilan tirer de cet événement ? Il s’inscrit dans une conjoncture particulière, au Québec comme dans l’ensemble du monde, dans laquelle la composante économique est importante. La fin des années 1960 est celle de la remise en question d’un modèle de croissance, d’une organisation de la société qui s’est mise en place dans la foulée de la dépression des années 1930 et de la Deuxième Guerre mondiale. Le mai 1968 français, qui nous avait d’ailleurs inspirés et stimulés, est sans doute l’événement le plus emblématique de cette conjoncture. À un moment où le marxisme avait le vent dans les voiles, on remettait en question, non seulement le capitalisme, mais aussi les organisations politiques de gauche traditionnelles. Cette conjoncture allait évidemment se transformer radicalement avec le ralentissement de la croissance, la crise du keynésianisme, la montée du néolibéralisme et l’écroulement des régimes d’Europe de l’Est.
En ce qui concerne le Québec s’ajoute une dimension nationale et linguistique, qui n’est évidemment pas absente ailleurs dans le monde. L’opération McGill français s’est inscrite dans le cadre de la renaissance d’une lutte nationale, et en particulier d’une revendication linguistique, qui seront bientôt prises en charge par le Parti québécois. Mais en 1968, tout était instable et en mouvement, entre le terrorisme, les diverses positions de gauche et le nationalisme de droite.
Le succès de McGill français, car c’en fut un, a été de cristalliser et de fusionner pendant quelque temps ces tendances diverses et opposées. McGill, là-dedans, a été plutôt un prétexte. Nous aurions pu choisir une autre cible. Nous savions pertinemment que les cinq exigences que nous mettions de l’avant, dont la francisation à court terme de McGill, étaient irréalisables. Nous baignions alors dans l’idéologie soixante-huitarde du « Soyons réalistes, demandons l’impossible ». Notre discours était souvent simpliste et manichéen. Mais je crois que notre diagnostic relativement à la place de McGill dans la société québécoise était fondamentalement juste. Et, très lentement, beaucoup plus lentement que nous ne l’exigions, un certain nombre de transformations se sont opérées. J’en ai déjà perçu quelques-unes entre 1969 et 1972, date de mon départ de McGill. Il est clair que cette opération a provoqué un traumatisme qui a entraîné des réformes. Mais c’est surtout dans l’évolution de la situation politique au Québec, et particulièrement dans celle de la question linguistique, que l’opération McGill a eu une signification dont plusieurs retombées restent encore à évaluer.