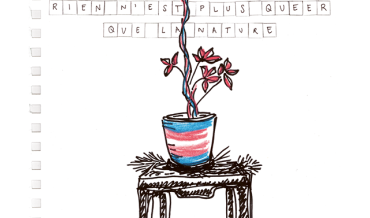Dossier : L’utopie a-t-elle un avenir ?
Le socialisme écologique
Pour un renouveau de la pensée critique
Depuis l’apparition du premier manifeste écosocialiste rédigé par Michael Löwy et Joel Kovel en 2001, un nouveau courant de pensée prend de l’ampleur au sein de la critique du capitalisme contemporain. Cherchant à lier théoriquement la critique sociale et la critique écologique du système actuel, l’approche écosocialiste a suscité plusieurs contributions notables parmi lesquelles on peut citer celles de Michael Löwy, Daniel Tanuro, Jean-Marc Harribey, Michel Husson, Elmar Altvater et Joan Martinez-Allier.
Mais un autre courant, moins bien connu du lectorat francophone, participe également à ce renouveau théorique de la pensée socialiste. Il s’agit du courant nord-américain, plus spécifiquement états-unien, qui se présente sous le vocable d’« ecological socialism » ou, si l’on préfère, de socialisme écologique. Le plus fécond des penseurs associés à ce courant est, sans aucun doute, John Bellamy Foster, rédacteur en chef de la revue newyorkaise, Monthly Review, la plus ancienne et respectée des revues marxistes américaines.
J. B. Foster : l’écologie au cœur de la vision de Marx
Auteur d’une bonne dizaine de livres ou de recueils d’articles sur les questions environnementales, J. B. Foster a regroupé autour du Monthly Review (MR) une équipe de contributeurs de haut calibre. Que l’on pense à Paul Burkett, auteur de plusieurs ouvrages sur l’économie écologique, Victor Wallis, rédacteur de la revue Socialism and Democracy, Fred Magdoff, ancien professeur d’agronomie à l’Université Cornell ou Brett Clark, sociologue et corédacteur du dernier livre de Foster. Ainsi, à presque toutes ses parutions mensuelles, la revue publie un article fouillé touchant les questions environnementales. Depuis quelque temps, un élément crucial de la réflexion des rédacteurs de MR tourne autour des nouvelles expériences de pouvoir populaire en Amérique latine, notamment celle de Chavez au Vénézuela et de Morales en Bolivie. La revue accorde beaucoup d’importance au Sommet des peuples sur le climat tenu à Cochabamba en avril 2010, car elle le considère comme étant l’acte de naissance d’un mouvement social portant une critique anticapitaliste et tiers-mondiste de la crise écologique. D’ailleurs, l’un de ses rédacteurs, Fred Magdoff, a joué un rôle important dans les chantiers de travail aboutissant à la déclaration finale du sommet.
L’apport théorique essentiel de l’équipe de Monthly Review consiste à affirmer que l’écologie, loin de coexister plus ou moins confortablement avec le marxisme, serait bien, au contraire, au cœur de la vision marxienne du socialisme. Conséquemment, elle se donne comme objectif de réhabiliter « l’écologie de Marx », en démontrant sa pertinence au XXIe siècle, alors que le monde fait face à une crise environnementale globale d’une ampleur insoupçonnée lors de la naissance du capitalisme industriel.
La rupture de l’échange métabolique entre société et nature
Le concept clé sur lequel repose cette démonstration est celui de la « rupture de l’échange métabolique entre les êtres humains et la nature » ou, comme la renomme avec bonheur Foster dans son dernier ouvrage, « la rupture écologique [1] ». Pour Marx, nous dit Foster, le processus de travail est défini comme l’échange de matières entre la nature et les êtres humains. Or, le développement de l’agriculture industrielle et de l’urbanisation capitaliste a créé une rupture dans cet échange naturel (ce « métabolisme social ») entre environnement et société humaine. La livraison vers les villes, parfois à des centaines ou même des milliers de kilomètres de distance, de nourriture et de tissus supposait le retrait du sol de certains nutriments tels que l’azote, le phosphore ou le potassium. Ces éléments deviennent des déchets dans les villes, où ils s’accumulent et polluent l’environnement, plutôt que d’être recyclés vers les sols d’origine qui s’appauvrissent sans cesse. Le rétablissement systématique de la circulation des matières entre les êtres humains et la nature, qui est la « condition naturelle d’une fertilité durable de la Terre », serait impossible sans le dépassement de la rupture écologique induite par le capitalisme. Le capitalisme est donc un système qui épuise et finit par détruire tout autant la nature que le travail humain.
La révolution écologique
Poussée au maximum par le capitalisme néolibéral, la rupture écologique assumerait aujourd’hui une dimension gigantesque menaçant la survie de la civilisation telle que nous la connaissons. Au-delà de l’érosion des sols évoquée par Marx, nous voyons aujourd’hui une diminution dramatique des forêts, l’acidification croissante des océans, une urbanisation sans frein ainsi qu’un réchauffement climatique s’approchant de conditions d’emballement (« tipping points ») proprement catastrophiques. Pour Foster, il ne fait plus de doute : « Une révolution écologique – un changement massif et soudain du rapport de l’humanité à la nature – est absolument nécessaire [2] . »
Mais de quelle révolution écologique s’agit-il ? Celle imposée par l’effondrement écologique et social que nous prépare inéluctablement le système ou, plutôt, celle d’une humanité consciente, voulant changer radicalement ses rapports avec la nature ? C’est à ce point qu’intervient un élément puissant de la pensée de Foster : son appel à lier la restauration du rapport « métabolique » avec la nature à une authentique quête de nouveaux rapports sociaux coopératifs et égalitaires. En ses mots, nous devons concevoir « une révolution qui est à la fois écologique et sociale ».
[1] « The Ecological Rift » de John Bellamy Foster, Brett Clark et Richard York, Monthly Review Press, New York, 2010.
[2] « The Ecological Revolution. Making Peace with the Planet » de John Bellamy Foster, Monthly Review Press, New York, 2009.