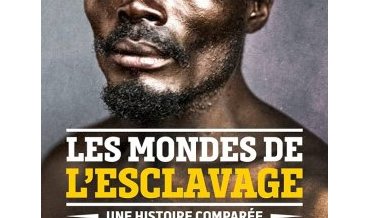Sans-statut algériens
La citoyenneté en marche
par Julie Mareschal
Au Canada, plus de la moitié des revendicateurs du statut de réfugié voient leur demande rejetée. Chaque année, environ 5000 demandeurs d’asile déboutés sont déportés du pays alors que de nombreux autres quittent « volontairement ». Depuis trois ans, les sans-statut algériens ont mis en lumière les limites de notre système démocratique et les événements entourant cette question nous amènent à reconsidérer la valeur et le rôle attribué à la notion de citoyenneté.
Les sans-statut algériens sont des demandeurs d’asile non reconnus par l’État canadien. En temps normal, les réfugiés déboutés se voient contraints de quitter le pays. Or, de 1997 à 2002, l’Algérie était considérée comme un pays sous moratoire en raison de l’insécurité régnante. Depuis 1990, ce conflit, lié à la montée du terrorisme ainsi qu’à la corruption du pouvoir algérien, a entraîné la mort de plus de 150 000 personnes, sans compter les milliers de disparus. Au Canada, les revendicateurs refusés se trouvaient, dès lors, en suspension de renvoi. N’étant ni réfugiés, ni clandestins, ces personnes sont donc « sans-statut ».
Le 5 avril 2002, Denis Coderre, alors ministre de l’Immigration, annonce la levée du moratoire. Selon lui, il n’y aurait plus de risque à renvoyer quelqu’un en Algérie. Le ministère de l’Immigration estimait alors ce nombre à 1 040 personnes, dont un millier vivant à Montréal.
Mais comment prétendre à une accalmie alors que la guerre se poursuit ? En 2002, ce conflit a fait plus de 1 000 morts. « Personne n’est tranquille en Algérie », raconte une femme immigrante. « Chaque fois que ton fils sort, il y a une sorte de peur dans ton cœur. C’est ce qui arrive en Algérie, il y a un fils qui sort et il ne revient plus jamais ». Dans ces conditions, comment peut-on assurer que les expulsés ne courront aucun risque pour leur vie en étant déportés contre leur gré, « chez eux », en Algérie ?
En revanche, Denis Coderre avait tenu à rappeler, lors d’une conférence de presse sur la question, que « nous vivons dans un État de droit ». Mais de quel droit parle-t-on exactement ? Selon la Cour suprême du Canada, il n’est pas nécessaire qu’il y ait complicité de l’État dans la persécution appréhendée si le demandeur peut démontrer que l’État est incapable de le protéger des actes de tiers. En ce sens, est-il légitime que le Canada renvoie des demandeurs d’asile dans un pays où l’État n’est pas en mesure de protéger ses citoyens ? Quelles étaient donc les raisons énigmatiques de la levée du moratoire par M. Coderre ?
Cette décision faisait suite au séjour de Jean Chrétien à Alger, en mars 2002, alors qu’il était Premier ministre, où il a principalement été question d’échanges commerciaux entre les deux pays. Serait-il possible que l’on ait négocié, par la même occasion, la levée du moratoire ?
Voilà une lecture humanitaire qui n’est plus de mise alors que la psychose sécuritaire s’est installée avec l’affaire Ressam, suivie des événements du 11 septembre 2001. Il n’en fallait pas plus pour semer le doute sur l’origine et les pratiques appréhendées de futurs réfugiés.
Être sans-statut : l’insécurité et la précarité au quotidien
Pour certains Algériens, cette situation incertaine dure depuis plus de huit ans. « On est en train de vivre dans l’incertitude. […] C’est une souffrance qui est là, qui est là sans cesse. Je ne peux pas passer un moment sans penser à ça », raconte une mère de famille arrivée au Canada en 1996. « Ça me révolte ! […] On est bien, mais au fond de nous on est stressés. Des fois le stress part, ça touche un peu la vie familiale, ça touche un peu les enfants. Des fois je perds les pédales, des fois je ne sais pas sur quel pied danser ! ».
Au stress quotidien s’ajoutent également des conditions de vie difficiles. Officiellement, les réfugiés sans-statut n’ont pas accès au système d’assurance-maladie du Québec, mais le gouvernement rembourse tout de même une partie de leurs frais médicaux. De plus, contrairement aux réfugiés reconnus ainsi qu’aux immigrants reçus, les sans-statut ne se voient pas déchargés d’une partie de leurs frais de scolarité par l’État – ils doivent donc payer l’équivalent des étudiants étrangers.
Leur statut provisoire limite également leur accès au marché de l’emploi. Ils ont le droit de travailler, cependant le chiffre « 9 » [1] figurant au début de leur numéro d’assurance-sociale (NAS) signale à l’employeur potentiel la position juridique ambiguë dans laquelle se trouve le requérant. Comment trouver un travail stable alors qu’on n’a qu’un « statut » temporaire ? De ce fait, la majorité est contrainte à des emplois à faible revenu, exigeant très peu de qualifications. Relégués à la précarité et à l’incertitude, les sans-statut sont profondément ébranlés par l’expérience du déclassement social et le sentiment de perte. « Donc, raconte un père de famille, nous avons survécu tant bien que mal avec un statut précaire. […] Nous avons survécu dans une société d’accueil qui ne nous a pas reconnu le statut de réfugié ».
Ni étrangers ni nationaux, la terre d’accueil représente un lieu où ils se sentent à la fois inclus et exclus : « De toute façon, moi je ne quitterai pas le Québec même si on me coupe en morceaux. Je suis bien là. Je me suis sentie ici mieux que dans mon pays. […] La rage que j’ai, c’est par rapport à l’immigration. Des fois je me dis : " ça va éclater ! " […] Mais on n’a pas le choix. Mais maintenant jusqu’à quand ? », déplore cette femme.
Après l’annonce de la levée du moratoire, la douleur et la crainte se sont amplifiées chez ces demandeurs d’asile. Mais comment peut-on remédier à cette situation lorsque, dépouillé de tout statut juridique, on se retrouve en marge de la vie juridico-politique ?
Vers la création d’un état d’exception
Plusieurs sans-statut, qui considèrent le Canada comme leur deuxième pays, ont l’impression d’être confrontés à une grande injustice. Un pays dit démocratique peut-il refuser l’asile politique à plus d’un millier d’individus pour des intérêts d’ordre économique ? C’est du moins l’argument principal que soutiennent les membres du Comité d’Action des sans-statut (CASS). Créé au printemps 2001, ce comité, essentiellement composé d’Algériens sans-statut, a mis sur pied une campagne pour réclamer le retour du moratoire et la régularisation de leur situation. Aussi ont-ils organisé plusieurs marches et actions publiques à Montréal et fait entendre leur voix par l’entremise de différents médias. L’expression du litige constituait alors l’objet d’un enjeu vital : le droit à la vie.
À la suite de ces manifestations et débats publics, le ministre Coderre a décrété une mesure d’exception à l’égard des politiques d’accueil des réfugiés. Ainsi, en novembre 2002, les Algériens sans-statut ont disposé de 90 jours pour effectuer une demande d’immigration. Bien que cette « ouverture » ait permis à certains individus de régulariser leur situation, il n’en demeure pas moins que les requérants ont été évalués en fonction des critères restrictifs imposés par le ministère de l’Immigration (âge, scolarité, expérience professionnelle, etc.).
Un sans-statut déclarait alors : « Demander des critères, nous trouvons que c’est injuste. Nous sommes des personnes qui ont besoin de protection. Il est ridicule que la possibilité d’être protégé soit accordée en vertu d’un diplôme ! Parce qu’ils n’ont pas eu de diplôme, ces gens-là vont être malheureusement refusés. »
Selon lui, cette non-reconnaissance risque de déboucher sur bien pire : « La situation que nous craignons, c’est que les gens n’auront pas d’autre choix que d’entrer dans l’illégalité, et c’est ce que la population doit comprendre. Le gouvernement doit être assez responsable pour dire que nous avons effectivement besoin de protection ».
Paroles prophétiques… À l’issue du processus exceptionnel mis en place par le ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration du Québec (MRCI), plus d’une cinquantaine d’individus et de familles ont vu leur dossier refusé, ou accepté à des conditions toutefois impossibles à rencontrer. À la suite d’un ordre d’expulsion du Canada, Mohamed Cherfi, porte-parole du CASS, a d’ailleurs trouvé refuge dans l’Église unie de la paroisse St-Pierre à Québec depuis le 10 février 2004. À ce jour, plus de 150 autres dossiers restent à traiter et pourraient connaître le même sort. La lutte des sans-statut algériens se poursuit.
L’État de droit revisité
En somme, bien qu’ils soient mis à l’écart, les sans-statut demeurent présents dans la cité. Leur exclusion même les pousse à prendre place sur la scène publique et à dénoncer l’injustice dont ils sont victimes. C’est donc en marge de la vie juridico-politique que l’expression citoyenne prend tout son sens. La citoyenneté n’est pas un simple statut, comme le mentionne Balibar, mais une pratique collective.
Aussi les sans-statut algériens, en tentant de recréer de la citoyenneté, nous révèlent-ils les limites de notre démocratie « moderne ». Va-t-on faire prévaloir les intérêts marchands et les légitimes soucis de sécurité des citoyens en jetant dans l’abîme des humains qui ne cherchent qu’à échapper à la guerre ? Si tel est le cas, il faudra alors se demander sur quels principes se fonde réellement notre État de droit.
[1] Lorsqu’ils ne sont pas citoyens ou résidents permanents, les étrangers travaillant au Canada ont un NAS qui commence par le chiffre 9.