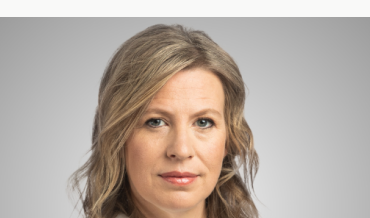Journalisme, militantisme et impartialité
De nos jours, dans les codes d’éthique ou de déontologie qui balisent modérément les activités professionnelles liées aux métiers de l’information, il n’est plus tant question d’objectivité journalistique que d’autres valeurs, telles l’exactitude, l’équité, la rigueur, la vérité et l’impartialité, dont on ne manquera pas de préciser ici qu’elle reste encore et toujours synonyme d’objectivité. Ces mêmes qualités déterminent a contrario ce que la journaliste Colette Beauchamp nomme « la tare de la subjectivité » des militantes, laquelle renvoie à de moins nobles vocables – tels idée reçue, parti pris, partialité – et dote ces acteurs du monopole de l’idéologie.
D’une part, il est donc question d’exactitude se traduisant par la vérité des faits et d’impartialité, corollaire de légitimation tout particulièrement des propos, décisions et actions des grands décideurs rattachés aux institutions politiques, économiques et financières les plus influentes.
D’autre part, il est fait état de la subjectivité des militantes, activistes, membres de groupes communautaires ou de pression ou d’associations diverses ou encore intellectuelles critiques, que nul ne se hasarde à désigner par le terme « citoyens ». Médiatiquement moins nantis, ces définisseurs ou sources secondaires sont rarement invités par les journalistes à présenter leurs priorités événementielles ou leurs propres analyses sociopolitiques. Seules comptent leurs réactions et anathèmes à des événements politiques orchestrés et établis par les définisseurs primaires (réformes, compressions, budget, nouvelle politique, etc.) qui déterminent ainsi le gros de la teneur de la couverture de presse.
D’un côté règnent la raison et la légitimation, de l’autre, l’émotion, le désordre et le chaos.
La livraison impartiale et rigoureuse des faits sur un événement donné, dont la couverture est dictée par la nécessaire actualité avec un grand A, va de pair avec l’application du principe journalistique dit des deux côtés de la médaille, dans l’optique, professe-t-on, d’assurer en même temps que l’équilibre des points de vue une couverture équilibrée dudit événement. Si cette prétention à la symétrie des propos constitutifs des récits journalistiques est bien commode, car elle renvoie à la notion d’égalité, une valeur cardinale des démocraties libérales, dans la réalité, ces principes ne tiennent pas plus la route que leurs promesses de réciprocité et de démocratie. En 2012, un cas, parmi bien d’autres, exemplifie cette assertion.
Jean Charest, les Québécois-es et la rue
L’année dernière, lors de la grève des étudiantes, puis de manière accrue pendant la courte campagne électorale provinciale d’août, Jean Charest, alors premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, n’a eu de cesse de déclarer quotidiennement dans les médias la même rengaine : l’enjeu de ces élections renvoyait à un choix de société des Québécois.e.s contre la « rue ». Selon ce profilage idéologique aussi réducteur que grossier, en 2012, la configuration sociodémographique du Québec à la mode libérale se traduisait par une opposition manichéenne entre deux groupes sociaux ! Les Québécoises, une majorité silencieuse avide de lois, quand bien même seraient-elles « spéciales » et assoiffée d’ordre. La rue, imprévisible, violente, désordonnée, figure emblématique de toutes les contestations contre les politiques libérales, incarnée par tous les porteurs de carrés rouges et joueurs de casseroles réunis à la brunante, incluant madame Marois. Bref, à des gens qui ne seraient donc pas de « vraies » Québécois.e.s.
Copieusement relayée par de nombreux médias d’information, cette vulgate politique et électorale libérale réduisait ainsi les milliers de personnes qui manifestaient dans plusieurs villes du Québec, tous les 22 du mois et tous les soirs, pendant près de deux saisons, à une terne entité bitumineuse. La rue ! Un mélange d’hydrocarbures, très visqueux ou solide, dont la couleur varie du brun au noir (ciel, comme les anarchistes !) utilisé pour revêtir les chaussées et les trottoirs. La rue, une entité inquiétante, sans autre projet de société que de fournir des pavés aux « casseurs » de vitrines, générer la pagaille et l’incertitude. La rue, une « chose » sans légitimité, privée de toute identité citoyenne.
Si, pendant la même période, Jean Charest avait parlé d’un choix de société des Québécois.e.s contre les Autres – par exemple, les immigrant.e.s, les gais, les femmes, les Noir.e.s, les croyant.e.s –, on peut raisonnablement penser que cela aurait soulevé quelques protestations indignées dans la presse et dans les chaumières au regard, entre autres, du caractère raciste, homophobe et antireligieux de cette énonciation, contraire aux principes consignés dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Rien de tel ne s’est passé au sujet de la rue.
Cette grande généralisation communicationnelle tendant à personnifier une rue a priori menaçante s’est imposée comme une fiction commode permettant au candidat briguant le poste politique le plus élevé de la province, dans l’irrespect le plus flagrant des principes démocratiques qui gouvernent le Québec, d’accuser et d’admonester, sans les nommer, tous ceux et celles qu’il considère comme des dissidentes indésirables et dont il renie ainsi, par la bande, les statuts de citoyen.ne et d’électeur-trice.
Ces techniques de manipulation cognitive ont plusieurs conséquences. Elles influent le sens du message et soutiennent des entreprises de désinformation, laquelle consiste à faire passer pour des faits impartiaux, véridiques et crédibles des inventions, des fictions, voire des mensonges. Elles contribuent à occulter le réel et, par conséquent, les vraies informations, de même qu’elles visent l’obtention, par exemple, d’un consentement qui n’est pas acquis d’avance, en l’occurrence le vote des électeurs, alors que le PLQ est à la traîne dans les sondages sur les intentions de vote.
Pour leur part, sans trop sourciller, les médias et nombre de journalistes ont abondamment diffusé le récit de cette fiction intitulée « les Québécois contre la rue », riche de mots piégés, certainement conçu par les spécialistes en communication – relationnistes ou communicant.e.s – alors responsables de peaufiner les stratégies communicationnelles et les relations de presse d’un gouvernement libéral en crise et en fin de règne. Après tout, cette évocation de la rue ne sortait-elle pas de la bouche du définisseur primaire par excellence, de la source des sources, quand bien même fut-elle sortante : le premier ministre du Québec ? Alors pour quelle raison les journalistes qui l’ont évoqué auraient-ils dû se garder une petite gêne et ne pas répéter ce récit ad nauseam ? Et à quoi bon questionner le caractère manipulateur et désinformant de cette allégorie dessinant les traits d’une réalité sociale et politique biaisée et donnant lieu à une couverture médiatique démagogique, généralisatrice, réductrice, trompeuse et… profondément subjective ?