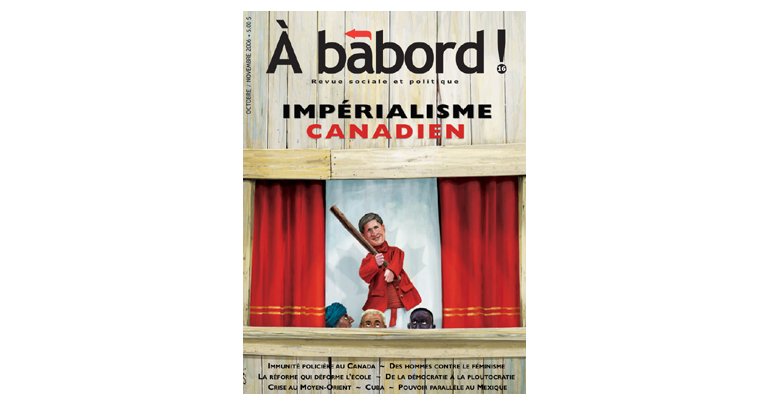De la démocratie à la ploutocratie
par Claude Vaillancourt
Lors d’une rencontre entre élues progressistes et groupes de la société civile à Ottawa le 6 juin dernier, Marcy Kaptur, représentante démocrate de l’Ohio au Congrès des États-Unis, a qualifié
son propre régime politique de « ploutocratie ». L’accusation est grave : notre voisin ne s’est-il pas toujours fait le représentant de la démocratie et de la liberté ? Venant d’une élue respectée, ce terme n’est-il pas un surprenant aveu d’échec ?
Mais au fait, qu’est-ce donc que la ploutocratie ? Le dictionnaire nous apprend que le terme vient des mots grecs ploutos, « richesse », et kratos, « pouvoir ». Un régime serait donc ploutocratique lorsque le pouvoir est exercé par les plus riches. L’encyclopédie Wikipédia nous apprend que la ploutocratie « est essentiellement une conception théorique et polémique, car elle n’a jamais été vraiment institutionnalisée nulle part, même s’il est rare qu’il n’existe pas une très bonne corrélation entre le pouvoir politique et la richesse. »
Le terme se prête donc mal à une utilisation rigoureuse qui décrirait précisément une manière d’exercer le pouvoir, tel l’usage que l’on fait des mots « monarchie » ou « communisme ». On pourrait même le considérer comme un truisme : il serait en effet difficile de trouver un modèle de gouvernement qui ne s’est pas appuyé sur les gens les plus riches.
La sonorité du terme « ploutocratie » est désagréable, agressante, et le mot claque comme une insulte. Peu de gens aimeraient se faire qualifier de « ploutocrates ». Le terme a d’ailleurs souvent été utilisé par les nazis et les fascistes dans de fougueux élans démagogiques, pour honnir les grands bourgeois et leur collusion avec le pouvoir.
Le mot « ploutocratie » semble avoir été d’usage courant dans la France du XIXe siècle. Pierre Leroux, intellectuel socialiste et ami de George Sand, fait paraître en 1848 De la ploutocratie ou Du gouvernement des riches, titre un peu trompeur, puisque l’auteur n’entame pas vraiment une réflexion sur le sujet, mais élabore une étude détaillée des classes sociales en France. Quelques années plus tard, Ernest Renan nous donne une définition souvent reprise : « J’appelle ploutocratie un état de société où la richesse est le nerf principal des choses, où l’on ne peut rien faire sans être riche, où l’objet principal de l’ambition est de devenir riche, où la capacité et la moralité s’évaluent généralement (et avec plus ou moins de justesse) par la fortune. »
Un modèle : les États-Unis
Cette définition nous éloigne quelque peu de l’idée d’un pouvoir politique exercé par les riches, mais nous ramène aux États-Unis de Marcy Kaptur. L’obsession de l’argent et l’envie de s’enrichir de nos voisins ont été maintes fois dénoncées, du séjour de Tocqueville en Amérique aux constats dévastateurs de Joseph Stiglitz dans Quand le capitalisme perd la tête (Fayard, 2003) : « [nous] comptions beaucoup sur les étudiants étrangers qui affluaient dans les universités pour faire fonctionner nos instituts de recherches, tandis que les meilleurs étudiants américains apprenaient à monter les transactions financières. »
Mais au-delà d’une élite souvent dénoncée pour son obsession de l’argent et de la réussite matérielle, faudrait-il croire que les plus riches exercent vraiment le pouvoir dans ce pays tellement fier de sa démocratie ?
Il faut certes avoir de l’argent, beaucoup d’argent, avant d’entreprendre une campagne électorale aux États-Unis. Au prix de quelques courbettes – dont le président Clinton s’était fait le champion –, les cordons des bourses des grandes compagnies et des millionnaires se délient facilement. On peut imaginer qu’une telle générosité sera noblement récompensée.
Un regard sur les contributions au financement des deux principaux partis politiques soulève de sérieuses inquiétudes. Lors des dernières élections présidentielles états-uniennes, les deux principaux candidats ont reçu un total de 528,9 millions $ en dons. La seule compagnie Altria (qui comprend Philip Morris, General Food et Kraft) a donné 6 990 000 $ au Parti républicain depuis 2000, encore plus qu’Exxon Mobil qui s’est contenté d’un mince 2 807 223 $.
Question de prudence élémentaire, la plupart des principales compagnies investissent dans les deux grands partis. Les banques dominantes, par exemple, refusent carrément de se mouiller : ainsi, la JP Morgan Chase and co. a donné 53 % de ses contribution aux Démocrates et 48 % aux Républicains, le Citygroup 51 % et 49 % et la Bank of America 47 % et 53 %. Toutes les compagnies ne développent pas de pareils comportements de funambules. Mais la très forte majorité d’entre elles – dont les 100 premières donnent toutes plus d’un million de dollars – ont la sagesse de placer leur argent de façon équilibrée dans l’un et l’autre parti [1].
Tout cet argent sera bien investi. Il permettra de traquer l’électeur états-unien là où il est : devant sa télévision. Comme les journaux télévisés laissent peu de temps aux candidats pour s’exprimer (en 2000, leurs interventions duraient en moyenne 7,8 secondes), les partis doivent donc acheter du temps d’antenne et bombarder les spectateurs de publicité (285 millions dépensés dans ce but en 2000, dont 60 % en publicité.) La publicité produite à grands frais devient ainsi l’une des sources majeures d’information pour une très grande partie de l’électorat états-unien.
De pareils investissements ne seront pas perdus, loin de là. Les chercheurs Abramowitz, Alexander et Grunning de l’Emory University ont signalé que le taux de réélection exceptionnel de 99 % à la chambre des Représentants était dû à « l’incapacité des challengers à concurrencer financièrement les candidats déjà titulaires du poste ». Au Sénat en 2005, un nouvel élu a réussi à l’emporter, envers et malgré tout, grâce à des dépenses de 14,7 millions, soit 74 $ par voix obtenue. Selon John R. MacArthur, qui a rendu compte de ces données dans sa chronique au Devoir, « sans financement public sérieux, et étant donné le monopole des deux grands partis, les campagnes politiques sont devenues des compétitions essentiellement symboliques. »
Pour s’assurer que les élus ne déraillent pas entre les élections, pour éviter qu’il ne leur prenne la velléité de gouverner dans l’intérêt de la majorité, les grandes compagnies utilisent un procédé très efficace, mais qui coûte évidemment très cher : le lobbying. À Washington, les lobbyistes forment une véritable armée : on en dénombre 25 000 dûment enregistrés représentant 600 organisations, et cette structure se répète, à plus petite échelle, dans chacun des 50 États. Tous ces lobbyistes ne travaillent pas pour de grandes entreprises et défendent parfois de nobles causes. Mais puisque les plus influents d’entre eux – ceux qui vous garantissent des contacts sûrs avec les puissants – peuvent aisément obtenir des salaires qui dépassent 300 000 $ par année, on imagine que peu de groupes communautaires ou d’organisations de citoyennes arrivent réellement à en profiter.
Il est bien connu que les plus puissants lobbies, par exemple la National Rifle Association, le lobby des compagnies pharmaceutiques et la U.S. Coalition for Service Industries ont d’importantes entrées à la Maison blanche et que de nombreuses politiques en ce qui concerne des sujets majeurs, tels l’environnement, la libéralisation des services, la vente d’armes, sont déterminées en fonction des désirs formulés par de richissimes entreprises. L’argent ouvre bien des portes. Qui ne se laisserait pas tenter ?
Exporter la ploutocratie
Après de telles constatations, on peut donc avancer, en accord avec Marcy Kaptur, que le régime politique états-unien est bel et bien ploutocratique, et cela, sans passer pour un exalté ou un nébuleux théoricien. Ainsi, lorsque notre voisin prétend exporter la démocratie, peut-être faut-il entendre qu’il cherche en réalité à exporter la ploutocratie. C’est ce qui aurait pu exister en Irak, par exemple, si les Irakiens s’étaient montrés un peu plus coopératifs.
Ainsi, l’Irak rêvé par Paul Bremmer, administrateur états-unien, ouvrait le pays à tous les fortunés : « les impôts étaient plafonnés à 15 %, les taxes à l’importation étaient supprimées (et remplacées par une surcharge de 5 % affectée à la reconstruction), le système financier et monétaire était entièrement remis à neuf ; près de 200 entreprises publiques allaient être privatisées. » [2] Une ouverture qui convenait particulièrement bien aux compagnies liées à l’administration Bush, comme Halliburton, Bechtel et Harken Energy.
Heureusement, la très forte majorité des pays ne se font pas imposer avec violence un pareil régime politique. Le gouvernement des riches a su cependant se développer à l’échelle internationale, par des institutions qui ont fait preuve de leur efficacité : le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La littérature sur les méfaits de ces organisations et sur leur travail zélé en faveur des grands intérêts financiers est abondante ; des études montrent à répétition comment elles travaillent à créer un véritable gouvernement mondial, soumis aux grands de la finance et au pouvoir des multinationales, au-delà de celui de l’État-nation, envers et malgré tout le plus solide rempart de la démocratie (ou ce qui en reste).
Au Canada, nous sommes depuis peu protégés par la Loi fédérale sur l’imputabilité, qui limite le financement des partis politiques, contrôle le lobbying et nous permet pour le moment d’éviter un virage trop brusque vers la ploutocratie. Mais cette loi arrive suite à un scandale sans précédent, révélé par la Commission Gommery, qui alliait comme il se doit la cupidité, l’argent et le pouvoir.
De plus, elle a été adoptée par un parti qui ne craint pas les contradictions : le gouvernement conservateur aligne en effet ses principales politiques sur les États-Unis et ne cesse de se rapprocher du gouvernement Bush. Ce gouvernement a d’ailleurs contribué à créer un Conseil nord-américain de la compétitivité, formé d’hommes d’affaires qui dicteront directement leurs politiques aux gouvernements nord-américains sur des sujets aussi vitaux que les frontières, les transports, les services [3].
Il est donc légitime de se demander si notre beau pays, toujours prêt à s’intégrer dans les grandes structures internationales, obsédé par la réussite économique, ne cède pas lui aussi au pouvoir de l’argent. Et cela en toute subtilité, avec discrétion, par une collaboration à la canadienne, toute en douceur et qui ne veut pas se dire.
[1] À consulter à ce sujet : l’excellent site http://www. opensecrets.org/index.asp
[2] Ibrahim Warde, « Irak, l’Eldorado perdu », Le Monde diplomatique, mai 2004.
[3] Voir « Diplomatie patronale. Le Partenariat de sécurité et de prospérité » dans le dossier « Impérialisme canadien », AB ! # 16.