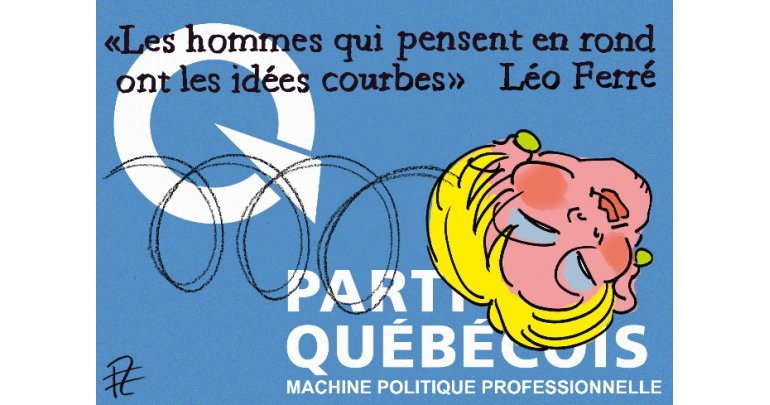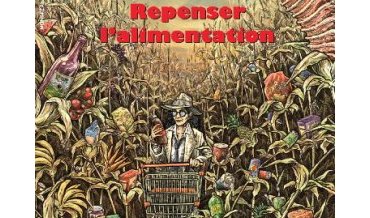Le Parti Québécois au pouvoir
Avancez en arrière !
Les volte-face du Parti québécois depuis l’élection de l’automne ont été largement commentées. Elles ont rassuré le milieu de la finance, déçu ceux et celles qui avaient cru à un véritable changement, inspiré les caricaturistes, confirmé le point de vue des cyniques et ramené la politique à sa triste routine. Le gouvernement péquiste s’est plié sans résistance à la nécessité de rentrer dans le rang. Il a perdu une occasion de plus de se montrer audacieux.
Rappelons que les jours qui ont suivi l’élection du PQ ont été remplis d’heureuses surprises. Ce parti, dirigé par une femme, a éliminé la hausse des droits de scolarité à l’université et a abrogé les dispositions de l’indigne loi 12 touchant le droit de manifester. Il s’est engagé à ne pas hausser les tarifs d’électricité. Il a prévu d’ajouter un palier d’imposition supplémentaire pour les riches et d’imposer davantage les gains en capital. Il a nommé deux écologistes dans des ministères clés. Il a annoncé la fermeture d’une centrale nucléaire dangereuse, inutile et coûteuse. Il a établi un moratoire sur le gaz de schiste.
On aurait pu croire que ce gouvernement était porté par le souffle du dernier printemps québécois, qu’il allait accomplir ce pour quoi il était élu. Dans les milieux sociaux, comme à la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, on exprimait une joie teintée de scepticisme. La victoire était belle, mais combien de temps le gouvernement tiendrait-il ?
Les forces conservatrices se sont alors déchaînées. Le Conseil du patronat et la Fédération des chambres de commerce du Québec ont publié des communiqués sobres mais fermes, désavouant nettement les choix du nouveau gouvernement. La Presse a envoyé au front son économiste vedette Alain Dubuc : dans pas moins de trois chroniques, il déplorait entre autres le « peu d’intérêt » de la première ministre pour l’économie et l’« amateurisme » du ministre des Finances. Les libéraux parlaient d’« incompétence », un mot répété à plusieurs reprises pour qu’il entre bien dans les cerveaux. Les médias populistes de droite ont mis de l’avant le cas de riches menaçant de s’exiler pour se libérer du nouvel enfer fiscal québécois.
Plaire à tout prix à la classe économique
Pour les élites économiques, le problème posé par le PQ relève surtout de la rupture d’excellents canaux de communications et de liens naturels avec le parti au pouvoir. Le nouveau cabinet de ministres est formé de journalistes, d’enseignantes, d’avocates ayant peu travaillé dans de grands bureaux d’affaires. Rien à voir avec les élus du gouvernement précédent, dignes représentants du Québec inc., qui ont fréquenté les chambres de commerce, ont fait partie de conseils d’administration, ont occupé des postes dans de grandes entreprises privées.
Leur stratégie consiste alors à discréditer le parti au pouvoir, à révéler ses faiblesses sur le plan économique afin qu’il ouvre tout grand ses portes à ceux qui sauront efficacement le conseiller. La cible idéale a été le ministre des Finances, Nicolas Marceau. Cet économiste, seule véritable caution du Parti québécois dans le domaine de la finance, reste un homme vulnérable : il n’a pas dirigé d’entreprise ni fait partie de prestigieux conseils d’administration, il s’est surtout confiné dans son poste d’enseignant à l’UQAM – même pas à l’Université de Montréal ou à McGill ! –, malgré une honnête participation au comité sur les finances publiques et la fiscalité de la Chambre de commerce du Monréal métropolitain.
Ce ministre est devenu la preuve flagrante de l’incompétence du nouveau gouvernement en matière d’économie. À cela s’ajoute la faiblesse de la première ministre dans ce secteur, plusieurs fois dénoncée par les commentateurs de la droite.
Il devient alors nécessaire, pour le PQ, de se sortir de sa soi-disant incompétence, si ouvertement révélée, en appliquant avec zèle des mesures qui conviennent aux maîtres. Le « bon gouvernement » nécessite de l’autocensure et la remise au fond du placard des idées qui ont aidé à prendre le pouvoir. Le sacrifice n’est pas trop grand si on obtient en échange la bénédiction de ceux qui connaissent vraiment le fonctionnement de l’économie. Recevoir un certificat de bonne conduite économique de la classe financière devient beaucoup plus important que de réaliser ses promesses électorales.
Le PQ a alors entrepris son virage radical. Il a annulé l’augmentation d’impôts sur le capital, renoncé au gel des tarifs d’électricité. Il a appliqué dans son dernier budget des mesures d’austérité dignes d’un véritable gouvernement néolibéral. Il a donné son appui à l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, négocié en secret par le gouvernement Harper et qui limitera de façon significative l’autonomie du Québec. Pour un gouvernement souverainiste, il s’agit d’un choix particulièrement surprenant.
Les limites des « bons gouvernements »
Les difficultés vécues par les populations proviennent pourtant de cette élite économique à laquelle se soumet ouvertement le PQ. Ce sont des experts en provenance des plus prestigieuses universités qui ont ardemment démantelé la réglementation des marchés financiers. Ce sont de grands banquiers qui ont décidé de la façon de sauver les banques de leur propre irresponsabilité lors de la crise de 2008, à un coût ruineux pour les États. Ce sont des ministres des Finances copains avec les grands patrons qui ont conçu des plans d’austérité sur mesure pour siphonner les pauvres et ménager les riches. Ce sont des bonzes de la banque Goldman Sachs, coupable de spéculation agressive, de délits d’initié, de trafic des comptes en Grèce, que l’on invite au pouvoir pour gérer les dégâts que cette entreprise et ses consœurs ont elles-mêmes causés.
Certes, la démission du PQ n’est pas nouvelle. Nombre de chefs d’État de gauche ont gouverné en appliquant avec un zèle non démenti des politiques de droite : Clinton puis Obama aux États-Unis ; Lionel Jospin puis François Hollande en France. Sans oublier Tony Blair au Royaume-Uni, Gerhard Schröder en Allemagne, Romano Prodi en Italie. Et le PQ de Lucien Bouchard. Toute cette orthodoxie a créé davantage d’inégalités, n’a en rien réglé le problème de la pauvreté et a grandement affaibli la capacité d’offrir de bons services publics.
Les gouvernements qui ont adopté les mesures les plus favorables pour leur population sont justement ceux qui ont su se libérer du joug des « bonnes décisions » économiques, qui ont affirmé leur souveraineté plutôt que leur soumission aux diktats de la finance.
Hugo Chávez au Venezuela a osé nationaliser le pétrole et distribuer les revenus de cette manne à la population en offrant de meilleurs soins de santé et une éducation accessible à tous et toutes. Après avoir été l’élève modèle du Fonds monétaire internationale et connu ainsi l’une des plus spectaculaires banqueroutes de ces dernières années, l’Argentine s’est partiellement sortie de la misère par des renationalisations et en imposant ses conditions de remboursement de sa dette à ses créanciers. L’Équateur a commis l’impertinence de refuser de payer sa dette illégitime, ce qui lui a permis de racheter à bon compte les titres de sa dette et de se libérer des contraintes que celle-ci imposait.
Les pays scandinaves, quant à eux, s’obstinent à conserver des taux d’imposition dramatiquement élevés, ce qui leur permet d’offrir une éducation gratuite à tous les niveaux et surtout de maintenir un société égalitaire, soucieuse de la protection de l’environnement. Tout cela sans que le dynamisme de leur économie ne soit remis en cause.
Désobéir
Dans tous ces cas, il s’agit d’hérésies, de politiques dénoncées avec vigueur par les plus grands experts de l’économie, d’exemples désolants de ce qu’il ne faut pas faire. Et qui donnent pourtant de remarquables résultats. Ainsi, le fait que le PQ soit privé d’experts et de têtes fortes en économie classique aurait pu être un très grand avantage. On en aura somme toute très peu profité.
Le PQ a certes à son désavantage sa situation de gouvernement minoritaire et un déficit budgétaire laissé par l’ancien gouvernement – un cadeau empoisonné qui devient désormais une tradition lors d’un changement de régime. Ces excuses ont toutefois le dos large et permettent de gouverner en suivant le vent, sans courage et sans convictions.
Comme toujours, il est clair que de véritables politiques en faveur de la majorité ne pourront pas être prises sans un mouvement social très fort, relayé par un parti politique au pouvoir doté de courage politique. Les derniers mois nous ont offert un spectacle désolant : la rapide réprobation des élites financières semble avoir eu plus d’impact sur notre gouvernement que la longue et extraordinaire mobilisation du printemps dernier. Mais ce mouvement pourrait encore retrouver son souffle.
Lors de ce dernier printemps, les Québécois et les Québécoises ont pu constater la force de la désobéissance lorsque celle-ci est au service de la justice et d’un grand sens de l’éthique. Mais ils ont aussi découvert à quel point celle-ci attirait sa part de blâmes. Voilà toute la difficulté des gouvernements au pouvoir qui ont à cœur l’intérêt primordial de leurs citoyenNEs : ils doivent tout autant désobéir, mais à des diktats économiques très contraignants. Très peu hélas en ont la force.