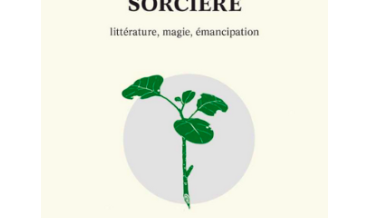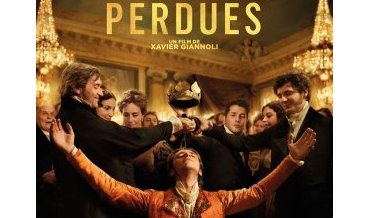Culture
Annie Ernaux. L’écriture, une exploration totale du réel
Il faut toujours se méfier des préconceptions et des préjugés, à commencer par les siens. Ils m’ont retenu longtemps dans ma venue à la lecture de l’oeuvre d’Annie Ernaux qui ne s’est amorcée qu’avec Les années, publié en 2008 et dont le titre signale d’emblée la dimension et la portée historiques. Je l’associais, à tort, à la nébuleuse des écrivaines s’adonnant complaisamment à l’autofiction, au récit de leurs petites histoires personnelles, amoureuses et érotiques, un peu à la manière de leurs équivalents masculins, Miller ou Bukowski par exemple.
Ernaux, tout en n’appartenant pas à ce courant, y participe à sa manière, et dans une certaine mesure, dans certains de ses récits (Passion simple, l’événement, l’occupation) centrés sur son expérience personnelle : la dépendance affective et érotique, l’avortement, la jalousie. Il s’agit toutefois davantage de témoignages nettement autobiographiques que de fictions. C’est ce qui distingue, entre autres, son entreprise de celles d’une Christine Angot ou encore d’une Nelly Arcan chez lesquelles la fiction s’inspire et se nourrit du réel, quitte à engendrer des malentendus et des méprises.
Écrire la vie
Cette veine demeure toutefois minoritaire chez Ernaux qui a d’abord écrit des romans de facture assez classique, s’inspirant de son expérience bien sûr, mais s’inscrivant très explicitement dans le registre de la fiction qui est alors pour elle le lieu authentique de production de la littérature conçue de manière plutôt conventionnelle. Ses deux premiers livres publiés – Les armoires vides (1974) et Ce qu’ils disent ou rien (1977) –, bien qu’énoncés à la première personne par des narratrices qui pourraient être des doublets de l’auteure, relèvent délibérément de l’imaginaire alors que le troisième, La femme gelée (1981), apparaît comme un récit de transition, donnant de plus en plus d’importance à la réalité et à la volonté de tenir sur celle-ci un discours de vérité.
C’est le moment d’une bifurcation : l’écriture n’est plus d’abord une machine à produire de la fiction et de la littérature, mais un mode d’appréhension et d’expression du réel dans ses manifestations les plus concrètes et immédiates. Écrire la vie, pour reprendre le titre qui sert d’emblème à l’édition de la quasi-totalité de son oeuvre dans la collection « Quarto » de Gallimard, devient du coup l’impératif central d’Ernaux et sa signature particulière.
Une oeuvre polyphonique : modalités et variations
Cette volonté va se traduire par la production d’ouvrages biographiques consacrés aux figures parentales, du père dans La place (1983), de la mère dans Une femme (1987), et autobiographiques dans La honte, L’événement (1997) et L’occupation (2002). Ces livres présentent tous une composante sociale centrale qui permet de les décrire au mieux comme des récits autosociobiographiques, visant à reconstituer la vérité d’un milieu grâce à une méthode s’apparentant très largement et explicitement à l’ethnologie, et se réclamant volontiers de Pierre Bourdieu.
Cette ambition de rendre compte du monde social dans sa complexité et son épaisseur historique va se manifester également dans deux ouvrages, Journal du dehors (1993) et La vie extérieure (2000), consacrés aux villes nouvelles et aux banlieues qui surgissent comme des champignons dans la modernité récente, et notamment dans la grande région parisienne où vit l’écrivaine. Construits à partir d’un collage, d’un montage d’affiches, de publicités, de bribes d’information, de chansons, d’esquisses de scènes de la vie quotidienne significatives, ces livres tentent d’évoquer, dans des fragments suggestifs, la réalité d’une époque, la nôtre, à travers une « écriture photographique du réel », du cadre oppressant dans lequel les individus vivent et finissent par être modelés, qu’ils en soient conscients ou non.
Cette écriture polymorphe et pluridimensionnelle se nourrit elle-même d’une expérience consignée dans des journaux que tient Annie Ernaux depuis son entrée en écriture au début des années 1960. Journal personnel, d’une part, dont des parties ont été publiées et qui scandent des expériences fortes : la mort de la mère dans « Je ne suis pas sortie de ma nuit » (1997), l’aventure amoureuse et érotique avec un jeune amant russe dans Se perdre (2001), qui redoublent, en les complétant, les récits plus maîtrisés et distanciés, déjà publiés, sur ces événements. On en retrouve aussi des échos dans la sorte de journal/album de photos sur lequel s’ouvre Écrire la vie. Lui fait pendant un journal voué proprement à l’écriture, aux problèmes très concrets qui se posent dans la phase de gestation, d’élaboration et de structuration de l’oeuvre, qui vient tout juste d’être révélé et publié sous le titre de L’atelier noir.
Questions de méthode : l’approche ethnologique
Ce journal s’offre comme un témoignage indispensable pour qui s’intéresse à la forme, à la composition des récits de l’auteure qui admet avec une grande justesse que « le problème de la méthode est réellement fondamental » (p. 45) pour celui qui, à travers l’écriture, veut faire « advenir un peu de vérité » (p. 51) sur le monde et sur soi. Comment y parvenir ? Quelle stratégie, et par suite quelle technique, faut-il emprunter ou élaborer ?
Cette question est au coeur de L’atelier noir, mais aussi des entretiens d’Ernaux avec Frédéric-Yves Jeannet consignés dans L’écriture comme un couteau (2011). L’écrivaine y reconnaît sa « dette » à l’endroit de Bourdieu et de son approche « ethnologique » du réel, celle de l’observateur, à la fois distancié de son sujet et en même temps en empathie avec lui. Elle se propose pour sa part de dégager la vérité sensible du monde auquel elle a appartenu durant son enfance – l’univers mi-rural, mi-urbain qu’elle a connu en Normandie profonde – et dont elle s’est progressivement éloignée par ses choix professionnels et culturels, devenant une sorte d’« immigrée de l’intérieur », affligée par la culpabilité liée à la trahison des origines et essayant de s’en libérer en redonnant vie à ce milieu déserté. Il s’agit donc de reconstruire par un travail mémoriel passant par le recours et l’orchestration de mots, de gestes, de chansons conservés dans le souvenir, et profondément incorporés, la réalité concrète et les mentalités d’un monde et d’une époque, bref des habitus qui régissent cet univers dans le cours de la vie quotidienne, déterminant les comportements et les discours.
C’est ce que l’on pourrait appeler la leçon de Bourdieu dont Ernaux reconnaît que les travaux ont été pour elle un « encouragement à persévérer dans mon entreprise d’écriture, à dire, entre autres, ce qu’il nommait le refoulé social ». L’influence du sociologue joue donc sur deux plans : celui du projet de révéler ce qui est habituellement tu ; celui de la méthode que l’écrivaine va mettre à l’oeuvre de manière intuitive dès son premier roman, puis de manière plus concertée dans La place notamment, et dans Les années, en lui associant une perspective sociopolitique dans le cadre d’une chronique couvrant un demi-siècle, de la Guerre jusqu’à l’entrée dans le XXIe siècle.
Du roman familial à la chronique historique
Les armoires vides s’ouvre sur un récit d’avortement pris en charge par une narratrice, jeune étudiante qui raconte son drame, d’autant plus aigu que perçu comme un échec, comme la conséquence fatale d’une trahison du milieu familial quitté à l’adolescence. Elle a échappé au destin des filles de son univers : la reproduction à 15 ans, volontaire ou forcée, qui l’a rattrapée d’une certaine manière dans le milieu universitaire, la ramenant paradoxalement à sa condition initiale. La reconstitution de son monde originaire s’enclenche sur ce noyau central, occupant une part importante dans le roman et cette évocation procède déjà, sur un mode spontané et empirique, d’une démarche ethnosociologique. Celle-ci comprend une description de l’univers du travail des parents qui possèdent un café et une épicerie jumelés dans une petite ville de province : un café fréquenté par des ouvriers bons vivants et ivrognes, une épicerie qui n’est guère plus qu’un dépanneur et un haut lieu de commérage sur les moeurs débridées du quartier. Petits commerçants vivant de la misère de leurs voisins, les parents ont connu une sorte de reclassement par le haut, mais dans les limites des possibilités objectives de dépassement offertes par le milieu. Ils demeurent pauvres, ne disposent pas de salle à manger ni de WC dans leur maison. Leur seul véritable plaisir réside dans la bouffe dominicale, la mangeaille de plats en sauce partagés avec la famille élargie, et leur culture se résume à la lecture des journaux locaux par le père et des romans-feuilletons par la mère. Dans ce contexte, le seul espoir d’échapper vraiment à ce monde clos et conformiste passe par la fille unique qui fréquente l’école catholique privée et qui parviendra ensuite à l’université, non sans opérer une rupture radicale avec ses parents et un univers ouvrier et populaire auquel elle est devenue étrangère. Cela lui permet d’en rendre compte dans la distance permise par le regard anthropologique qu’elle pose maintenant sur lui. Le roman se présente de la sorte très largement comme une mise en scène, dans un régime d’écriture ici encore fictionnel, d’une culture de la pauvreté dans la Normandie semi-rurale de l’après-guerre qui n’est pas d’ailleurs sans ressemblances avec celle du Québec de la même période.
La place, qui vaudra dix ans plus tard le prix Renaudot à Ernaux, sanctionnant sa reconnaissance comme auteure de premier plan, s’inscrit pour sa part directement dans le registre du témoignage et de la vérité. Il s’agit cette fois, sans passer par le détour du romanesque, jugé encombrant, de dresser la figure du père, mort récemment, d’évoquer les « paroles, les gestes, les goûts, les faits marquants de sa vie » et, ce faisant, de faire revivre le monde dans lequel il a grandi et qu’il l’a fait ce qu’il est devenu. C’est ainsi qu’on glisse insensiblement du portrait de la figure du père à la reconstitution du milieu, dans une volonté d’en dire à la fois « le bonheur et l’aliénation » : le bonheur des joies simples de l’existence, l’aliénation de qui n’a pas de prise réelle sur son destin et qui vit son rapport au monde sur le mode d’une acceptation résignée. L’approche retenue cette fois combine un témoignage de l’intérieur, car la narratrice écrit de son point de vue de fille qui a rejeté l’héritage paternel en accédant au monde bourgeois, et une enquête sur le terrain fortement teintée par le souvenir des sensations incorporées dans l’enfance et l’adolescence. La démarche sociographique est donc double, focalisée, intériorisée, provenant d’une conscience d’actrice et en même temps décentrée, extériorisée par cette conscience devenue jusqu’à un certain point étrangère au lieu dont (et d’où) elle parle.
C’est cette méthode que l’on retrouve déployée à une autre échelle dans Les années. Échelle temporelle dilatée aux dimensions d’un demi-siècle, échelle spatiale en expansion, débordant le territoire normand et couvrant celui de la France entière. Ce livre, qui n’est pas désigné génériquement mais qui s’apparente à une chronique, apparaît comme le précipité et la synthèse de l’ ?uvre d’Ernaux. On y rencontre la plupart des thèmes et motifs qui imprègnent l’ensemble de ses écrits antérieurs – l’univers familial, le reclassement social, la passion amoureuse et la jalousie, l’emprise des choses –, repris avec des variations nouvelles dans un cadre délibérément et pleinement historique.
Le « Roman total »
Dans l’Atelier noir, l’écrivaine confie que ce projet, élaboré dès le début des années 1980, s’est appelé successivement « Histoire », « Passage », « Génération » et, de manière plus ambitieuse encore, « Roman total ». Il s’agissait, précise Ernaux dans Les années, d’écrire une « sorte de destin de femme », entre 1940 et 1985, qui « ferait ressentir le passage du temps en elle et hors d’elle », bref de raconter une expérience personnelle sur fond d’Histoire. Une histoire saisie à la fois dans sa dimension événementielle, politique, et dans la longue durée comme processus de transformation des moeurs et des mentalités.
Pour faire éprouver aux lecteurs et lectrices ce sentiment de passage du temps, Ernaux va déployer une stratégie d’écriture reposant sur ce qu’elle appelle le principe de « l’autobiographie vide » et sur le recours et l’orchestration de « marqueurs d’époque », c’est-à-dire d’objets significatifs, révélateurs de l’air du temps et de l’atmosphère d’une époque.
L’autobiographie vide passe pour l’essentiel par la description objectivante, à la troisième personne, de photos de la narratrice évoquées par ailleurs sur un mode emphatique, dont ressort une étrange impression de distance et de proximité enchevêtrées : une familiarité froide en quelque sorte. Ces photos scandent les principaux moments, de l’enfance à la retraite en passant par le mariage et le divorce, de l’existence d’une femme d’aujourd’hui considérée comme la représentante typique du sort commun d’une génération née durant la Guerre et se déployant ensuite sur plus d’un demi-siècle.
Les marqueurs d’époque comprennent, outre les photos, des chansons, des films, des livres, des souvenirs de fragments de conversation, de gestes propres à certains groupes sociaux, tels qu’ils s’expriment entre autres lors des nombreuses scènes de repas qui traversent le récit et qui permettent à Ernaux d’évoquer la transformation des goûts et des manières de table, mais aussi les actualités sociales et politiques qui font l’objet de discussions animées au cours de ces agapes : la décolonisation, Mai 1968, les années Mitterand, etc. Dans cette perspective, les objets de la vie quotidienne apparaissent comme des révélateurs extraordinaires des modifications profondes des rapports aux choses et au monde. Du vélo aux téléphones portables, en passant par la télé et les ordinateurs, une époque bascule du temps ralenti de la période d’après-guerre au temps accéléré, instantané, dans lequel nous vivons aujourd’hui.
En cela, et l’écrivaine en est consciente, son entreprise recoupe et confirme celle d’un Perec dans Les choses (1965) qui décrivait la montée puis l’installation de la société de consommation, mais avec une dimension proprement historique en plus, permise par le dépliement de l’ « autobiographie vide ». Elle la rapproche de même, avec raison, de quelques immenses sommes romanesques, Autant en emporte le vent de Mitchell, La recherche du temps perdu de Proust, USA de Dos Pasos, Vie et destin de Grossman, comparaison audacieuse mais justifiée qui signale l’ambition et la portée de sa propre visée : reconstituer la vérité sensible d’un monde qui s’enfonce lentement dans l’oubli d’une époque devenue amnésique.
« La conception d’une littérature miroir d’elle-même, s’écartant des phénomènes historiques et sociaux qui constituent "le politique", ou les déréalisant, si bien qu’ils ne peuvent plus toucher ou déranger, je ne la comprends pas, elle m’est presque douloureuse. Sans doute parce que, à l’adolescence, si la littérature a contribué à me séparer de mon milieu, où on ne lisait pas, elle a été aussi prise de conscience, ouverture sur des problèmes insoupçonnés. » Écrire la vie, p. 550.